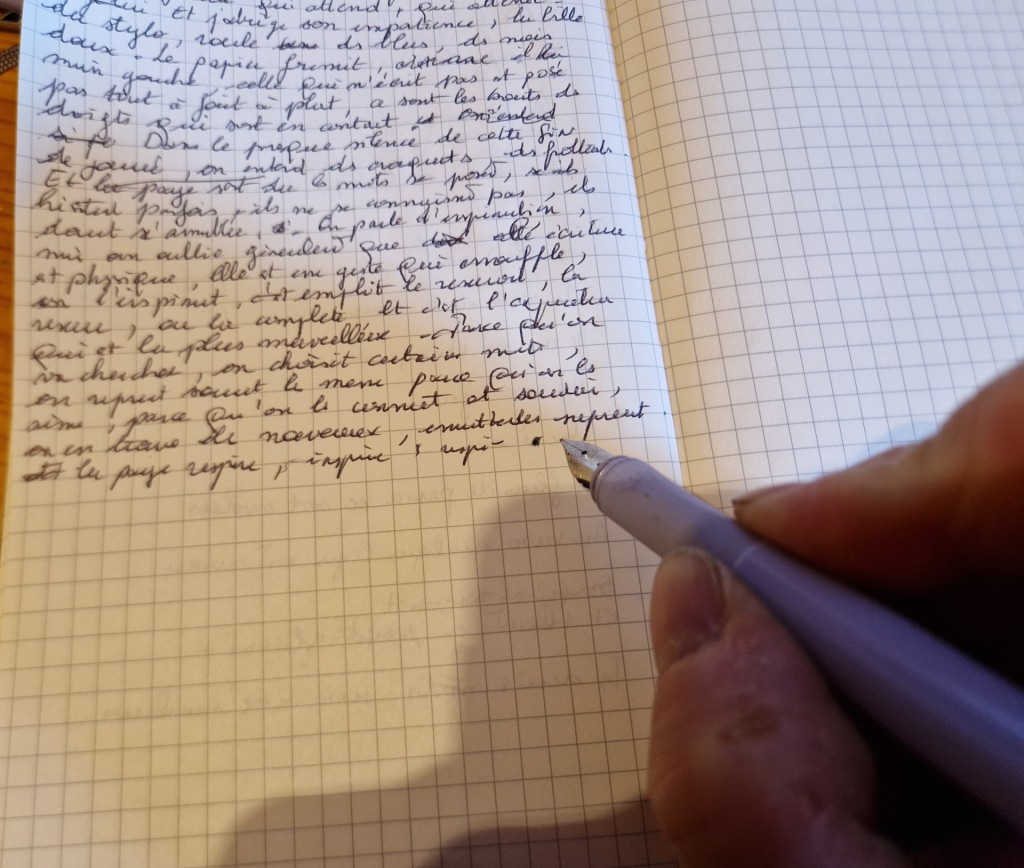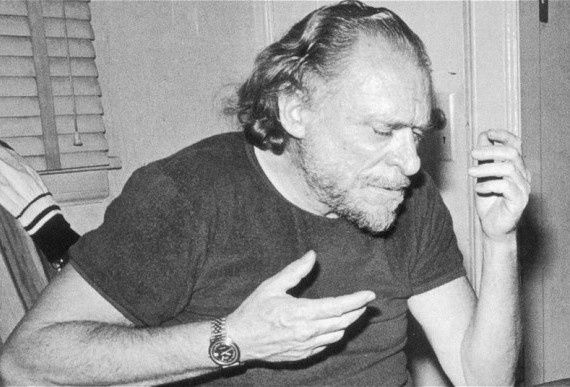Trois semaines ont passé depuis le départ de Rémi. Je ne suis pas retourné à la faculté. Je n’ai pas passé les examens. J’aurai considéré comme une trahison, une souillure à Rémi de poursuivre ma route dans cette direction qu’il n’avait pu se résoudre à prendre. J’ai occupé mes journées à ne rien faire, à attendre la nuit pour partir au cœur de la ville, dans la « grand rue », là où ma souffrance rime sans fausses notes avec la stupide rectitude de cette soi-disant artère centrale.
La saison ne me facilite pas la tâche. Les journées sont interminables. Les nuits comme les gens paraissent déborder d’une lumière dont ils font le plein avec frénésie. Même sur les coups de deux heures du matin les rues sont encore inondées de flaques de soleil que produisent les petits groupes de nouveaux bacheliers, tous de court vêtus, et qui célèbrent avec enthousiasme leurs diplômes fraîchement obtenus. Lorsque je les rencontre, je ne peux pas me résoudre à piocher quelques instants de chaleur dans mes souvenirs pourtant encore si proches. J’ai froid et je baisse la tête. Tout va si vite, demain, eux aussi en croiseront d’autres…
Ce soir j’irai voir Héléna. Elle a téléphoné il y a une semaine. Elle a dit que je pouvais passer quand je le voulais, cela lui ferait plaisir. En chemin, je me dis que c’est Rémi que j’ai envie de revoir dans notre souvenir commun. Je la sais fine et sensible et me réjouis à l’idée que nous allons passer la soirée à parler simplement, lentement comme je ne l’ai plus fait depuis trop longtemps. Elle habite un petit studio sous les toits vers la place Villeboeuf. Je trouverais facilement, c’est un quartier que je connais bien.
Ma souffrance est si grande, si rude, si entretenue qu’elle a désormais besoin d’un visage féminin pour servir de prétexte à ses prochains sourires… Je savais bien qu’avec Héléna nous n’avions pas vraiment commencé une histoire. Je savais aussi qu’elle était la seule qui pourrait me réveiller un peu, qu’elle était la seule qui pourrait m’arracher à mon impasse, qui pourrait m’aider à regarder au- delà de ces deux volets verts, fermés sur une fenêtre qui un matin n’a pas voulu s’ouvrir.
J’étais anxieux. J’étais anxieux de tout. Quand je suis arrivé devant sa porte, je me suis senti saisi d’étouffements. Comme si cette porte ne pouvait que rester définitivement fermée. J’ai la certitude qu’elle mettra longtemps à s’ouvrir et qu’elle ne pourra alors encadrer qu’un visage défait, le visage de quelqu’un qu’on dérange. J’ai tant besoin d’elle, j’ai tant besoin de l’aide de la seule personne à qui je réussis encore à penser sans éprouver un sentiment d’indifférence, ou de dégoût. J’ai besoin de sa présence, délicatement parfumée, de ses sourires discrets mais suffisants.
Je me souviens que lorsque nous nous voyions avec Rémi, elle était si vraie, si douce, si attentive qu’elle réussissait toujours à nous extirper un sourire, même lorsque l’orage grondait au plus profond de nous. Quand la porte a bougé, j’ai senti un courant d’air glacial cisailler mon dos en sueur. J’avais le souffle court de celui qui reprend l’entraînement du marathon après un longue période d’inactivité. Je l’ai cru surprise ou même gênée. De chacun de ses gestes je retire des indices pour m’échafauder un mauvais scénario où bien entendu je n’aurai, une fois de plus, pas le beau rôle. Je discerne un empressement discret pour dissimuler une présence « ennemie ». Elle a les traits tirés et les cheveux en désordre. Son œil brille et malgré la fraîcheur sa chemise est largement ouverte. Elle fait comme un trou béant sur une peau que je devine chaude… J’entends comme un martèlement derrière les oreilles, je sais qu’elle me parle mais aucun son ne me parvient si ce n’est ceux de mon cœur qui cogne et de ma peur qui m’essouffle. J’entends sortir quelques mots de ma bouche, j’ai l’impression qu’ils rampent et agonisent avant d’arriver jusqu’à elle. Puis ce sont mes lèvres qui se sont essayées à un exercice périlleux consistant à tenter une rencontre avec une parcelle de ce visage qu’elle m’offre au milieu d’un sourire. Lorsque le contact s’est produit, j’ai ressenti comme un picotement au creux des reins, comme si j’avais reçu une injection de fraîcheur dans tout le corps après un long séjour dans une cave humide. Quand elle a refermé la lourde porte, j’étais de l’autre côté, avec elle depuis dix mille ans…
Elle n’avait pas encore fait l’amour, mais tout en sentait les préparatifs. On ressentait dans cette pièce, la présence imminente d’un corps à corps soigneusement organisé. Celui que je ne pouvais qu’appeler « l’autre » était étendu sur le divan, ceinturon en berne et chemise ouverte. Il se tenait suspendu à un plafond imaginaire par le fil doré d’une cigarette américaine. Tout sentait la lassitude de l’inachevé. Tout respirait l’orgasme encyclopédique qu’on obtient par expérience, par technique, par assurance. Alors qu’il restait là, avachi, contemplant la mouche du plafond, j’ai soudain aperçu Héléna englué dans un cocktail de tendresse, de déception et de dédain.
Elle frémissait, elle comprenait ma douleur, peut-être parce qu’elle l’éprouvait aussi. Sa chevelure était noire, ses yeux aussi, pour me faire comprendre qu’elle restait ainsi comme je la voulais. Ce que je voyais n’était que le préambule d’une mauvaise pièce qu’elle aurait peut-être jouée, contre son gré, ou par mauvaise habitude. D’une voix enrouée de tabac, ou de larmes qu’on ne peut retenir, elle m’a proposé de m’asseoir, comme au spectacle, pensai‑je ironiquement. Puis en quelques mouvements de doigts adroits, je l’ai vu se transformer pour être plus près de moi.
Tous ces moments n’étaient qu’instantanés. Il ne s’était pas déroulé plus d’une demi-minute entre l’instant où mon doigt a effleuré la sonnette et celui où mon corps est entré en contact avec le Skaï râpé d’un fauteuil de récupération. Mais je me sentais fatigué, comme après une nuit de voyage. Il faut dire que depuis la mort de Rémi, plus rien ne se déroule comme avant. Même le temps semble hésiter à choisir ses prochaines victimes. Parfois tout s’accélère, parfois chaque seconde semble porter en elle un tel poids qu’on peut presque l’entendre passer.
J’étais assis, elle aussi. Près de moi. L’autre restait étendu, comme s’il voulait jouer son rôle jusqu’au bout, malgré les rideaux fermés. Je ne le connaissais pas, mais j’aurai pu le rencontrer dans un de ces nombreux moments de futilité qui ponctuent une vie réglée à l’avance. Derrière ses yeux embrumés d’un voile de mélancolie se dissimule l’assurance insupportable d’un de ces insectes universitaires que j’ai eu rencontrés dans un bourdonnement anonyme. Je constate que plus que la maigreur habituelle, c’est la pâleur qui l’habille. Elle me le présente.
- Un copain étudiant…
Il a l’air ému de cette nouvelle décoration qu’elle vient de lui accrocher comme l’ultime récompense d’un combat contre le doute. Elle me regarde, et tout en me touchant la main, comme pour me rassurer, comme pour me prouver que j’existe plus que ne pourraient le laisser supposer nos quelque trop brèves rencontres.
– Un vieil ami !
Ce n’était pas tant ce substantif « ami » qui me procurait ce picotement de satisfaction dans tout le corps. C’est plutôt ce qualificatif « vieil » qu’elle lui avait adjoint avec malice. Il est pourtant des mots qui me font l’effet de lames de rasoirs lorsqu’ils s’accouplent à d’autres dans le lexique de l’angoisse. Vieil ou vieux était de ceux là. Et d’une façon générale, je trouvais les choses, les idées si terriblement achevées que je trouvais inutile sinon snob de leur adjoindre artificiellement des compagnons de pourriture. Le seul adjectif que je peux vraiment supporter n’existe pas encore, il est encore en gestation dans un méandre inconnue de mon cerveau fatigué. Le mot illustre suffisamment arbitrairement la chose sans qu’on se sente obligé de le contaminer en le décorant inutilement au moyen d’adjectifs toujours mal choisis. C’est pourquoi en temps normaux et utiles, ce petit bonus ajouté au paquet d’amitié m’aurait profondément agacé. Et j’aurai entendu dans l’écho du « vieil ami » quelques fanfares coloniales, quelques grandes claques dans le dos. J’aurai perçu des rires gras autour de verres emplis de merveilleux souvenirs régimentaires. Mais, aujourd’hui, dans cette situation particulière, cette situation de combat, je me sentais bien dans la peau du vieil ami… C’était agréable de se sentir valorisé de quelques grades de plus dans le registre d’avancement d’Héléna.
De toute façon, elle avait du lui parler de Rémi. De moi peut-être. Surtout de Rémi. Je sentais sa présence durant les moments de silence. Une présence qu’on ne pouvait ignorer, derrière les yeux, derrière cette petite lueur qui nous rendait complice même sans rien dire. Sur le lit, l’étudiant tentait de surligner sa présence insignifiante au moyen de gestes circulaires qu’il accomplissait avec sa cigarette. En fait il semblait accuser le coup face à une situation d’indifférence flagrante à laquelle il ne s’était pas préparé.
Il s’est assis dans le grand nord de ce lit toujours brumeux. Sa tête ne lui appartenait plus, elle n’était plus que le vulgaire prolongement de cette colonne vertébrale qui s’efforçait de lui conserver une apparence humaine. Il n’était plus qu’un objet facultatif, il n’était plus qu’une bizarrerie dans le calme de cette pièce. Je me sentais calme, vivant et je savourais avec satisfaction chaque instant. Héléna est allée chercher à boire. L’ombre volumineuse qui stationnait sur le lit a semblé se dégonfler dans un long gémissement. Bientôt je ne distingue plus qu’une masse compacte et grise d’où émerge parfois un trou béant et remuant par lequel sortent des sons qui associés entre eux selon l’irréfutable géométrie de l’entendement civilisé forment des mots et même des phrases. Je le sens à l’aise depuis que le fantôme de Rémi est là, entre nous. J’ai de la peine pour lui et je comprends son inquiétude. Il sait qu’il a perdu, il sait qu’il n’est même pas inscrit en marge de cette histoire dont il ignore tout. Il a posé une nouvelle fois ses yeux sur moi pour m’annoncer, presque en s’excusant qu’il connaissait Héléna depuis un an, qu’il l’avait rencontrée chez des amis communs. Ils étaient devenus de bons copains, c’est tout…
Je suis pris d’une irrésistible envie de rire. Tous ces mots me paraissent avoir été prononcés des milliers de fois. Ils sonnent creux, ils sentent la frustration. Ils ont l’aspect coagulé de ces phrases qu’on ressort à tout instant comme pour se persuader qu’on n’est pas des frigides du verbe. Désormais il me faisait pitié dans son déguisement grammatical où se distinguait l’assemblage hétéroclite de son passé crémeux et de son avenir aseptisé. Je ne lui en voulais même pas, je le plaignais de s’obliger à sous titrer toutes ses sensations de mauvaises traductions. Il faisait partie de ceux qui ont honte de pleurer, de ceux qui n’acceptent pas de subir la souffrance, la sienne comme celle des autres. Il appartenait à la grande famille de ceux qui s’efforcent tant de paraître qu’un jour ou l’autre ils disparaissent totalement…
Je lui ai souri, cruellement, pour qu’il cesse de se répandre dans cette pièce. Je l’achevais en lui déclarant que je la trouvais belle, très belle, l’intérieur comme l’extérieur. Quand Héléna est revenue, il était debout, comme un drapeau en berne. Il a prétexté un rendez‑vous déjà manqué et il est parti.