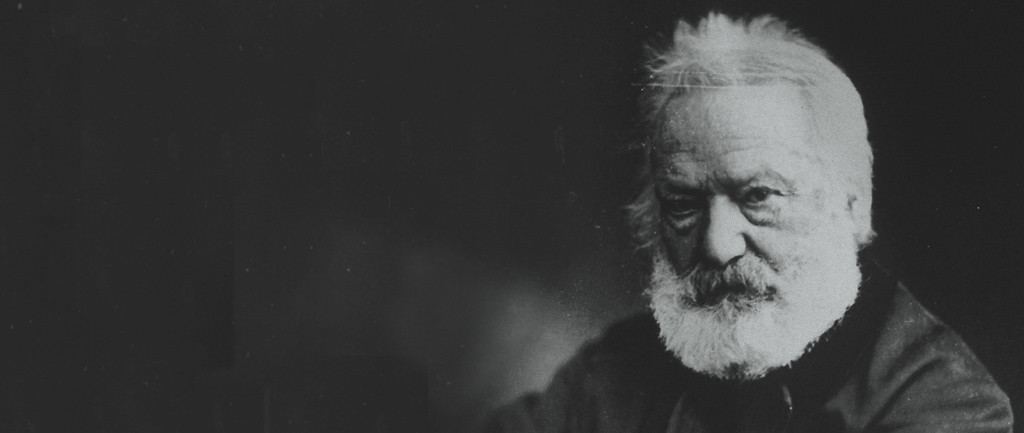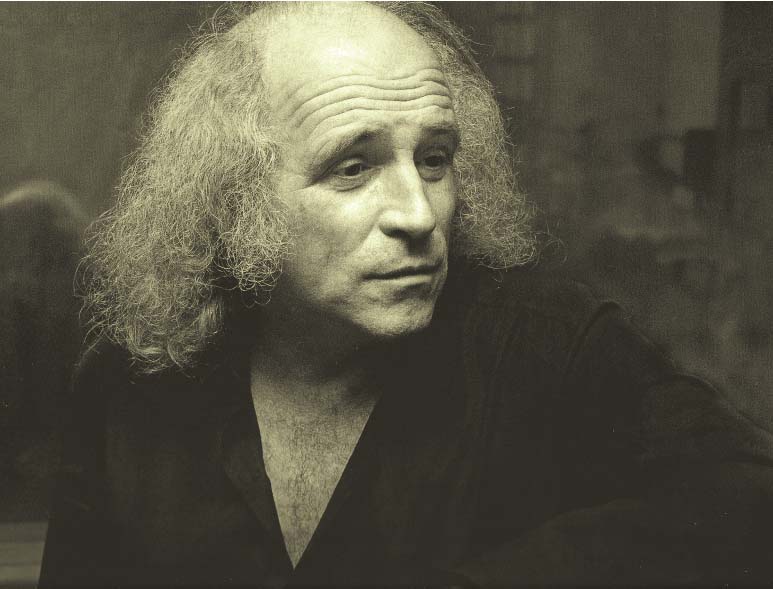Tu peux être peureux
De supposer
Que finalement t’es pas là pour rien
Tu sais que l’unique ne peut exister
Sinon chez les théoriciens
Masturbateurs de cerveaux
Sinon chez les jardiniers
Du sentiment des autres
Tu ne peux pas passer ta vie à imaginer l’homme
Sans savoir s’il existe réellement
Comme les autres
Tu ne peux pas passer ta vie
A t’imaginer
Dans ton rêve
Sans savoir s’il est tien
Sans savoir s’il est réalité
Sauf peut-être pour d’autres
Pour elles
Pour eux
Veux-tu encore construire de l’amour
Parce que c’est un jeu entre deux fous
Parce qu’on invente des règles
Parce qu’on recommence
Toujours les mêmes règles
Mêmes conneries
Jamais le même prudent
Jamais le même perdant
Et de toute façon demain tu seras écrasé par un tramway