
Dans l’angle mort d’une histoire en pointillé
J’ai trouvé un vieux reste de lumière figée
Le bavard au cœur creux
Sans rien dire l’a abandonné
Dans l’onde dodue
Des ronds de mes rires bleus
Je l’ai jeté pour un dernier souvenir ricochet

Dans l’angle mort d’une histoire en pointillé
J’ai trouvé un vieux reste de lumière figée
Le bavard au cœur creux
Sans rien dire l’a abandonné
Dans l’onde dodue
Des ronds de mes rires bleus
Je l’ai jeté pour un dernier souvenir ricochet

Dans ce presque soir ferroviaire,
Flaque de mémoire s’est échappée.
Je la vois,
Tout va si vite.
Elle glisse sur la vitre.
L’encre noire de mon âme est noyée
Dans un trop plein de bleus.
De ce plein bleu trop salé,
Que la mer tous les jours m’a inventé.
J’entends,
J’attends.
C’est le long cri.
Long cri du souvenir de l’en dedans.
Il remonte,
Trempé jusqu’à l’os de mes mots,
Se présente à la grille rouillée de mon parc à rimes.
Sourires,
Il est si tard pour la fouille.
Les poches se vident…
Sur la table, s’étalent les vers.
« Dans la marge, vos mots coupants, vous déposerez ! »
Les lames ne franchissent pas le détecteur.
Les larmes seules sont admises.
J’ai tant de rêves qui vibrent.
Entends,
Ça résonne,
Ça bouillonne,
Ça brouillonne.
Dans ce demi-soir lunaire
Tant de voix se disputent la tribune,
Silence…
Il est temps de ne rien dire….

Souviens toi
Ô souviens toi
C’était l’été premier
Tu dormais à poings ouverts
Souviens toi
Ce vieux souvenir d’un hier fatigué
Tu me l’avais raconté
La marée était dans l’entre deux
Souviens toi
Le temps était aux pleurs
Tremblant de rire
Nous nous tenions serrés
Souviens toi
Tu glissais
Tu chantais
Tu aimais
Et nos mémoires se sont croisées
Souviens toi
Je te regardais et tu nous existais…

Je remonte patiemment à la source
Du torrent où roulent les cailloux de ma mémoire
Le route est longue et épaisse
De ces couches de mousses oubliées
Restes fragiles de rires faciles
Traces vertes humides de larmes solides
J’avance à tâtons dans l’ombre mauve
Des mélancolie sucrées
Il m’arrive parfois de croiser le peut-être d’un souvenir
Belle clairière sur le chemin du sommet

Dans le brasier d’après-midi
La ville est assoupie,
La chaleur écrase tout.
Elle s’étire, lente et humide,
Plus rien ne bouge,
Mercure en folie.
Les corps lourds et moites,
Inventent des ombres
Il se parlent de fraîcheur.
Dans la lumière si blanche,
Les couleurs éclatent,
Les regards cherchent le mauve,
Douce couleur qui apaise,
Des rouges incandescents,
Les souffles sont courts,
Dans l’air, des bouquets d’épices,
Une odeur de terre mouillé,
C’est la Malaisie.

Lorsque nous ouvrirons les yeux
Comme si hier avait disparu
Englouti dans le ce n’était presque rien
Lorsque nous ouvrirons les volets gris
Fermés sur les haines humides
Nous entendrons le beau chant de la mer
Aux cimes des pins ondoyants
Au bord de nos lèvres étonnées
Un reste de cette écume salée
Que posent les longues houles d’une nuit agitée…

Il est midi sur le plateau,
Sans un souffle, doucement chaleur s’est installée.
Il est midi sur le plateau,
Le bleu du ciel est en apnée, les couleurs sont fatiguées.
Il est encore tôt,
Le champ de blé ondule,
Longues vagues ocres sur la terre échouées.
Il est midi le soleil est si haut,
Et soudain, la mer est là, accrochée à l’horizon.
Dans l’arrière-pays de ma tête,
Une mouette s’est perdue
Elle cherche un port où se poser.
J’ai les yeux qui se ferment,
C’est le rêve qui prend le large.
Il est midi sur le plateau,
Ferme les yeux,
C’est l’air de la mer,
Il descend, il est si tôt.

Sur l’eau, quelques rides de lumières,
Le matin léger s’étire sur le fleuve.
Au loin la rumeur de la ville,
Comme un bruit qui s’éveille.
On s’étire, le silence se respire.
Il fait frais, on sourit.
Le jour se lève.
C’est beau,
La nuit s’est retirée,
Discrètement, le port l’a avalée.
Le soleil est là, on le sent.
On l’entend.
Chaque couleur s’est préparée,
Dans le matin léger,
Ses ailes lissées le fleuve a déployé.

Feuille blanche
Nuit blanche
L’Avoriaz du papier
Dans une seconde
De demi-silence
Se grouperont
Des sur-mots
Février 1980

Dans la longue et lente langueur
D’un moite matin d’été
Une trace des ombres tièdes de la nuit
Il reste si peu pour se sourire
Sur le long quai des attentes enfermées
Et pourtant je voudrais
A toutes à tous vous dire à demain
Nous avons tant à nous dire
23 juin

« De toutes nos machines réunies, de toutes nos routes kilométrées, de tous nos tonnages accumulés, de tous nos avions juxtaposés, de nos règlements, de nos conditionnements, on ne saurait réussir le moindre sentiment. Cela est d’un autre ordre, et réel, et infiniment plus élevé.
De toutes vos pensées fabriquées, de tous vos concepts triés, de toutes vos démarches concertées, ne saurait résulter le moindre frisson de civilisation vraie. Cela est d’un autre ordre, infiniment plus élevé et sur-rationnel.
Je n’ai pas fini d’admirer le grand silence antillais, notre insolente richesse, notre pauvreté cynique.
Vous avez encerclé le globe. Il vous reste à l’embrasser. Chaudement.
Les vraies civilisations sont des saisissements poétiques : saisissement des étoiles, du soleil, de la plante, de l’animal, saisissement du globe rond, de la pluie, de la lumière, des nombres, saisissement de la vie, saisissement de la mort.
Depuis le temple du soleil, depuis le masque, depuis l’Indien, depuis l’homme d’Afrique trop de distance a été calculée ici, consentie ici, entre les choses et nous.
La vraie manifestation de la civilisation est le mythe.
L’organisation sociale, la religion, les compagnies, les philosophes, les mœurs, l’architecture, la sculpture sont figuration et expression de mythe.
La civilisation meurt dans le monde entier, parce que les mythes sont ou morts ou moribonds ou naissants.
Il faut attendre qu’éclate le gel poussiéreux des mythes périmés ou émaciés. Nous attendons la débâcle.
…Et nous nous accomplirons.
Dans l’état actuel des choses, le seul refuge avoué de l’esprit mythique est la poésie.
Et la poésie est insurrection contre la société parce que dévotion au mythe déserté ou éloigné ou oblitéré.
On ne bâtit pas une civilisation à coups d’écoles, à coups de cliniques, à coups de statistiques.
Seul l’esprit poétique corrode et bâtit, retranche et vivifie. »
Aimé Césaire, Appel au magicien – Mai 1944, Haiti

Je voudrais écrire un mot encore inconnu
Mot rare et doux échappé
Du dictionnaire de l’impossible
Ou chaque page se tourne en rimant
Je cherche l’incroyable
Feuille à feuille j’avance d’un presque rien
Il est là en bord de page
Il attend le souffle frais
Des étonnements impatients
Entends le chant des douces voyelles
Elles se frôlent en dansant
Le tango des frissons sonnants

Ce que je te souhaite toi qui me lis
Ce que je te souhaite ô toi qui me vis
C’est une belle tranche de vie
Croquante ou craquante
Tu la verras riante
Au bord du matin brillant
Au bord de tes lèvres elle pétille et ruisselle
Dans ta chaude aube de miel
Écoute elle ondule pour se rendre belle

L’attente est en marge
Des pages aux lignes humides
Dans l’ombre claire des visages courbés
Des traces molles du dimanche insomniaque
28 novembre

Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. Ce monde est malade on le sait. Mais celles et ceux qui se disent à son chevet le sont encore plus. On parle, on glose, on discourt, on désigne, on accuse, on exécute. Les experts du clic compulsif ont l’œil vitreux du colporteur de haines. On s’indigne du presque rien et on oublie l’essentiel.
– Des êtres humains me dites-vous ?
– Oui bien sûr, ils sont partout, ils attendent…
– Pouvez vous me les décrire ?
– Les décrire n’est pas possible l’ami ils existent c’est tout…
– Je n’en connais pas, je n’ai pas le temps et il faudrait que je lève la tête.
– Et bien l’ami je vous invite à le faire.
– ….
– Oui là, comme ça c’est très bien parfait. Redressez vous, regardez autour il y a des vivants.
– Oui je les vois mais voyez vous on dirait qu’ils tournent en rond.
– Non l’ami ils ne tournent pas en rond, ils dansent. C’est tout.

Au fil rouge solaire de mon printemps éternel
J’ajoute à la foule vibrante des amis fidèles
Compagnes et compagnons
De la grande usine de mes luttes
Pour les oubliés
Entends leurs rires qui claquent
Au vent léger des émotions
Tu ne pleures plus
Tes larmes roulent en chantant
Le doux refrain des traces partagés

Je ne crois pas hasard
Aux fausses surprises paresseuses
Quand le temps est au sursaut
Je vois la tendre trace
De ces destins qui se croisent
Aux angles mauves des clins d’œil
Qu’ils lancent en rêvant

Au bleu milieu de cette vie à mille pages
J’écris une lettre aux amnésiques des rires heureux
Le mot à mot goutte doucement
Dans les veines vides de leurs ennuis
Je pose le front contre la vitre de leurs silences appris
Leurs tristes regards se redressent en souriant
C’est un beau matin offert aux amis
19 juin

Aux quatre coins d’une mémoire bleue
Reste de sourires heureux
Belles et douces rides
Jouent une vague mélodie
Aux amis du monde aux beaux yeux
J’ai été peu présent ces derniers jours ni pour lire ni pour écrire. Il faut dire que la semaine a été chargée autant sur le fond que la forme. J’ai été fêté par mes collègues et amis en prévision de mon très proche départ en retraite. C’était fort, émouvant…J’ai fait une belle réserve d’émotions.

Et soudain je vois d’autres demains
La tempête a soufflé fort
Sur les rives apaisées
Du torrent de mes angoisses
Ne restent que les belles traces
De vos mots cœurs
De vos étreintes fleurs
Ce matin mes larmes sont séchées

Dans la nostalgie des hiers chevelus
Il y a le regard qui interroge
Tous les peut-être
Accrochés au fil de nos rêves
Pour demain

Matin brouillard
La nuit est en sursis
Dans le droit devant
D’un virage futur
Ecoute
Long et lent
Le souffle glissant
Des souvenirs abîmés

Comme tous les matins, Jules se lève tôt, s’habille rapidement, et visage encore barbouillé des restes de la nuit, s’en va acheter la presse. Il ne se contente pas du seul journal régional, il aime aussi les quotidiens nationaux. Jamais les mêmes, il butine, il n’aime s’enfermer dans aucune camisole, encore moins de papier. Il aime ce moment ou devant le présentoir, il hésite, il compare les unes, les titres du jour et suivant son humeur, il en choisit un ou deux, jamais les mêmes. Il paie, les plie soigneusement et accélère le pas, impatient de les étaler sur la table, tout en buvant un grand bol de café.
Trois unes l’ont attiré ce matin : la première « Ecoute l’automne », la seconde : « Le monde : une île ! » et la troisième « Elle aime la lune ». Surprenants ces titres, on ne dirait pas de l’actualité se dit-il sur le chemin du retour. Mais il n’ouvre pas les journaux, il aime ce rite matinal, qu’il ne veut pas transgresser sous prétexte de curiosité.
Jules est dans sa cuisine, le café est prêt. Il s’installe. Comme d’habitude, son bol est légèrement sur la gauche pour qu’il puisse étaler les journaux et il commence sa revue de presse. Il débute par « Elle aime la lune ». Il lit rapidement les quelques lignes qui accompagnent la photo de la une. C’est vrai que cela lui semble léger, plus doux que d’habitude. Il ouvre le journal, poursuit sa lecture : « mais qui est-elle celle qui aime la lune ? »
Bref il lit et l’impression se confirme. Sa lecture est agréable ! Il ne parvient pas à en expliquer les raisons, mais il se sent bien. Il ouvre son deuxième quotidien, « Ecoute l’automne » : mêmes impressions, douceur, bonheur, sourires. D’ailleurs il le sent parfaitement qu’il sourit. Il est bien, tellement bien qu’il s’empresse d’ouvrir le troisième : « Le monde : une île ! ». Et là, comment dire c’est l’apothéose : c’est comme le premier stade de l’ivresse, il se sent gai, insouciant avec l’envie de s’étirer en souriant. C’est ce qu’il fait d’ailleurs !
C’est dans ce mouvement qu’il aperçoit le gros titre du quotidien régional : « Catastrophe dans le monde de la presse nationale : les lettres R et les lettres S ont totalement disparu des rédactions ! ».
16 novembre 2019

C’est un mardi matin du mois de novembre 2020, je crois, que tout a commencé. Ou plutôt que tout a recommencé. C’est simple. Ce matin-là, au réveil, aucun écran n’est éclairé. Et quand je ne dis aucun, ce n’est vraiment aucun !
Ecrans petits et grands,
Écrans numériques,
Écrans électroniques,
Ecrans cathodiques,
C’est le noir,
Noir sidéral,
Pas une diode,
Pas un clic,
C’est la panique
C’est impossible, il doit y avoir un hic. Chacun accuse : c’est la prise, c’est le câble, c’est le réseau électrique…. Au saut du lit, le premier geste est pour l’écran. Vite : réveiller la machine, vite regarder, on ne sait jamais…Une information importante est peut-être arrivée dans la nuit. Mais là rien, l’écran est figé, glacé, il ne réagit pas. Le doigt s’agite, le cœur palpite…
Et c’est ainsi qu’au même moment, dans tout le pays, des millions de personnes allument, rallument leur téléphone et rien ne, se passe. Ils triturent le câble, vérifient la prise, cherchent un coupable : l’époux, l’épouse, les enfants, le chat, l’état. En quelques minutes, la panique enfle, elle s’installe, partout.
En quelques minutes… Façon de parler. Le temps est difficile à estimer. L’heure aussi, n’existe que sur des écrans : l’heure est numérique, l’heure est électronique. Ce matin l’heure n’existe plus, elle s’est échappée, elle s’est enfuie.
Le jour est levé. Les pas sont lourds, les épaules sont basses. Il faut se résoudre à prendre le petit déjeuner. Tout le monde se retrouve autour de la table, les écrans vides et gris sont posés à côté du bol, petits objets inertes. Il se produit alors quelque chose d’incroyable, les visages se redressent, les lèvres remuent, et des sons sortent, au début ce ne sont que des grognements. Puis des mots se forment : tiens on avait oublié comme c’est joli un mot, même petit. Partout, on parle, on se parle. Pour commencer la météo, et incroyable on regarde par la fenêtre. Formidable cette application, on voit le temps qu’il fait. Et tout s’accélère, des mots, puis des phrases, des conversations, des sourires.
Il est huit heures,
Partout cela bourdonne,
Parfois cela ronchonne,
Il est huit heures,
Plus un clic
Numérique, électronique,
L’heure est si belle,
Vêtue de ses plus belles aiguilles….
14 novembre 2019

Dans l’arrière jour de mes nuits blanches
J’ai creusé le trou de ma mémoire oublié
Dans le fond endormi
Sur un bord de molle dune
Petits mots aux teintes passées
Dansent en giguant la ronde des guenilles
Ils vont ils roulent ils vrillent
Mots d’hier j’entends vos rires d’enfants
Crépies de mauve brune
Douces caresses se posent
Sur le long mur blanc
De ma moite insomnie
Tout est fini
Sur la feuille froissée d’un passé retrouvé
Sans un pli présent rassuré s’est endormi…

Il est des matins qu’il faut laisser tranquilles
Les laisser se débarrasser des restes de nuit
S’étirer doucement
Engloutir un bol de silence
Il est des matins qui sursaute
Au chant mécanique de la vitesse du monde
Ne rien dire
Ne rien faire
Choisir les mots qui rimeront
Avec les couleurs de la belle journée
Bientôt…

Vide
C’est le vide infini
Oui, là, au dessus, me dites-vous
Il n’y a rien plus rien
Je n’écoute pas
Ne change pas, ne bouge pas
Mes yeux plissent
Fripés de doutes bleus
S’enroulent dans le rêve mauve
D’un drap moite des empreintes de corps
Je ne cherche rien
Je ne crois rien
J’existe je vois
Je sens je ressens
J’attends
Un brusque souffle
Orage hésite
Il est si tôt pour la peur
5 juin

J’ai plongé la main,
Dans le fond mauve de ma poche à sourires.
Il y restait quelques miettes d’air marin ;
Dans le doux creux de ma paume de cire
J’entends, elles chuchotent un chant câlin.
Ô si beaux ces mots loin du pire.
Lavés, salés, à ma bouche les ai portés, comme le bon pain.
Les yeux j’ai fermés : la mer est entrée, elle a tant à me dire…

Elle est là, belle et vibrante
Heure ocre et ronde
Du joli soleil matin
Regarde
Elle butine des pollens de rires
Sur les fines lèvres rêveuses
Des fleurs de silence
Dans les vides impatients
De tes demains qui attendent
Elle pose en sifflant
Ce si doux miel de tes restes d’enfance…
5 juin

Je ne veux plus
De ce silence glacé
Qui roule en pleurant
Sur la mousse verte et ventrue
Des pentes asséchées
Je ne veux plus
De ces fracas de voix
Qui brisent en crissant
Les longues et fines lames
De mes rires boisés

Il a ouvert son livre intérieur pour y ajouter quelques pages.
L’encre ne sèche plus, elle est le sang des mots
Il s’échappent quand la lumière les éveille,
Mots qui s’envolent, plus rien ne les retient
Dans le vent qui les attend, quelques grains de lumière,
Les yeux les lisent, le regard se plisse
Et le cœur qui s’affole, on est bien
Pas un son qui ne s’essaye au bruit
Tout est dans la mélodie les notes s’enroulent
Autour des mots, il flotte comme un doux rien de légèreté

Ses mains se posent.
A plat, fines et légères
Ses mains reposent, ailes d’ange
Autour le silence
La douceur s’impose
Sur ses doigts mon regard se pose,
Longs pétales, d’un regard je les effeuille
C’est beau ces yeux d’ailleurs
Sur la peau, ils effleurent,
Quand la lumière faiblit,
Quand les derniers rayons sont suspendus
C’est beau cette main, entre ombre et lueur
Je ferme les yeux, sa main est fleur
Les doigts se touchent
Un frisson m’entoure
J’aime ses mains,
Elles lisent en moi

Il est l’heure de la lumière,
Il me reste un bout de rêve mauve.
Infime miette dans un bol de rire noir,
Laissée là, douce et croquante
Par une nuit rassasiée.
Au creux du silence du matin qui gémit,
J’avance tête baissée,
Tirant sur le long fil de ce songe qui sourit.

Dans ma boîte à couleurs
Je cherche ce mot qui tinte,
Je le voudrais doux et gai.
Un mot pour apaiser
Un mot pour aimer.
Et sur ma feuille pâle d’ennui,
Ivre de couleurs
Le poserai sans un bruit…

J’ai dans la mémoire de mes mains un trou d’où jaillit une petite lueur. Lumière des mots oubliés, étouffés par l’ombre grise du dictionnaire de l’utile dont on habille les phrases pour sortir dans la pudeur administrative. Je pose mon œil poétique au-dessus, juste au-dessus et soudain les doigts retrouvent le chemin, on dirait qu’ils dansent sur le papier, ils sont chargés de beau, ils sont emplis de ces courbes que prennent les mots quand ils sont libérés de leurs prisons académiques ; et ils dansent et ils chantent de la fraîcheur retrouvé.
Qu’ils sont beaux les mots !

Sous les plis d’une mémoire froissée
Le vieil homme a caché les quelques miettes
Du beau souvenir d’une odeur de pain chaud

Je voudrais une fête étrange et très calme
avec des musiciens silencieux et doux
ce serait par un soir d’automne un dimanche
un manège très lent, une fine musique
Des femmes nues assises sur la pierre blanche
Se baissent pour nouer les lacets des enfants
Des enfants en rubans et qui tirent des cerfs-volants blancs
Les femmes fredonnent un peu, leur tête penche
Je voudrais d’éternelles chutes de feuilles
L’amour en un sanglot un sourire léger
Comme on fait entre ses doigts glisser des herbes
Des femmes calmement éperdues allongées
Des serpentins qui voguent comme des prières
Une danse dans l’herbe et le ciel gris très bas
lentement. Et le blanc et le roux et le gris et le vert
Et des fils de la vierge pendent sur nos bras
Et mourir aux genoux d’une femme très douce
Des balançoires vont et viennent des appels
Doucement. Sur son ventre lourd poser ma tête
Et parler gravement des corps. Le jour s’en va
Des dentelles des tulles dans l’herbe une brise
Dans les haies des corsages pendent des nylons
Des cheveux balancent mollement on voit des nuques grises
Et les bras renvoient vaguement de lourds ballons

Je voudrais écrire,
Oh oui, je le veux…
Écrire pour deux,
Pour toi, pour eux.
Je voudrais écrire
Heureux,
Entre deux lourdes marges en feu.
Oh, je voudrai tant écrire,
Ce mot qui caresse,
Là, seul,
Il attend, rien ne presse.
Je voudrais tant écrire
Tendresse,
Sur une feuille d’automne
Aux rimes mauves
Sur le titre accrochées.
Je voudrais tant…
Tremper ma plume
Dans une flaque de rires jolis.
Je voudrais tant entendre
De longs mots aux ailes bleues.
Ils chantent, ils dansent,
C’est eux, ils sont arrivés.

Un jour tu verras je me souviendrais
Des rires qui somnolent
Caresses lointaines
Coulent dans le creux sec
D’une longue ride
A la source d’un regard oublié

Je suis à la fenêtre
Du si simple rêve
Qui se pose au matin
Sur la palette de mes envies
Le temps est au sourire
Douce main du peintre endormi
Caresse du bout des doigts éblouis
Blanche toile d’un soleil assagi

Grain de sable de mon salut
A force d’être claire et de donner à boire
Comme on ouvre la main pour libérer une aile
À force d’être partagée et réunie
Comme une bouche qui s’amasse ou qui frissonne
Comme une langue de raison qui s’abandonne
Deux bras qui s’ouvrent qui se ferment
Faisant le jour faisant la nuit et rallumant
Un feu qui couve mille enfants perdus d’espoir
À force d’incarner la nature fidèle
Forte comme un fruit mûr faible comme une aurore
Débordant des saisons et recouvrant des hommes
À force d’être comme un pré qui hume l’eau
Qui donne à boire à son terrain de haute essence
Innocent attendant un pas balbutiant
Comme un travail et comme un jeu comme un calcul
Faux jusqu’à l’os comme un cadeau et comme un rapt
À force d’être si patiente et souple et droite
À force de mêler le blé de la lumière
Aux caresses des chairs de la terre à minuit
À midi sans savoir si la vie est valable
Tu m’as ouvert un jour de plus est-ce aujourd’hui
Est-ce demain Toujours est nul Jamais n’est pas
Et tu risques de vivre aux dépens de toi-même
Moins que moi qui descends d’une autre et du néant.

Dans le fonds asséché de mon puits à rêves bleus
De lourdes pierres noires emplissent le vide de ma page blanche
Mots fleurs, mots ciels, mots vagues
Tous sont écrasés
Ils se tordent le cou pour inventer le chant
Des rimes en rires
Ils se tordent le cou pour s’échapper
De l’humide étreinte du nœud coulant qui les étouffe

Sur la peau blanche de mes espoirs
J’écris les mots pour demain
Dans un bouquet de rires enfouis
Je trempe ma plume épuisée
Sur le papier au grain glacé
Une boucle aux bords bleutés
Je trace en pleurant
Ces mots que j’aime
Pour toi
Pour nous
Je les lie
Main dans la main
Loin du hier de nos ennuis
Ils s’envolent
A tire d’ailes
Entre les bras du couchant
Regarde-les
Ils s’enfuient
Regarde-les
Nous sommes en vie

C’est un matin barbouillé
Repue d’un lourd gris huilé
La nuit mauvaise s’est retirée
La lumière à marée basse oubliée
Nous attend entre les plis du ciel froissé
Lumière est à marée basse

Des photos jaunies dans un vieil album
Des photos jaunies que quelqu’un a prises
Quand tu étais brave, jeune et fier
Dos au mur, sauvage et bruyant
Un gilet en peau de serpent et un costume en peau de requin
Des talons cubains sur tes bottes
Un coup de pied dans le groupe et côte à côte
Tu emmènes la foule dans une ballade mystérieuse
Chevaliers de Colomb et le bal des pompiers
Vendredi soir au Union Hall
Y’a des clubs « cuir noir » le long de la route 9
Où on compte les noms des disparus comme un compte à rebours
Une nuée d’anges permet à me
Quelque part, haut et fort et bruyant
Quelque part, au cœur de la foule
Je suis le dernier debout à présent
Je suis le dernier debout à présent
Sorti de l’école, et sans travail
Jeans usés et chemise en flanelle
Les lumières se tamisent et on fait face à la foule
Le dernier debout à présent
Les lumières s’allument dans la salle du Legion Hall
Les queues de billard sont associées au mur
Tu remballes ta guitare et vides ta dernière bière
Avec ce bourdonnement dans tes oreilles
Une nuée d’anges permet à moi
Quelque part, haut et fort et bruyant
Quelque part, au cœur de la foule
Je suis le dernier debout à présent
Je suis le
Je suis le dernier debout à présent

Petit matin au parfum sucré
Feuilles fleurs sont en beauté
Patience du fruit
Au vert frisonnant
Merci à Barbara d’aider chaque matin mon soleil à se lever…

au matin je prendrai par la main ton âme déshabillée de la mémoire des chambres et je l’emmènerai au jardin pour l’habituer doucement à la joie et à l’ensemencement des possibles confiante en d’autres espaces en d’autres lois et tisseuse de fables en la saison où penche notre coque je glisserai candidement à la cloison […]
La douce-amère aux yeux de mousses

Englué entre les quatre murs de mon angoisse
Je voudrais sauter comme l’enfant
Tête à l’envers
Pieds joints dans la flaque d’un reste de bleu
Je voudrais aplanir la larme coupante
Du peut-être des demains aiguisés
A la pierre des tristes peurs
Ô pluie des rires arrondis
Je t’attends c’est promis…
30 mai 2023

Je ne rêve plus dit l’homme apaisé
Je n’en ai plus l’utilité
Je me passe des faux espoirs bleutés
Je n’ai pas le temps de m’abimer dans l’angoisse
Belle à en pleurer
La tristesse est là elle attend
Je ne la crains pas
Nous partagerons nos larmes salées
Et demain sera plus vrai

Il m’arrive assez régulièrement de dire, de me dire, que ce monde est devenu fou, qu’il ne tourne pas rond. Et je regrette immédiatement mon propos et j’en viens même à m’excuser auprès de ce monde qui continue à tourner invariablement sur lui-même. Et je plonge alors dans une réflexion sur le sens qu’ont les mots et celui qu’on leur donne. De quoi parle t’on lorsqu’on parle du monde : de la terre, de cette planète qui nous abrite et qui convenons-en est ronde ou tout au moins sphérique? Oui elle est sphérique, c’est plutôt une boule. Mais on préfère quand même dire que la terre est ronde. Ce n’est pas grave, et oui n’en déplaise aux infâmes bigots et complotistes : la terre est ronde et elle tourne sur elle-même.
On appelle cela une révolution…Tiens donc, il faudra que je me penche sur ces révolutions qui durent depuis plusieurs milliards d’années…Mais revenons à ce monde qui ne tourne pas rond…Peut-être, finalement que lorsque je parle du monde il s’agit de celles et ceux qui vivent sur cette terre. Quand il n’y a personne on se contente de dire qu’il n’y a personne et plus ces personnes remplissent ce qu’on croit être le vide de cette terre plus on dit qu’il y a du monde…Et quand il y a beaucoup de monde, voire trop on ressent vite que tout cela ne tourne pas bien rond…Que font-ils, que disent-ils, où vont-ils ? Je n’en sais rien. Je ne dis rien. Moi aussi je fais, je dis, je vais et surtout je tourne en rond…

Le premier que j’entends me dire que tout est dans le « cloud », je l’obligerai, une fois au moins dans sa vie, à lever les yeux. Oui homme numérique, regarde bien, redresse toi : ce que tu vois, cet amas, gris, vaporeux, aux angles ronds c’est un nuage ! Oui mon ami un nuage ! Ce n’est qu’un nuage qui inspire, qui respire, qui soupire. Dans le nuage des gouttes d’eau, des perles de rêves, des espoirs. Ton nuage numérique je n’en veux pas: ne le traduis pas il pollue ma poésie et je t’en prie, je t’en supplie lorsque tu parles de mémoire fais un effort, cherche, creuse le sillon de cette vie que tu as laissée t’échapper…

Au fond de mes poches,
Quelques miettes de ciel.
Dans le creux de ma paume pressée,
J’ai pris quelques cailloux mauves.
En riant les ai semés.
Une à une, bulles légères
Sautillent, pétillent
Dans long couloir sans écume
Foule sans sillage,
N’entend pas le chant du large.

A l’ouest de mes mémoires salées
L’écume de tes mots
Douce caresse
Rime tendresse
Ta trace est là
Trait de lumière
Perce l’ombre creuse
De ton absence
Je souris et t’entends
Tu es là à ne rien dire
Vague fleur séchée
Sur la crête de ton océan

Vincent van Gogh, La chambre, détail (musée AIC Chicago)
Les Fenêtres
Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.
Par delà des vagues de toits, j’aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j’ai refait l’histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant.
Si c’eût été un pauvre vieux homme, j’aurais refait la sienne tout aussi aisément.
Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert dans d’autres que moi-même.
Peut-être me direz-vous : « Es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? » Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ?

Le soir glisse tout doucement.
Il vient de l’ouest chargé de cette douceur qui le font espoir
Le soir avance. Le lac l’attend, repu de cette journée où chaque ride de l’eau est un sourire
Un sourire pour dire à la mer, si loin, que derrière les yeux qui se posent sur cette surface apaisée
Il y a comme un regard marin, quelques rides en moins.
Le soir descend des montagnes,
On respire dans l’air qui descend les fleurs des sommets
Pas un bruit de moteur, pas un cri mécanique, le silence est simple
Il est venu avec le soir, les yeux se ferment, le souffle est profond
Dans la tête et dans les corps le lac s’est invité
L’oiseau s’est posé, le temps s’est ralenti
Maintenant il faut rentrer, les yeux vont se fermer, tout est apaisé

Ce soir c’est vers. Finie la pause prose, ce soir je vous prends à revers, ce soir je me pose, je prends un verre et je me mets aux vers. Je vous entends déjà : il nous dit qu’il se remet aux vers mais il reste en prose. Tout ça n’est peut-être que de la frime, de la frime pour trouver une rime. Alors attendons un peu…
La prose tout doucement s’essouffle.
Sans rien dire elle s’efface.
Prose s’envole
Un verre, puis deux
Les vers sont là
Dans le peuple des mots
Quelques-uns se sont levés
Ils tendent le point
Le point oublié
Mais plus rien ne compte
Les vers sont là
Suspendus
Aux lèvres mauves
De tes larmes bleues…

La révolte était devenue
Une autre décoration de combats intellectuels
Pour le snobisme
De ceux qui flirtaient avec l’angoisse
Du pauvre
Qu’ils achetaient
Chez les bradeurs d’inhumanité
Qui vendent
Du sourire aux enchères du sentiment
Et qui cultivent des jardins d’utilité
Des jardins de pitié
Pour le botin du beau monde
Qui pissent leur ba ba quotidien
En rotant la nuit qu’ils ont volée
Aux autres
Aux angoissés
Aux vrais
L’uniforme de leur porcherie
Leur fait peur
Parce qu’ils se sentent loin
Parce qu’ils se sentent loin
Alors ils trichent
Ils se déguisent
Ils prostituent la vérité
En l’obligeant à coucher
Avec ceux qui l’ont déjà tuée
En l’oubliant
Ils s’écologisent le dimanche
En se confessant à la rivière
Qu’ils assassinent à petites semaines
Mais y savent pas
Eux ils comptent
Eux ils produisent…
Juin 1980
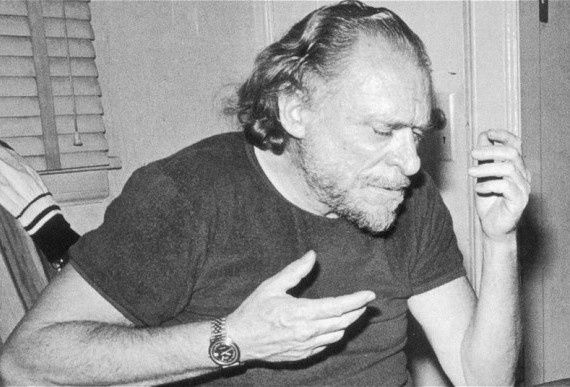
Ces choses
Ces choses auxquelles nous apportons tout notre soutien
n’ont rien à voir avec nous,
et nous nous en occupons
par ennui par peur par avidité
par manque d’intelligence ;
notre halo de lumière et notre bougie
sont minuscules,
si minuscules que nous ne le supportons pas,
nous nous débattons avec l’Idée
et perdons le Centre :
tout en cire mais sans la mèche,
et nous voyons des noms qui jadis signifièrent sagesse,
comme des panneaux indicateurs dans des villes fantômes,
et seules les tombes sont réelles.

C’était l’heure des sans amis
Penché vers un presque rien
Je voulais prendre ce chemin
Et rêvais d’y rencontrer les hommes
Aux doux regard paisibles
Qui rêvent de lendemains
Aux bords ronds et malins
J’ai marché jusqu’au dernier bout
Lointain
Oh si lointain
Elle était là
Seule et perdue
Vêtue d’une longue trainée de brume
Elle attendait en souriant
Je te savais
Tu le sais
Entre tes larges marges inventées
Je t’avais inventé

Aux quatre coins de sa mémoire
Homme silencieux
A gravé un souvenir heureux
Ils étaient deux
Ils étaient heureux

Regarde
Oh oui regarde
Lève les yeux
Oublie
L’ombre épaisse des mauvais rêves
De tes nuits agitées
Glisse
Penche-toi en riant
A la fenêtre des absents
Regarde
Oh oui regarde
La lumière est si belle
Elle s’étire doucement
Entre les tendres bras
Du matin des amants
Ecoute
Oh oui écoute
Tu l’entends te dire
Je t’attends…

Les paupières du matin s’ouvrent en crissant
Le sable de la nuit abîme le regard retrouvé
Oublié la fraîcheur des draps aux printemps insouciants
Je cherche dans la boîte un images le sourire du bel été

…Marcel et Jeanne sont restés plusieurs années à Narvik. Anton ne sait pas exactement ce qu’ils y ont fait. Vous êtes restés combien de temps là-bas ? Et la réponse, toujours la même…Plusieurs années. Comme s’il ne fallait pas compter, mesurer, encadrer. Le temps ne doit pas se mesurer Anton, le temps c’est de la vie qui passe, c’est de la vie qui enfle, de la vie qui souffre, de la vie qui rit, s’enflamme et parfois disparaît. Et cela ne se mesure pas. Dès que tu poses la question combien, tout est fini Anton, tu es fini, tu as fini. La mémoire qu’il nous reste de là-bas n’est pas gradué, elle est pleine, entière, avec des rondeurs, des zones un peu floues…
J’ai quasiment achevé mon nouveau roman, alors je me suis dit, tiens pourquoi pas proposer un extrait, comme ça, brut, un extrait pas retravaillé, un extrait que j’aime… Il y en aura peut-être d’autres.

… Je suis arrivée à l’heure de la journée que je préfère, ces heures de mai, qui s’étirent dans la douceur avec de la lumière plein les poches. Je suis arrivée dans ce bref moment où tout va se mélanger, se confondre. On est dans l’entre deux. Les arbres, mes arbres, tremblent à peine. Je sais qu’ils me voient, je sais qu’ils me sentent. Je suis sorti, je les écoute, j’entends ce qu’ils me disent. Et j’écris, je suis assise sur une pierre, elle est recouverte de mousse, j’ai sorti le cahier, le gros, celui où je raconte, celui où je me raconte. Je le pose bien à plat sur les genoux que j’ai serrés. J’aime le bruit que font les pages quand un souffle les soulève. Je pense aux arbres, au papier. Et j’écris quelques mots de plus. Je suis essoufflée, ce n’est pas le vélo, ce n’est pas la course pour venir jusqu’ici. Je suis essoufflée parce que je respire, je suis essoufflée parce que j’existe…
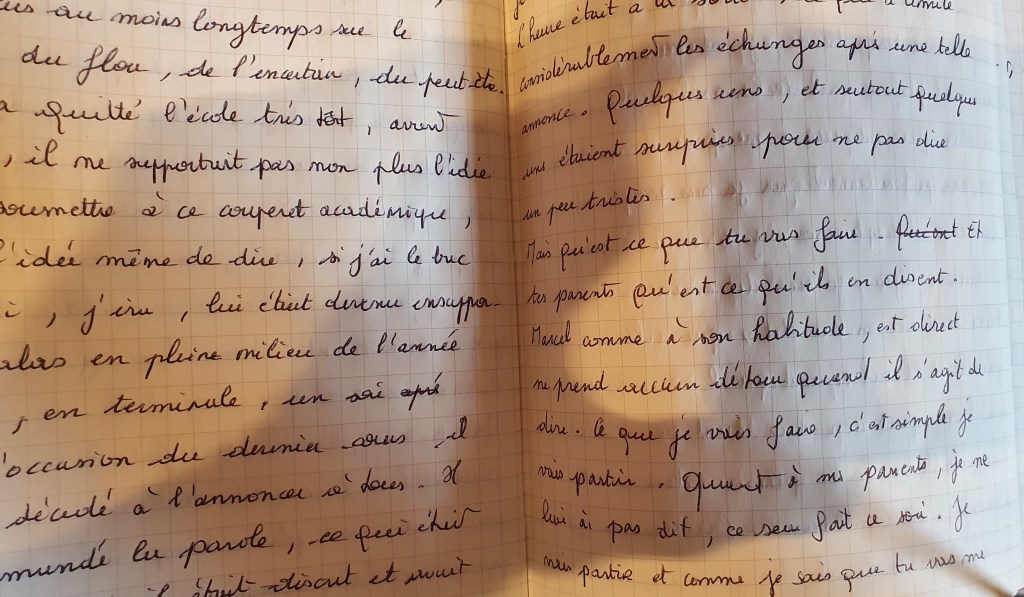
Les mots sont là, ils coulent, c’est un flot ininterrompu. Toutes les digues ont sauté. Je retrouve l’excitation de l’inspiration qui ne se contient plus. Je marche, j’écris, je dors, je rêve, j’écris. Les pages se noircissent, et l’épaisseur de l’encre qui sèche sur le papier produit comme un craquement. Mais ce n’est pas une feuille morte. J’aime tant que de la vie pensée vienne se poser sur le papier. C’est une magie dont je ne me lasse pas. L’histoire que j’écris avance, à grand pas, les personnages ont pris place, pas encore toute leur place, mais ils sont là, je commence à m’habituer à leur présence. Vous connaissez certains d’entre eux, j’ai à plusieurs reprises posé quelques bribes sur ce blog. Leurs contours se dessinent, je les aime, et redoute déjà le moment où la fin approchera. Mais le chemin est encore long…

« Écrire. Je ne peux pas.
Personne ne peut.
Il faut le dire, on ne peut pas.
Et on écrit.
C’est l’inconnu qu’on porte en soi écrire, c’est ça qui est atteint. C’est ça ou rien.
On peut parler d’une maladie de l’écrit.
Ce n’est pas simple ce que j’essaie de dire là, mais je crois qu’on peut s’y retrouver, camarades de tous les pays.
Il y a une folie d’écrire qui est en soi-même, une folie d’écrire furieuse mais ce n’est pas pour cela qu’on est dans la folie. Au contraire.
L’écriture c’est l’inconnu. Avant d’écrire, on ne sait rien de ce qu’on va écrire. Et en toute lucidité.
C’est l’inconnu de soi, de sa tête, de son corps. Ce n’est même pas une réflexion, écrire, c’est une sorte de faculté qu’on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, d’une autre personne qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui quelquefois, de son propre fait, est en danger d’en perdre la vie.
Si on savait quelque chose de ce qu’on va écrire, avant de le faire, avant d’écrire, on n’écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine.
Écrire, c’est tenter de savoir ce qu’on écrirait si on écrivait — on ne le sait qu’après — avant, c’est la question la plus dangereuse que l’on puisse se poser. Mais c’est la plus courante aussi.
L’écrit ça arrive comme le vent, c’est nu, c’est de l’encre, c’est l’écrit et ça passe comme rien d’autre ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie. »
1993

La terre et la mer se sont unies. Le bord a disparu, les côtes aussi.
Il s’est levé, s’est raclé un peu la gorge, a enfilé sa veste de toile épaisse, et a fini par sortir. Il est le seul à ne pas être étonné. Il vit sur les hauteurs. En bas la mer s’est arrêtée.
L’air n’est plus le même, il n’a plus cette rondeur en bouche quand on le respire, c’est un air qui coupe, un air qui réveille,
Son sac est prêt, depuis longtemps, depuis toujours, il savait qu’un jour viendrait, ou tout se rejoindrait. Il l’a soulevé, masse inerte, même les couleurs ont changé, le gris s’est essayé au bleu,
Tous les autres sont hagards, tous les autres se terrent apeurés de cette mer qui est venue jusqu’à eux. Ils ont peur et ne comprennent pas cette silhouette qui prend le chemin qui mène en bas jusqu’où leur regard distingue ce qui est devenu une rive. Il marche du pas sûr de celui qui sait où il va, de celui qui va prendre son quart. Il a pris son sac et il est parti, il sait que le voyage sera long il sait qu’il faudra qu’il trouve le passage pour rejoindre les mers de l’Ouest, il sait que ses cartes ne lui serviront pas ; il fera le point, à l’ancienne, comme on lui a appris.
Tout le monde avait été surpris quand il s’était rêvé marin, certains avaient ri d’autres avaient eu peur. On ne devient pas marin quand on est de la terre, quand on est de l’intérieur. Il leur avait répondu calmement qu’il en avait envie, c’est tout, qu’il en avait besoin et que de toute façon un jour la mer elle serait partout, il le savait, il l’attendait, alors il partirait. Il prendrait la mer, sur un bateau qui serait là pour l’attendre, lui, lui qui le savait depuis toujours.
Il est monté sur le pont, personne à bord, cela lui est égal, il va prendre le large.
Il part pour longtemps. Il est à la barre. Tout est un peu plus compliqué quand on est seul
« Dans ma mémoire de papier, une feuille blanche
Qui pleure, larmes de mots gris
J’entends la tempête à l’intérieur,
Le vent coule dans mes veines.
Dans mon ordre intérieur,
Pas une ligne droite, pas un battement de cil
Dans le désordre de mon cœur
Des sourires aux courbes bleues
Des mains qui se posent,
Les doigts qui s’effleurent,
Dans la bouillie de mes rêves
Tout est joie qui se pose »

Et chaque matin, toujours une petite déception
« Une humidité a l’odeur si épaisse qu’on a comme de la crème dans la bouche.
Le froid incapable d’être cinglant qui essaie simplement de s’infiltrer,
Et de traîner en longueur.
Pas une trace de lumière.
Les objets sont gavés de l’ombre qui les étouffe.
Et les gens qui passent,
La météo au pied, comme un boulet. Pas un qui ne rit, plus un qui ne vit, c’est un automne colonisateur.
Il est partout même dans les rires;
Feuilles jamais sèches qu’on piétine et qui restent collées, tristes, au pied.
Tout se traine
Tout se désespère,
Même la mer est habillée de gris,
Pour ne pas froisser un ciel si bas qui pourrait la gober.
Demain ce sera mieux,
Demain on sera heureux. »
Bien sûr il pouvait l’imaginer et ne s’en privait pas.
Il se souvenait de ce que disait son père quand il parlait de la mer, quand il l’écrivait. Cette mer, sa mer à lui, elle était partout, dans le souffle des pins poussés par le vent, dans la brume du matin. Cette mer elle était dans le ciel qui s’affaisse, épuisé d’être scruté pour annoncer le meilleur. La mer, elle était dans le regard des enfants qui montrent du doigt, elle était dans l’étonnement, dans l’inattendu de ce qu’on découvre à la sortie d’un virage ; la mer elle était dans les odeurs, dans les couleurs, dans la musique qu’il avait dans la tête en fermant les yeux.
Pourquoi la mer ne serait réservée qu’aux hommes et femmes des côtes… La mer n’appartient pas aux seuls qui tous les jours à force de la voir ne finissent par ne plus la regarder. Ils la voient et ils finissent par l’oublier, ils finissent par l’intégrer. La mer elle vit d’abord dans la mémoire, elle est là au fond de nous. La mer, il l’avait en lui, il l’avait dans le regard. La mer on lui en parlait, la mer il en parlait parfois, elle glissait au bout de ses doigts elle montait jusqu’au bord de ses lèvres, jusqu’à la fleur de ses yeux et les mots mélodie, respiraient, soulagès de sortir de leur ordres alphabétiques.
Il avait grandi et son regard avait cette profondeur qu’ont ceux qu’on imagine ailleurs. Il avait grandi et la mer n’était pas encore venu jusqu’à lui.
Alors la mer il l’a chanté :
« Regarde la mer, regarde petite.
Regarde, elle est grise
Elle est grise des restes de la nuit
Regarde là sous le vent qui divague
Elle a l’écume qui enrage
Regarde la mer et ses cent vagues
Regarde la mer et sens ses vagues
Elle a revêtu ses couleurs de femme seule
Et s’étire à s’en faire mal
Sur le quai il y a un homme qui pleure
Il écoute le chant des vents
Et entend la plainte qui se répand
Et le ciel cruel, qui dégouline des oiseaux crieurs
Il y a un homme seul qui cherche le passage
Trou de lumière pour un soleil prochain
Regarde- le, regarde petite
Il a une larme qui attend la marée
Un peu de sable dans la bouche
Et du sel séché au coin du sourire
Ses yeux se plissent à suivre le mouvement de la mer qui l’avale.
Et derrière le bout du rien, là- bas, il y a l’horizon
C’est comme un trou qu’on devine
Un trou que la mer rapporte à chaque vague
Et l’homme dit à la mer qu’il sait
Qu’elle se souviendra. »
C’était un soir, un soir que novembre choisit pour peser de toute sa mélancolie, il a pris sa guitare, et les premiers embruns sont entrés dans la pièce. A chaque note ajoutée, les gorges se serraient, les yeux piquaient. Le sel des larmes alourdit les paupières, la mémoire est revenue.
Il chante, les mots sont ronds, ils roulent comme une houle d’automne, on entend comme un rythme à deux temps. Les yeux des autres se ferment, les siens se plissent, ils entament le voyage, un voyage ailleurs, là-bas, de l’autre côté. Avec la mer il y a toujours l’autre côté. Il chante, il murmure plutôt et tout autour de lui les lignes droites soupirent épuisées de leurs rectitudes imposées, soudain la douceur les éveille.
Dehors la fraîcheur enrobe les sons et les formes, on ferme les yeux, le vent du nord ne glace plus, il est une caresse, les cols des vestes se remontent, les épaules se creusent, les pas sont lourds mais décidés. La musique poursuit sa route, le monde des autres se transforme.
Je publie aujourd’hui la première partie d’une nouvelle que j’ai écrite il y a 10 ans…Toujours à l’occasion de l’anniversaire d’un de mes enfants…

C’est un voilier qui hésite encore entre la voile d’hier, faite de bois et de cordes qui sentent la paille, et la voile de demain faite de matériaux lisses, et de cordages qui sentent le plastique. C’est un bateau qui hésite, entre deux, il a du gris dans les rares couleurs que le soleil lui a laissées, un gris qui parle des marées, un gris qui parle des pluies d’hiver qui déchire le bleu de la mer. A bord sur le pont, encombré de tous ces objets qui parlent vrai tant ils sont usés, un homme se déplace lentement. Chaque chose qu’il touche semble le remercier. Il n’est pas comme les autres, il semble déjà un peu plus loin, son regard ne se disperse pas, son regard est à ce qu’il fait.
Sur le pont l’homme, c’est un jeune homme d’environ 25 ans, se prépare pour le départ, il est arrivé tout à l’heure, sans bruit, pour ne rien dire pour ne pas parler d’où il vient pour ne pas utiliser de mots qui n’ont plus de sens que pour lui.
Il n’aime pas qu’on lui pose de questions, il n’aime pas qu’on cherche à savoir. Son histoire ne doit intéresser personne, il ne le veut pas.
Il est parti, il a mis le cap vers le nord, avec le vent de face, toujours, un vent rasoir et il serrait les dents, pour ne pas faiblir, pour ne pas se poser de questions. Il était parti un matin tout simplement et quand il a posé la main sur la barre en sortant du bras de mer il savait qu’il ne parlerait plus, il avait tant à faire, tant à se dire à l’intérieur.
« Il a ouvert son livre intérieur pour y ajouter quelques pages.
L’encre ne sèche plus, elle est le sang des mots
Ils s’échappent quand la lumière les éveille,
Mots qui s’envolent, plus rien ne les retient
Dans le vent qui les attend, quelques grains de lumière,
Les yeux les lisent, le regard se plisse
Et le cœur qui s’affole, on est bien
Pas un son qui ne s’essaie au bruit
Tout est dans la mélodie, les notes s’enroulent
Autour des mots, il flotte comme un doux rien de légèreté »
La France est un des pays qui bénéficie de l’une des plus importantes façades maritimes, des milliers de kilomètres de côtes, parfois découpées, torturées, tranchantes parfois rectilignes, monotones plus rarement. On appelle cela le bord de mer, la façade c’est pas mal aussi. Ça peut être beau une façade, mais ce qui est gênant c’est qu’on ne la voit que de l’extérieur. De l’intérieur, quand on est derrière on ne voit rien, on suppose, on devine. C’est pour cette raison qu’on parle de l’arrière-pays, de l’intérieur ou même des terres. Quand on est de l’intérieur, quand on vient des terres on est considéré comme un étranger.
Et quand on est de l’intérieur, dans un arrière-pays privé de ces fenêtres bleues, on n’aurait seulement le droit de rêver, d’imaginer. Pour se rapprocher pour y avoir droit, il faut prendre la route : il faut entrer dans la transhumance.
Injuste, trop injuste : depuis son plus jeune âge il ne l’admettait pas, il voulait que la mer vienne jusqu’à lui, qu’elle soit aussi sous ses fenêtres. Et chaque matin quand il ouvrait les volets il y avait un petit espoir, infime certes mais un espoir quand même. Peut-être, peut-être dans la nuit l’incroyable se sera produit, et ce matin ce n’est pas la petite vallée boisée qu’il distinguera mais un bras de mer.
Parmi les pauses lecture que je m’accorde pendant mon chantier d’écriture, il y a eu ce magnifique roman de Grégoire Delacourt. L’extrait que je vous propose est comment dire d’une intensité poétique qui me provoque des vibrations.

/… Sa famille.
Des cultivateurs dans le Cambrésis. Vingt hectares de lecture fourragère. Quelques bêtes. Des nuits de peu d’heures, des mains usées, des ongles noirs, comme des griffes, la peau tannée, un vieux cuir craquelé. Jamais de vacances, jamais de premier mai parfumé au muguet ; la terre, toujours, la terre exigeante, capricieuse ; et la mer, une fois, une seule, pour mes sept ans, a-t-il précisé, mais pas vraiment la mer, une plage plutôt, celle des Argales, à Rieulay, du sable fin au bord d’un lac artificiel sur un ancien terril ; mes parents n’avaient pas voulu me décevoir : ils avaient dit qu’il n’y avait pas de vagues ce jour là, une histoire de lune, de planètes, je ne sais plus, et je les avais bien crus, bien que l’eau ne soit pas salée, ah ça ! disait mon père à propos du sel, ça dépend des courants, des marées et même de la lune, André, c’est très compliqué, tu sais, tout ce bazar, et plus tard j’ai compris qu’ils avaient voulu m’écrire une histoire unique, m’enseigner que l’imagination fait advenir tous les voyages, exhausse toutes les enfances. Ils ne se plaignaient jamais, ni du gel ni des pluies qui pourrissaient tout ; ils sillonnaient et façonnaient la terre comme des sculpteurs, comme des amants ; ils lui parlaient, ils la remerciaient les jours de grande récoltes , la consolaient lorsque le froid la fendillait et la gerçait ; ils aimaient que le temps marque les choses. Ils attendaient les printemps comme on attend un pardon. /…

Entre la grise rive de l’absence
Et la mauve douceur du silence
Je m’accroche au bleu soleil
Des souvenirs qui fabriquent du demain…

Toujours ce flou
Aux angles morts d’une mémoire en jachère
Alors on creuse
On retourne la terre sèche du vieux souvenir enfoui
Et la foule des errants se presse
Aux portes du sourire de ces hiers vivants…

L’homme est courbé,
Son dur regard racle le sol.
Lever les yeux ?
Il ne le veut pas,
Il ne le peut plus.
L’homme est triste,
Il marche
Sur le fil gris de la peur.
Il tire sur les manches de la douleur,
Soudain,
Merle siffle ;
L’homme déplie un bout de sourire,
Essuie la buée de ses larmes bleues,
Bouée est là, ronde et fleurie.
Elle est pour lui
Il la serre,
Tout est fini.

Dans l’erreur de déclenchement
Parfois l’incompréhensible beauté
Clin d’œil du hasard
Habillé de rien
Sorti d’un nulle part
Où le gris invite les mauves oubliés
A valser au son d’une fanfare de cuivres fous
Je sais des matins aux rires retenus
Qui attendent qu’on ne leur dise rien

Les jours rallongent…
Oui, c’est vrai, je le constate aujourd’hui encore, les jours rallongent. Pourquoi d’ailleurs ne pas se contenter de dire qu’ils sont plus longs où qu’ils s’allongent (même si comme moi vous aurez constaté que les jours, ou plutôt les journées continuent éternellement d’avoir 24 heures…). Pourquoi ajouter une fois de plus ce préfixe répétitif qui racle la gorge. Vous remarquerez d’ailleurs que je n’ai pas parlé de rajouter, parce que convenons-en, un ajout est bien suffisant et ne prenons pas le risque de sombrer dans le bégaiement. Rallonger, allonger, je m’interroge : après tout une allonge ou une rallonge ce n’est pas exactement la même chose. Quand on me parle d’allonge j’étire le bras et je pense aux boxeurs, et quand on me parle de rallonge je cherche une prise et je vois un câble électrique. Ce câble qu’on ajoute quand le cordon est trop court et qu’on veut éclairer avec une torche par exemple, un peu plus loin, là où il fait sombre. Et en effet dans ce cas on ne peut que constater que grâce à la rallonge on allonge le jour ou tout au moins on l’éloigne un peu, mais par contre on ne parvient pas à le faire durer plus longtemps car il arrive toujours un moment ou tout devient trop long (comme ce texte d’ailleurs ), un peu comme un long jour sans fin.
Mais une fois de plus je m’égare et la nuit bien qu’elle soit moins longue est déjà tombée.
Tiens tiens voilà autre chose, la nuit est tombée…

Dans le jardin des mémoires de demain
J’ai semé un vieux fond de graines de rires faciles
C’est la bonne saison
Je le sais je le sens
C’est le temps
Le temps si rond si long
De la bonne raison
Il le faut on attend
Regarde
Les granges débordent de molles pailles
Oubliées de vieilles moissons
Entends les pleurs des rides sèches de la terre
Aux prochains soleils levés
Tu cueilleras ta première fleur au sourire câlin…

Rêve à finir
C’est une guerre où les hommes périront
Systématisés
Calcinés
Par l’addition
D’une angoisse planétaire
Qui les fait
Terreurs

Ne laisse pas le soin de gouverner ton cœur à ces tendresses parentes de l’automne auquel elles empruntent sa placide allure et son affable agonie. L’œil est précoce à se plisser. La souffrance connaît peu de mots. Préfère te coucher sans fardeau: tu rêveras du lendemain et ton lit te sera léger. Tu rêveras que ta maison n’a plus de vitres. Tu es impatient de t’unir au vent, au vent qui parcourt une année en une nuit. D’autres chanteront l’incorporation mélodieuse, les chairs qui ne personnifient plus que la sorcellerie du sablier. Tu condamneras la gratitude qui se répète. Plus tard, on t’identifiera à quelque géant désagrégé, seigneur de l’impossible.
Pourtant.
Tu n’as fait qu’augmenter le poids de ta nuit. Tu es retourné à la pêche aux murailles, à la canicule sans été. Tu es furieux contre ton amour au centre d’une entente qui s’affole. Songe à la maison parfaite que tu ne verras jamais monter. A quand la récolte de l’abîme? Mais tu as crevé les yeux du lion. Tu crois voir passer la beauté au-dessus des lavandes noires…
Qu’est-ce qui t’a hissé, une fois encore, un peu plus haut, sans te convaincre?
Il n’y a pas de siège pur.

L’homme est heureux,
Il le dit, il le rit.
Autour de lui,
Pas un œil qui ne luit.
L’homme est heureux
Son cœur bat pour deux
« Je vais marcher,
Il le faut, c’est si beau. »
« Je vais marcher,
Et lèverais les yeux. »
L’homme inspire,
L’air est si frais,
L’homme s’emplit de vrai…
Il faut attendre lui dit-on
L’heure n’est pas aux rêves creux ;
Il faut entendre le souffle fatigué
D’un bleu délavé, lessivé
Par la basse marée.
L’homme n’écoute pas,
L’homme est heureux.

Le ciel est au plus bas,
Lourd d’un gris épais.
Il pèse sur les épaules rentrées,
Des quelques ceux qui errent
A la recherche d’un printemps
Que quelques oiseaux impatients
Ont appelé en sifflotant…

Au matin qui s’ennuie,
Fleuve ne frissonne plus,
Sans un flot, lisse et nu
Fleuve entre dans la ville.
Si loin le chant de la source,
Si loin la caresse blanche
De l’eau claire qui jaillit.
Tout est oublié,
Fleuve se laisse aller,
Entre deux rives rêches
Sa mémoire de brume mauve,
Il a abandonné.

J’ai grandi dans la mer et la pauvreté m’a été fastueuse, puis j’ai perdu la mer, tous les luxes alors m’ont paru gris, la misère intolérable. Depuis, j’attends. J’attends les navires du retour, la maison des eaux, le jour limpide. Je patiente, je suis poli de toutes mes forces. On me voit passer dans de belles rues savantes, j’admire les paysages, j’applaudis comme tout le monde, je donne la main, ce n’est pas moi qui parle. On me loue, je rêve un peu, on m’offense, je m’étonne à peine. Puis j’oublie et souris à qui m’outrage, ou je salue trop courtoisement celui que j’aime. Que faire si je n’ai de mémoire que pour une seule image ? On me somme enfin de dire qui je suis. « Rien encore, rien encore… »
C’est aux enterrements que je me surpasse. J’excelle vraiment. Je marche d’un pas lent dans des banlieues fleuries de ferrailles, j’emprunte de larges allées, plantées d’arbres de ciment, et qui conduisent à des trous de terre froide. Là, sous le pansement à peine rougi du ciel, je regarde de hardis compagnons inhumer mes amis par trois mètres de fond. La fleur qu’une main glaiseuse me tend alors, si je la jette, elle ne manque jamais la fosse. J’ai la piété précise, l’émotion exacte, la nuque convenablement inclinée. On admire que mes paroles soient justes. Mais je n’ai pas de mérite : j’attends.
Albert Camus, L’Été, « La mer au plus près (Journal de bord) »

Homme d’en haut qui invente la mer,
Homme d’en haut, dans les yeux, le bleu c’est beau.
L’homme d’en haut aime la mer à mi mots.
Dans l’écume de ses rêves, des mots salés
L’homme d’en haut plisse les paupières,
Et des vagues à l’âme creuse les joues de l’homme d’en haut.
Sillons creusés par les larmes,
Creusent la vallée de ce visage lame.
Quand les yeux se ferment, quand le regard creuse l’intérieur,
Il a la mer qui remonte, la mer sur le front, vague ride d’un homme d’en haut.
C’est si beau l’âme d’un homme d’en haut.
C’est si beau l’âme d’en haut, amarrée au port du bas.
Avec un ciel si bleu que larmes d’en haut roulent,
Perles qui brillent,
Jusqu’aux vagues d’en bas.

Quand surgit le soir,
Sur l’île Île de Tioman,
Te revient le mot firmament.
Ouvre les yeux.
Invite ton arc en ciel,
Oh oui !
Invite le à se poser.
Sur la douce palette
De tes paupières bleutées.
Oublie le rayon glacial,
Des cartes postales
Où défilent de pâles soleils
Lessivés, desséchés,
Amputés des lueurs
Qu’ils ont tentées
D’arracher aux chaleurs
D’une journée aux blancheurs
Qui crépitent.
Plus un bruit,
Plus une ride,
La mer s’est apaisée.
Regarde, il est beau
Regarde le :
C’est le ciel d’Orient…

Je garde au fond de ma réserve à souvenirs
Un reste de soir d’été
C’était hier, c’était il y a loin
L’océan ne disait plus rien
Lassé d’une longue journée
A inventer des vacances
Pour les ceux qui rêvaient de bleus
Le ciel l’avait rejoint
Et dans les bras envasés
De la terre endormie
Ils s’étaient aimés
Pour une seule et longue nuit

Le loup n’a plus de dents, il mange des idées ;
À la radio il nous commente les nouvelles :
As-tu vu ce matin mourir une chandelle ?
Cette étoile de cire où meurent des années…
Il en va de l’espoir comme d’un tapis de vert.
Usé, l’espoir déçu se trame une autre chaîne
Sur les brisées de ceux qui portent de la laine.
En guise de moutons le loup va prendre l’air ;
Je sais de vieux sapins qui n’ont pas leur raison,
Ils fleurissent des jours, des mois, des parenthèses.
Je sais des paradis perchés sur une chaise
À scruter sous la pluie un désir de pardon…
Les arbres sont polis quand j’y passe mon cœur,
Je me les fais copains d’une ancienne habitude,
Et mes racines se mêlant à leur étude,
Quand je deviens forêt ils deviennent malheur.
Je suis le chêne blond d’un automne déçu,
Des perdrix pour la chasse ont mis leur feu arrière,
Les chansons de l’été des grillons de naguère
Grillent dans le phono vers l’Ouest descendu.

…C’est un voilier qui hésite encore entre la voile d’hier, faite de bois et de cordes qui sentent la paille et la voile de demain faite de matériaux lisses, et de cordages qui sentent le plastique. C’est un bateau qui hésite, entre deux, il a du gris dans les rares couleurs que le soleil lui a laissé, un gris qui parle des marées, un gris qui parle des pluies d’hiver qui déchire le bleu de la mer. A bord sur le pont, encombré de tous ces objets qui parlent vrai tant ils sont usés, un homme se déplace lentement. Chaque chose qu’il touche semble le remercier. Il n’est pas comme les autres, il semble déjà un peu plus loin, son regard ne se disperse pas, son regard est à ce qu’il fait. Les autres, ceux qui virevoltent sur des bateaux de catalogue ont les yeux absents, on ne les devine même pas derrière des verres de marques ou se reflètent des couleurs qui n’existent que pour les touristes canonisés. Sur le pont, l’homme sans lunettes se prépare pour le départ. Arrivé hier soir, sans bruit, il a cherché un mouillage éloigné des autres pour ne rien dire, pour ne pas parler d’où il vient, pour ne pas utiliser de mots qui n’ont pas de sens pour lui. Les autres, lorsqu’ils sont au port aiment à raconter, se raconter, l’homme au navire sans âge n’est pas de ceux-là. Il ne se mêle pas à la vie du port. Il ne les méprise pas, il lui arrive même parfois de les écouter, de s’emplir de leurs rires pour s’en faire une couverture, douillette pour la nuit. Il ne les méprise pas, mais il n’aime pas qu’on pose de questions, il n’aime pas qu’on cherche à savoir. Son histoire ne doit intéresser personne, il ne le veut pas. Il se souvient, lorsqu’il est parti, il a mis le cap vers le nord, avec le vent de face. C’était un vent coupant et lui serrait les dents, pour ne pas faiblir, pour ne pas se poser de questions. Il était parti un matin tout simplement et quand il avait posé la main sur la barre en sortant du port de Concarneau, il savait qu’il ne parlerait plus, il avait tant à faire, tant à se dire à l’intérieur…

Fatiguée d’une si longue marée,
Tout doucement la mer s’est assoupie.
Entre les bras de la terre elle s’est endormie.
Lente et longue,
Etirée reposée,
Dans la chair de la côte,
Elle est entrée.
Regarde les gris qui se rencontrent
Le ciel est bas, il s’approche
Pour les entendre s’aimer.
Entre ciel et mer,
La terre s’est apaisée.
Entre terre et mer,
Le ciel a gonflé ses voiles de brume.
Et dans la lumière qui sombre
Engloutie par cette fin d’après midi
Sans un bruit, sur la rive ourlée
D’un sable qui crisse
Ecoute leurs pas qui glissent.
Écoute-les, ils se sont aimés.

Ecoute petit homme,
Ecoute.
Il est si beau ce monde qui ne dit rien.
Il est si beau ce monde,
Il te parle, c’est le tien.
Regarde petit homme heureux,
Regarde ces furieux,
Fanatiques, frénétiques,
Ils ont le cœur électrique.
Ils préparent la prière,
Hymne cathodique
Aux rimes numériques,
C’est le matin du malin.
Nuques raides, regards vides,
Les impatients sont livides,
Epuisés, lessivés,
Un long sommeil les a lavés.
Ô Nuit blanche et câline,
Ne t’épuise plus à blanchir
Ces haines rances à mourir.
Semées sur l’écran creux
De leurs rêves sans bleu.
La nuit les a libérés.
Il est l’heure,
Affamés, ils attendent
La victime par eux condamnée.
Leurs mots sont prêts
Ils vibrent, affutés, aiguisés,
Ils vont frapper !
Pas un regard pour ton monde qui sourit.
Ils attendent leurs matins numériques.
Rien ne brille, rien ne bouge.
Hystériques ils cliquent, ils cliquent,
Ils cliquent.
Et ce matin, petit homme,
C’est une claque,
Une claque pour les creux.
Les écrans sont lisses et vides.
Les nouvelles du jour ?
Parties, envolées, manipulées, falsifiées ?
Que va-t-on devenir, on est seul, isolés…
Le monde les voit
Il pleure de cette embolie
Il rit de cette folie
Mais cette nuit, petit homme,
Le monde a agi.
Le monde ne regrette rien
Il le fallait, il l’a fait.
C’est si simple,
Petit homme
La poubelle était pleine,
Le monde l’a vidée,
Et dehors l’a laissée
26 janvier 2020

Je suis dans ma chambre, à ma petite table devant la fenêtre. Je trace des mots avec ma plume trempée dans l’encre rouge… je vois bien qu’ils ne sont pas pareils aux vrais mots des livres… ils sont comme déformés, comme un peu infirmes… En voici un tout vacillant, mal assuré, je dois le placer… ici peut-être… non, là… mais je me demande… j’ai dû me tromper… il n’a pas l’air de bien s’accorder avec les autres, ces mots qui vivent ailleurs.., j’ai été les chercher loin de chez moi et je les ai ramenés ici, mais je ne sais pas ce qui est bon pour eux, je ne connais pas leurs habitudes…
Les mots de chez moi, des mots solides que je connais bien, que j’ai disposés, ici et là, parmi ces étrangers, ont un air gauche, emprunté, un peu ridicule… on dirait des gens transportés dans un pays inconnu, dans une société dont ils n’ont pas appris les usages, ils ne savent pas comment se comporter, ils ne savent plus très bien qui ils sont…
Et moi je suis comme eux, je me suis égarée, j’erre dans des lieux que je n’ai jamais habités… je ne connais pas du tout ce pâle jeune homme aux boucles blondes, allongé près d’une fenêtre d’où il voit les montagnes du Caucase… Il tousse et du sang apparaît sur le mouchoir qu’il porte à ses lèvres… Il ne pourra pas survivre aux premiers souffles du printemps… Je n’ai jamais été proche un seul instant de cette princesse géorgienne coiffée d’une toque de velours rouge d’où flotte un long voile blanc… Elle est enlevée par un djiguite sanglé dans sa tunique noire… une cartouchière bombe chaque côté de sa poitrine…je m’efforce de les rattraper quand ils s’enfuient sur un coursier… « fougueux »… je lance sur lui ce mot… un mot qui me paraît avoir un drôle d’aspect, un peu inquiétant, mais tant pis… ils fuient à travers les gorges, les défilés, portés par un coursier fougueux… ils murmurent des serments d’amour.., c’est cela qu’il leur faut… elle se serre contre lui… Sous son voile blanc ses cheveux noirs flottent jusqu’à sa taille de guêpe…
Je ne me sens pas très bien auprès d’eux, ils m’intimident.., mais ça ne fait rien, je dois les accueillir le mieux que je peux, c’est ici qu’ils doivent vivre.., dans un roman… dans mon roman, j’en écris un, moi aussi, et il faut que je reste ici avec eux… avec ce jeune homme qui mourra au printemps, avec la princesse enlevée par le djiguite… et encore avec cette vieille sorcière aux mèches grises pendantes, aux doigts crochus, assise auprès du feu, qui leur prédit… et d’autres encore qui se présentent…
Je me tends vers eux… je m’efforce avec mes faibles mots hésitants de m’approcher d’eux plus près, tout près, de les tâter, de les manier… Mais ils sont rigides et lisses, glacés… on dirait qu’ils ont été découpés dans des feuilles de métal clinquant… j’ai beau essayer, il n’y a rien à faire, ils restent toujours pareils, leurs surfaces glissantes miroitent, scintillent… ils sont comme ensorcelés.
À moi aussi un sort a été jeté, je suis envoûtée, je suis enfermée ici avec eux, dans ce roman, il m’est impossible d’en sortir…
Et voilà que ces paroles magiques… « Avant de se mettre à écrire un roman, il faut apprendre l’orthographe » … rompent le charme et me délivrent.
Extrait de « l’enfance »

Vagues
« Une vague, les vagues, une déferlante… » Je crois que c’en est trop, je n’en peux plus et allez je vous le dis j’ai du mal avec ces mots, ces mots que j’aime, qui sont abîmés, salis, trahis plusieurs fois par jour. Oh bien sûr je connais plus que tout autre le pouvoir des mots, de ce qu’ils évoquent, de ce qu’ils convoquent, de ce qu’ils invoquent. Mais il y a des jours où je n’en peux plus de voir, d’entendre toutes ces vagues épidémiques et numériques, se répandre sans retenue dans la longue plaine de mes inspirations. Je vous en prie laissez les vagues dans l’océan, laissez la mer nous enivrer de son flux, de son reflux, laissez les déferlantes à la tempête. Un peu d’effort je vous en prie cherchez dans votre dictionnaire de l’angoisse cathodique d’autres mots, d’autres images, laissez les courbes en paix, ne cherchez pas d’autres rimes aux graphiques.
Et je vous suggère d’essayer la retenue, le silence, et peut-être d’aller marcher au bord de cette mer que vous voudriez me voler…

Pas une ride sur la plaine de mes mers du dedans
A la marée montante de mes inspirations
On entend le chant du dernier oiseau
Il siffle la fin du dernier couplet
Je le vois seul et sans rime
Dans le dernier souffle creux de mon vague à l’âme
J’illustre ce texte écrit il y a une vingtaine d’années par un tableau peint par mon père…

C’était la guerre froide entre la brume et le port. On ne se souvenait même plus de quand datait le dernier rayon de fausse lumière. On ne devinait le jour qu’à une impression générale qui flottait à la surface des eaux. Les chalutiers étaient contraints d’utiliser leurs couleurs comme des signes particuliers, accrochés à leur identité d’embarcation. Toutes les berges, toutes les coques avaient le teint blafard, piqués de bruns et d’embruns, indices d’une angoisse qui se lève avec le jour. Le bout du port, gueule ouverte, crachait périodiquement ses coquilles de noix. Il avait l’attrait d’un goulot de bouteille où toutes les lèvres salées des compagnons de port se seraient posées.
Cette flaque d’eau était posée au milieu de la ville, comme une cicatrice sur un visage burinée de soleil et de siècles. La ville n’était pas un port, la ville était un empiècement de croûte sombre qui s’étendait autour. Les rues n’avaient point d’origine, elles étaient là, pour marquer l’appartenance à un système urbain. Mais ces associations de réalités qu’on aurait cru naturelles ne parvenait à donner à ce paysage que l’apparence lointaine d’une ville. La brume elle-même ne parvenait pas à adoucir les traits d’une ou deux maisons à la lourdeur extrême.
Derrière chacune de ces façades épuisées d’être fouettées par les vents salés, il y avait des symptômes de vie, d’imperceptibles indices de société. A quelques fenêtres se tenaient en berne quelques bouts de chiffons. Des cheminées sortes des bouffées de vapeur. Les maisons se touchent très forts, on les croirait enlacées, pour se tenir chaud, pour oublier la peur, le vide de ceux qui ne reviennent pas. Parfois on aperçoit une ombre ou deux, elles se faufilent, et disparaissent aux angles ronds des rues noyées des brumes océanes.
Derrière la vitre crasseuse, que ce bout de port qui se prend pour un tableau de peintre mélancolique, ses yeux ne parviennent plus à fixer le paysage. C’est le paysage qui est en lui et qui donne à ses yeux cette lueur intérieure. On dirait qu’il scrute une terre, une terre qui ne viendra plus. Ses yeux ont été cloués à l’envers. Il voit de l’intérieur, l’intérieur de ce pourquoi il est né…

Au printemps, Tipasa est habitée par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. A certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent au bord des cils. L’odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. A peine, au fond du paysage, puis-je voir la masse noire du Chenoua qui prend racine dans les collines autour du village, et s’ébranle d’un rythme sûr et pesant pour aller s’accroupir dans la mer.
Nous arrivons par le village qui s’ouvre déjà sur la baie. Nous entrons dans un monde jaune et bleu où nous accueille le soupir odorant et âcre de la terre d’été en Algérie. Partout, des bougainvillées rosat dépassent les murs des villas; dans les jardins, des hibiscus au rouge encore pâle, une profusion de roses thé épaisses comme de la crème et de délicates bordures de longs iris bleus. Toutes les pierres sont chaudes. A l’heure où nous descendons de l’autobus couleur de bouton d’or, les bouchers dans leurs voitures rouges font leur tournée matinale et les sonneries de leurs trompettes appellent les habitants.
A gauche du port, un escalier de pierres sèches mène aux ruines, parmi les lentisques et les genêts. Le chemin passe devant un petit phare pour plonger ensuite en pleine campagne. Déjà, au pied de ce phare, de grosses plantes grasses aux fleurs violettes, jaunes et rouges, descendent vers les premiers rochers que la mer suce avec un bruit de baisers. Debout dans le vent léger, sous le soleil qui nous chauffe un seul côté du visage, nous regardons la lumière descendre du ciel, la mer sans une ride, et le sourire de ses dents éclatantes. Avant d’entrer dans le royaume des ruines, pour la dernière fois nous sommes spectateurs.
Exrait de Noces à Tipasa, écrit par Camus en 1937…

Vêtue de son manteau de drame gris
La pluie est là, elle n’était pas invitée…
C’est bien lui, lourd mardi maudit,
Dans longues rimes de novembre empêtrés
Qui a osé la convoquer dans le dernier souffle du midi.
« Je ne veux pas que joie sente des ailes lui pousser,
Petite ou drue, Ô pluie, reviens je t’en prie. »
Mais pluie têtue a résisté et son sourire lumineux
Sur chaque flaque a posé petites perles bleues..
13 MAI

Oui il faut garder espoir. Je veux bien, mais ce que je voudrais savoir, comprendre, concernant cet espoir que l’on me demande de garder, c’est où je dois le mettre, est ce qu’il faudra un jour que je le rende à celle ou celui qui m’a demandé de le garder. Peut-être faut-il le garder pour le laisser vieillir, se bonifier et faire d’un faux espoir, un vrai espoir, un espoir tout court. Mais s’il est trop court je serai vite déçu et alors je risque de ne plus avoir d’espoir en réserve. En fait pour être sincère je ne sais pas trop qu’en faire de cet espoir que l’on me demande de garder, moi j’aurai envie de le partager, et de le transformer en présent, en vérité.
Parce que c’est cela l’espoir.

Dans le compartiment, il y a cette odeur, unique, qui s’accroche aux vêtements. Une odeur de voyages, trop courts, pour que la sueur soit absorbée par les souvenirs touristiques. Une odeur de vitre propre, de soupirs fatigués, une odeur de vie qui est à la peine, pour s’approcher de ce dont on rêve quand on est la tête contre la vitre. On ressent les vibrations, et puis il y a l’humidité de l’haleine qui fait comme un voile. Le voyage contre la vitre peut commencer, les yeux qui se ferment et le skaï devient cuir sauvage. Les néons ferroviaires sont des reflets de lune sur l’eau, pas un son, pas une voix qui ne troublent le rien d’un songe qui cherche son issue. Comme une musique, comme une mélodie. Et le couple d’en face, si vieux, si bons, qui posent leurs yeux sur la main de l’autre, pour signifier leur amour. Ils sont si beaux, si vrais, avec des souvenirs en réserve, pour chaque aiguillage, des regards croisés. Le front fait corps contre la vitre, les vibrations se font plus douces, le couple est comme un bouquet. Plus loin des jeunes filles rient, elles sont heureuses, heureuses de leurs sens, de ce qu’elles disent, de ce qu’elles montrent aux regards des peureux du bonheur. Elles batifolent, de mots en mots, d’histoires banales en tranches de vie. Et leurs rires nous réchauffent dans ce temps qui ne fait que passer.

Au mur gris de mes angoisses
Tu accroches des restes de mémoires colorées
Entends le tumulte tintant
Le murmure aimant et la folle gaieté
C’est l’arrière pays de ma tête
Où dansent et chantent les amis
17 mai
Sur le chemin de mes inspirations je jette parfois quelques cailloux en prose. Réflexions, interrogations, que sais-je, elles traversent furtivement, je les saisis au passage. C’est tout…

Et si nous prenions le temps.
Oui c’est cela qu’il nous faut : prendre le temps ; le prendre avec envie, avec désir, avec tendresse. On oublie parfois que dans une expression comme celle-ci le choix des mots est essentiel : il n’est jamais le fruit du hasard. Pourquoi prendre le temps ? S’agit-il de le prendre, de le saisir, de le tenir contre soi charnellement, pour qu’il se sente bien, en sécurité. Prendre le temps contre soi, c’est peut-être comme prendre la main, prendre comme serrer, embrasser, étreindre, caresser aimer…Le temps passe, coule, s’enfuit. Il faut le retenir ! Oh non pas pour stopper sa longue marche inéluctable mais simplement pour le sentir, le ressentir, entendre le battement de son cœur.
Oui je veux prendre le temps
Spéciale dédicace à Barbara Auzou aujourd’hui, ses textes matinaux sont un souffle d’inspiration dans le creux de mon oreille…. Merci à elle

Le combat sera rude ce matin
A ma gauche rêveuse fragile fleur des fossés
A ma droite ferreuse train bleu veuf de mer
L’une brille et vacille
Rouge bonheur
L’autre grince et crisse
Bleu pâleur
Mon œil tendre et reposé
S’est fait une beauté
Au doux miroir des mots de Barbara
Ce matin je ne choisis pas
Fleur des fossés machine au cœur d’acier
Je vous ai aimés
16 mai