
J’ai posé le doigt
Sur la lune molle
De la vitre brûlée
Loin du soleil rageur
Un oiseau s’est posé
Ses ailes de velours
Battent doucement du cil
25 avril

J’ai posé le doigt
Sur la lune molle
De la vitre brûlée
Loin du soleil rageur
Un oiseau s’est posé
Ses ailes de velours
Battent doucement du cil
25 avril

Et Jules doute. Il doute de tout, du réel qui l’entoure, des autres qui passent. Et cette question qui lui revient, comme un refrain, cette question que posait son professeur de philosophie au commencement de chaque cours : « et si nous n’étions que le rêve d’un papillon ». Un papillon, comme un songe, furtif, qui passe devant les yeux. Et si c’était vrai, si tout tenait dans le rêve d’un cerveau de la dimension d’une tête d’épingle. Tout lui paraît incongru, posé là sans raisons évidentes, il cherche le vrai, ce dont il ne pourra jamais douter. Il y a le soleil qui se lève, ça fait comme un début à cette histoire, à l’histoire, au rêve…Et toujours le papillon derrière chaque certitude. Jules doute : il n’y rien, rien dont il ne puisse avoir la preuve, rien à qui il puisse dire : « regarde-moi chose, objet, regarde-moi vivant et existe moi… »
La preuve, quelle preuve ont dit les autres ? Les autres : des vivants qu’il rencontre chaque jour, qu’il voit, qu’il retient pour le lendemain, pour toutes les prochaines fois où ils lui diront : « ça va Jules, ça va depuis hier, depuis tout à l’heure, depuis toujours ». Et Jules qui ne les croit pas parce qu’il doute, parce qu’il cherche comment c’est fait le vrai, parce qu’il est persuadé que chaque nuit il y a des mondes qui se fabriquent, d’autres mondes avec d’autres Jules qui cherchent, qui attendent, qui doutent.
Il en est sûr parce qu’il le fait lui-même, chaque nuit. Il sait que ces mondes existent quelque part, ailleurs, entre ses rêves et ceux d’un papillon. Alors il se dit qu’il n’y a pas de raisons de croire l’un plus que l’autre. Quand Jules rêve à cette femme qu’il aime, il dit qu’il rêve mais il sait que cette femme existe, qu’elle est dans un vivant ailleurs, il sait qu’elle n’est pas plus fabriquée que lui. C’est peut-être elle qui rêve, elle qui l’existe, elle est peut-être le papillon qui passe devant les yeux, et qui pose un songe comme une goutte de miel au creux de son histoire.
Tout est si compliqué quand on ferme les yeux, il y a les lumières, en boule, qui roulent de droite à gauche, et qui changent de direction quand on s’appuie sur les tempes. Tout est si compliqué et on parle si peu. Le « j’ai bien dormi » n’existe pas dans le langage de Jules, il ne sait quand il a dormi, il ne sait qui a dormi.
Il a mal à la tête de se poser des questions qui se cognent au mur de ce qu’il croit être son ignorance. Il doute Jules, il doute de tout et même de ses doutes, il veut bien croire au possible, se dire que le vrai est tout près, là, et qu’il n’y a rien à dire, pas de questions, des certitudes, c’est tout. Ce serait bien, si c’était ainsi, tout droit avec personne en travers, le temps qui coule comme un fil qui se déroule.
Le temps : chaque fois qu’il dit ce mot Jules hésite, c’est si complexe un mot comme celui-ci, un mot qui va avec les nuages, le soleil, les pendules, un mot qui accompagne la pluie et les rides, un mot qui ne va jamais seul, toujours à s’adjoindre des adjectifs météorologiques, toujours à accompagner des verbes pour vieillir, des verbes pour mourir. Jules est persuadé que ce n’est pas un hasard que le mot soit le même pour désigner la vie qui fait mal quand elle passe et le ciel qui s’agite chaque matin. Lui, il sait que le temps, quand il est à l’orage, quand il est mauvais ça lui trouble son temps à vieillir, son temps machine à fabriquer des secondes pour ajouter à sa série. Il sait, mais il ne peut pas expliquer et encore moins comprendre.
Alors il ne dit rien Jules. Et il fait des choses que personne ne pourrait comprendre parce qu’elles semblent inutiles, les autres ils aiment quand c’est rentable, quand on peut raconter aux autres ce qu’on a vu, entendu et compris.
Parfois Jules il regarde les autres qui dorment. Et il aime ça Jules les autres qui dorment, surtout quand il s’agit d’une fille. Quand il trouve une fille, quand elle accepte parfois d’aller dans un lit avec lui, il attend le moment où il la verra dormir. Il est persuadé qu’alors il se passera quelque chose, qu’il n’en sera pas exclu. Il en a passé des mi- nuits à observer, à attendre le sommeil de quelques belles, jusqu’à espérer qu’il se passe quelque chose, un malaise, un questionnement. Parfois ça marche, mais souvent rien, comme une bête à contempler, étendue de chair, inerte, à peine soulevée d’une inspiration.
Une nuit, c’était en Juillet, il a vu. Elle n’était pas belle comme les autres, elle n’était pas celle dont les chasseurs de femme aiment à se vanter, elle n’était pas celle qu’on couche sur papier glacé pour montrer aux légionnaires de passage. Elle n’était pas belle, elle était autre, il n’y avait rien à dire de son corps, de cette enveloppe à laquelle on passe tant d’énergie, c’était un corps en attente d’amour. Elle était de celle qu’on ne drague pas parce que ce mot est mécanique, qu’il ressemble trop à racler, elle était de celle avec qui on vit dès qu’on la rencontre. Une histoire, une force, une beauté qui ne perd pas de temps à utiliser de mots.
Il l’avait rencontrée sortant d’une pharmacie, les larmes aux yeux. Leurs regards s’étaient arrêtés, avaient abandonné les nuisances environnantes. Elle pleurait, il le voyait, il savait déjà et elle l’écoutait lui dire qu’elle était triste et qu’elle ne s’en cacherait pas. Il faisait lourd, elle était triste.
Elle était triste, il ne saurait jamais pourquoi, c’était une histoire de l’ailleurs, en dehors d’eux et il l’aimait déjà avec sa douleur. Il lui avait effleuré la joue du revers de la main, comme pour sécher ses larmes, elle avait penché la tête dans un geste de merci. Il lui avait proposé un verre, une menthe fraîche, bleue pour que ça frissonne dans le corps. Il lui avait parlé de cette journée qui s’étouffait dans une fin d’après-midi ridicule, lui avait dit qu’aujourd’hui était effaçable jusqu’à cet instant où il l’avait vue, comme une tâche de vrai sur le convenu de l’été.
Il en avait marre de cette journée, du soleil de la ville où tous sourient béatement parce qu’il paraît que ça sent les vacances. Il en avait marre de ces hommes de l’été qui étirent les jambes sur les terrasses, lunettes sur le front pour croire que tout va bien, que demain ils auront du sable au fond des espadrilles et de la crème solaire agglutinée entre les orteils. Lui il s’en fout, il veut qu’il se passe autre chose qu’une accumulation stupide de vivants volés au rêve.
Quand il l’a vue, il a su qu’il lui faudrait douter, elle sortait, tâche de gris avec des larmes au milieu du multicolore des estivants sédentaires. Elle boit sa menthe en reniflant et n’a encore rien dit. Elle est heureuse. Il lui dit, et voudrait qu’elle ne réponde jamais, qu’elle laisse faire ses yeux. Plusieurs fois leurs doigts se sont touchés, puis leurs jambes sous la table. Les autres sont étirés, pâtures solaires, eux sont à l’ombre, à l’intérieur dans un bar à l’automne éternel, ils se sont regroupés, rassemblés autour du rien, autour d’un bonheur si simple. Doucement il lui dit qu’il a envie de la tenir dans ses bras, de la serrer, de l’embrasser, de l’aimer, ce soir, cette nuit, demain, toujours, jamais, nul ne sait. Elle ne s’étonne pas, leurs effleurements sont plus insistants.
Seuls au monde, autour d’eux comme une bulle, comme une gangue de froid. Ils sont bien, un bonheur facile, il la prend par la taille, elle est petite. Elle pose sa tête contre son épaule, la chaleur les oublie et les autres aussi.
Ils vont chez lui. Elle le regarde ouvrir une bouteille de vin blanc, désespéré dans chacun de ses gestes, comme s’il cherchait à retenir des larmes. Elle le lui dit : « on dirait que tu vas pleurer, qu’est ce qui te rend si triste ? »
La bouteille est ouverte, le vin est bon, il est fruité, c’est un vin qui réjouit. Elle sourit. Il lui explique, sa vie, le doute, il lui dit qu’il hésite, les larmes, la joie, c’est si proche. Il ne sait pas ce qu’il vaut mieux. Il est bien dans les deux, il a la gorge qui se serre. La joie ou la douleur ça améliore l’ordinaire du visage.
Il lui dit qu’il l’a trouvée belle, tout à l’heure, belle à pleurer, sortant de ce lieu où l’on répare les souffrances. Il ne lui demande rien, il ne veut rien savoir.
Elle ne veut pas mentir à toutes ses presque questions, et elle se lève, boit une demi-goulée. Elle est debout, là, tout contre lui, il sent toute cette vie dans son corps comme un bouquet de palpitations. Il l’écoute vivre, il l’aime déjà et le lui dit, elle lui caresse la nuque, il pleure, c’est bien, c’est bon. Il a envie d’elle, le lui dit presque discrètement, déçu d’être obligé de passer par des mots, déçu que ça se fasse comme ça, qu’il n’ait pas réussi à émettre quelque chose de nouveau, de neuf pour qu’elle le suive, qu’elle l’aime si fort.
Elle est immobile. Il lui caresse les paupières, les joues, le creux des épaules. Il cherche tous ces lieux que les autres oublient, négligent. Elle frémit, elle veut qu’il entre en elle, elle a envie de lui, le lui dit très fort. Il l’entend, et s’entend lui répondre qu’elle est belle. Elle sourit à pleines dents pour lui montrer qu’elle a compris qu’il est un autre, qu’il ne fera jamais rien normalement. Ils font l’amour plusieurs fois. Elle s’endort. Elle s’endort et Jules est là pour la regarder pour saisir le magnifique moment où elle entre dans ce mystère qu’il ne comprend pas.
Jules est triste, comme souvent, après de l’amour, comme souvent après de la vie à deux, à plusieurs, avec des sourires, avec des corps et des caresses sur les peaux qui se touchent et se parlent. Il dit qu’il est triste parce que c’est le mot qui lui vient, parce que c’est le mot qu’on propose pour définir l’état dans lequel il se trouve, là, maintenant.
Alors Jules, se dit que c’est le mot qui va le mieux, triste ça va bien avec « gorge nouée », avec « regard vide et gris », il le prend en enduit toutes ses paroles et ses regards aussi. Les deux doivent aller ensemble…

L’homme est courbé,
Son dur regard racle le sol.
Lever les yeux ?
Il ne le veut pas,
Il ne le peut plus.
L’homme est triste,
Il marche
Sur le fil gris de la peur.
Il tire sur les manches de la douleur,
Soudain,
Merle siffle ;
L’homme déplie un bout de sourire,
Essuie la buée de ses larmes bleues,
Bouée est là, ronde et fleurie.
Elle est pour lui
Il la serre,
Tout est fini.
24 avril

Jules se souvient de tous ces lendemains qu’il attendait, avec l’espoir qu’ils signifient autre chose qu’un jour qui commence. Il se souvient de toutes ces femmes qui l’ont quitté sans l’avoir accepté, sans avoir compris ce qui pourrait les retenir. Toutes ces femmes qui ne comprennent pas l’orage, qui se ferment aux premiers grondements et lui qui s’ouvre, qui attend que le premier éclair frappe.
Aujourd’hui il n’a pas de mémoire, il a bien plus, il a Lisa. Elle est là quelque part, il ne se souvient pas mais sait qu’elle existe. Elle est derrière un de ces murs auxquels il se heurte toutes les nuits quand il cherche le passage.
Lisa, elle n’existe pas, elle est une ombre qui attend que son soleil la rappelle. Lisa comme une ombre de midi, quand il fait si chaud qu’on économise le moindre geste, pour faire des réserves quand le soleil nous laisse enfin en paix.
C’est avec elle que tout a commencé. C’est avec elle qu’il a connu son premier orage. Il a un fragment d’elle au fond de lui. Il le lui a pris il y a longtemps. Il se souvient, quand il s’endort, quand le temps est lourd, quand les corps sont moites, elle est là, il l’entend, elle s’approche. Ça fait comme une pluie légère, une pluie timide qui hésite à fabriquer de la flaque. Il ferme les yeux et le noir de derrière est adouci par les couleurs qui entrent, des couleurs qui le caressent, qui lui disent de s’endormir. Quand il s’assoupit, quand il a enfin trouvé le passage, qu’il sait être arrivé au pied du dernier mur, il entend le bruit de cette mécanique, une machine qui rugit, une voix d’homme qui s’éloigne.
Et puis quand il s’enfonce encore plus profond, dans le sommeil, c’est une voix frêle, douce comme une litanie qui lui caresse les tempes. C’est une voix qui tremble, qui pleure, qui appelle.
Jules en a marre de ces épuisants voyages nocturnes. Ils se terminent toujours au même endroit, c’est un lieu gris, il le sait, il le sent, mais le matin c’est fini, il n’y a plus rien, il est seul. Il faudrait qu’il en parle, il faudrait qu’il raconte, qu’on lui tienne la main un soir d’orage. Il faudrait que tout cela cesse, il faudrait qu’il puisse vivre comme les autres.
Jules est comme dans un rêve. Il y a tout à l’heure, ce qui s’est passé, il se souvient. Et Jules doute. Et là, il est seul à se poser les mêmes questions, celles de l’existence, celles du vrai auquel on croit si fort parce que les autres en font partie. Mais Jules il doute de plus en plus. Depuis qu’il est né il y a ces moments où rien ne fonctionne. Il doute, il ne sait pas si c’est lui qui est déréglé ou si c’est les autres. Il a cette sensation très pénible de vivre une autre histoire de la regarder de l’extérieur avec les yeux d’un témoin.
Il est un zappé, il est un écran sur lequel les autres, font défiler une suite d’histoires qui ne le concernent pas. Il passe de l’un à l’autre et quand on le rejette lorsqu’il comprend qu’il est un inconnu il ne se met plus en colère et n’est même plus surpris. Il a fini par s’habituer, par se dire que la vie c’est ça, ce zapping, ce passage d’un monde à l’autre. Il est comme un acteur qui passe d’un personnage à l’autre. A chaque fois il se sent bien, c’est nouveau, le regard des autres lui permet d’exister au moins pour un court instant. Et puis il faut passer à autre chose, un autre rôle.
Il se dit aussi que l’existence c’est peut-être mieux ainsi, une addition, une accumulation hétéroclite de petits bouts, de tranches de vie. Sa seule erreur est de s’attacher de trop vouloir en profiter, jusqu’au bout même quand le rideau est baissé.

Jules aimait l’orage. Quand les premiers éclairs embrasaient le ciel, il sortait et attendait. Les premières gouttes étaient les meilleures. Chaudes, garnies d’odeurs, quand elles le touchaient, il frémissait.
Aux premiers grondements de tonnerre, il frissonnait. Il ne savait plus où donner des sens. Il aurait voulu s’inventer une partie du corps qui puisse voir, sentir, entendre et toucher. Tout en même temps. Il aurait voulu être le prolongement de cette terre qui le soutenait. Et rester nu, sous la pluie battante, sentir l’eau du ciel contre sa peau, en voyage vers le sol.
Mais il ne fallait pas, il y avait les autres. Il y avait la peur. Il y avait ceux de derrière les carreaux. Ils ne supportaient l’eau que lorsqu’elle circule dans des tuyaux, qu’elle se mélange aux savons aux odeurs inventées. Ils l’auraient cru fou, définitivement.
Ce soir Jules se souvient de tous ces soirs d’été. Sa mère, Paulette, la Paulette comme l’appelait les voisins, qui hurlait quand il s’échappait. Elle ne l’entendait pas expliquer qu’il aimait quand les nuages roulent, qu’ils se rencontrent, se heurtent à pleine vitesse.
Il se souvient de l’herbe. Il s’y roulait, juste avant la pluie, quand elle attend, quand elle s’apprête à recevoir des armées de gouttes. C’était une herbe coupante, recroquevillée, comme un tapis avant le combat. Il se couchait et fermait les yeux. Alors « son père » le ramenait à la maison. Sans gifles, ni remontrances, pire que cela, avec le regard désabusé de celui qui n’y peut rien, qui ne peut pas se battre et qui ne dit rien. « Son père », Jules essaie une fois de plus de prononcer ce mot : père, et rien qui ne se passe. Il essaie autre chose, son père, mon père, toujours rien, un mot sans chair, un mot sans rien, un mot mort pour les autres, pour ceux qui parleront de lui, un jour, comme de celui qui était sans père. Il y avait bien cet homme qui soupirait quand leurs regards se croisaient, cet homme qui ne le détestait pas, cet homme qui ne l’ignorait pas, mais qui ne le comprenait pas. Il n’avait pas de père, il n’en avait un que le temps d’un éclair, le temps d’un orage, un père pour le lancer dans cette vie qui ne voulait pas de lui.
Jules est seul. Quand il est seul, il ne fait rien d’autre que se souvenir et attendre. Il se souvient des autres, toujours en avance, il se souvient des reproches de ses maîtres. La lenteur est un désastre dans un monde où il faut toujours avoir fini pour espérer autre chose. Aussi loin qu’il se souvienne, Jules aime s’attarder sur le début. Il aime quand tout commence, il aime les préparatifs, les avant projets. Dès qu’il entre en action il est saisi de nostalgie. La peur de finir, la peur d’être au bout, de ne plus rien commencer.
Les autres, Jules pense qu’ils ont peur, peur de rater, ils se pressent d’aller voir ailleurs. Jules ne veut pas s’éloigner. Il veut prendre le temps. Il veut savourer le merveilleux instant où tout est comme ces premières gouttes de pluie qui vont à la rencontre du sol d’été. Après, quand tout est trempé, quand tout est devenu une bouillie indéfinissable il n’éprouve que lassitude ou angoisse.
Quand il était enfant, le médecin blâmait sa mère : « il ne se développe pas assez rapidement, il est en retard pour son âge ! ». Ces reproches loin de l’effrayer ou de le vexer le laissaient indifférent. Il éprouvait une certaine fierté se jugeant inspiré à prendre le temps de ne pas se métamorphoser en grand dadais boutonneux en partance vers le bout, vers la fin.
Mais aujourd’hui, on ne dit pas qu’il fait plus jeune que son âge, on prétend qu’il est pâlot, distant, bizarre même.
Ce soir il marche depuis deux heures déjà. Tout à l’heure, sa vie a basculé, une fois de plus. Tout à l’heure est survenue une nouvelle erreur de son existence. Il s’est trompé, on l’a trompé, il ne sait pas. C’est sans importance, le résultat est identique.
C’est une erreur, alors il marche vers quelque part, en silence, parce qu’il est seul et qu’il regarde le ciel. Le ciel ne ment pas.
Il se souvient de cette fois où sa mère ne l’a pas reconnu. C’était sa mère, il le pensait, le voulait, il l’avait choisi à cet instant. Elle l’a chassé, parce qu’elle avait peur, qu’elle ne comprenait pas qui il était, « une erreur, une erreur » disait-elle, « vous êtes une erreur ». Alors il était parti, sans insister, parce que c’est ça l’existence. On vit, on passe, on revient, on se trompe parfois. Il se dit souvent que ce qui lui arrive n’est pas extraordinaire. Il est inutile qu’il s’étonne. Ça lui arrive. C’est ainsi, il est inutile de se battre. Et il part, il recommence, chaque fois.
Sa mère ? Quelle importance, un souvenir d’elle, si faible, une plaque de brouillard collé au reste de la mémoire. Sa mère, une mère, il cherche comment accompagner ce mot devenu absurde quand il oublie que le sourire est aussi une terminaison pour la grammaire de la tendresse. Sa mère, une mère, maman, une femme qu’il voit et elle est elle. Elle est celle qu’il choisit aujourd’hui et ces yeux le lui disent, je veux être ton fils pour t’entendre ne me dire rien, pas grand-chose, ou alors du si simple, comme une caresse qui effleure la joue.
Sa mère une fois, ou d’autres, il ne sait pas ne se rappelle pas. Les images deviennent visage. Une fille, comme on dit quand on est avec les autres. Une fille, elle est jolie. Jolie, c’est bon de dire ce mot. C’est comme un sourire qu’on fabrique avec la voix et il s’envole jusqu’aux regards et la fille le regarde, elle est ronde, son regard est rond, on lui dit qu’elle est étonnée, ou qu’elle a peur, parce que Jules il sourit, et il dit : « tu es jolie, je te serre contre moi et je respire tes cheveux, comme du foin, je me roule dans ton odeur de fille jolie » et la fille est partie, elle aime pas le mot joli, pas quand il est dit par Jules, elle le digère mal et Jules le comprend.
Plein de filles à qui il a dit son amour, son amour de l’instant, il les connaît, il les a dans la tête, c’est comme ça, ils s’approchent d’elles et il a les yeux qui leur ouvrent tout son en dedans. Mais les filles, les jeunes, les jolies, celles qu’ils voient comme des mères parce qu’elles ont moins peur, elles le repoussent, gentiment, du regard qu’elles ne lui offrent pas, elles ne le voient même pas, elles continuent, et gardent tout cette beauté pour d’autres histoires, pour d’autres aventures.
Les autres ne l’existent plus.

Jules ne s’y retrouve plus dans ses souvenirs. C’est comme un puzzle. Plusieurs milliers de pièces : on agite, on manipule, on remue et chaque essai pour retrouver le sens se termine par un échec. Jules déteste les puzzles. Il déteste tout ce qu’il faut classer, trier, regrouper par catégories.
Jules aime ce qui dérange l’ordre des autres. Jules aime ce qui n’a ni début, ni fin.
Jules aime ce qu’il appelle la beauté du désordre poétique. Les objets sont heureux des espaces qu’on leur laisse. Jules aime les objets quand ils vivent, quand ils sont libérés des contraintes du rangement où la seule règle admise est la perpendicularité.
Jules a mal à la mémoire. Depuis le plus jeune âge, il essaie de trouver le fil, remonter au début, là où tout a commencé. Il cherche l’endroit mystérieux, magique où la première histoire s’est enregistrée : son histoire, le commencement de son histoire. Il essaie de se frayer un passage. Parfois il trouve des voies, rencontre des obstacles, parfois des chemins dégagés et c’est comme un courant d’air frais qui lui entre dans la tête. C’est comme quand on vit, on sent qu’on y est, là dans le vrai, dans le souffle d’un cœur qui bat, si fort, si beau.
Le plus fréquemment c’est aux murs qu’il se heurte, les hauts murs dont il ne distingue pas la cime. Alors dans son demi-sommeil, il recule, il revient, perd le fil et s’endort avec l’espoir d’une issue, d’une réponse, dans un rêve. Et chaque matin c’est la même chose, c’est une pagaille effrayante, pas de logique, pas de bout, pas de commencement : il n’y comprend rien : comme s’ils étaient plusieurs à rêver aux carrefours de plusieurs vies.
Jules n’a pas de mémoire, il en a plusieurs. Elles s’ajoutent et se mélangent. Elles ne lui appartiennent pas, il les a empruntées à d’autres. Toujours au même moment, toujours à cause de l’orage. Il essaie de le croire, il y a tant de choses dans sa boîte à images, tant de traces laissées par d’autres vies. Certains appellent cela les rêves, ces histoires qui s’invitent la nuit. Jules ne croit plus à cet imaginaire-là, il est sûr que ce qui arrive dans sa tête c’est de l’existence, c’est de la vie qui s’est imprimée. Elle est entrée là chez lui au contact des autres. Jules est tellement seul. Quand les autres le touchent quand il y a de l’orage ça fait comme une décharge. Les autres se vident, ils se vident en lui. Jules a de la place. Il a tellement d’espace à offrir. Jules ne veut pas croire aux rêves qui se fabriquent dans l’inconscient. Ce qu’il voit Jules quand il dort, quand il ferme les yeux, quand il attend, ce qu’il voit, c’est du vrai, avec des gens qui se parlent, avec des cris, des pleurs, des sourires. Il ne parle pas de ses certitudes, il n’en parle pas parce qu’il sait déjà qu’on le prendra pour un malade, pour un fou, pour un de ces originaux qui veut qu’on le remarque. Il n’en parle pas et n’en a pas besoin, c’est plus simple comme cela, il se dit que ce qu’il croit, n’est pas plus absurde, n’est pas plus improbable sur le plan scientifique que cette histoire de rêves. Et puis l’orage, les orages c’est toujours du vrai, c’est rarement dans un rêve parce que ça réveille, parce qu’on le regarde les yeux grands ouverts avec les poings qui se serrent et les lèvres qui se pincent.
L’orage comme un rythme. L’orage avec la lumière venue de nulle part avec le bruit, le grondement, qu’on compte. Le premier orage, il ne s’en souvient pas mais quand il cherche, dans toutes ses mauvaises nuits, il le sent, il le sait, il l’entend, il est derrière ; derrière ce bout où il bute tant et qui lui remonte d’un quelque part, et Jules commence ses phrases, presque toutes par je me souviens. C’est un rite.
Les orages, Jules en a connu tant. L’orage et les autres qui lui entrent dans la tête au premier coup de tonnerre
Les autres, comme des parasites. Comme des insectes qui pénètrent le bois, c’est la nuit qu’ils s’éveillent, alors ça grince, ça craque et on sent l’angoisse qui serre les gorges sèches.
Et ça lui fait mal ces bouillies d’histoire qu’il n’a pas voulues et qui lui colonisent l’esprit. Il lui arrive de ne plus savoir si ce qu’il voit existe. Ailleurs, dans les espaces qu’il ne connaît pas, ici dans le fouillis de cette vie qui est la sienne. Peut-être, tout est confus. Confus comme les images qui défilent quand ils ferment les yeux les soirs d’orage. Il ne voit pas les visages, il les ressent, chaque regard que les autres ont porté sur lui est là, il s’additionne et ça lui brûle les entrailles, les os lui font mal. Soudain il est si lourd, lourd de tous ceux qui l’habitent et qui l’agitent.
La vie, quand Jules essaie d’en parler, il a une boule qui se forme dans la gorge. Sa vie, celle des autres, la vie, il ne sait pas par où commencer. Depuis toujours il pose des questions que d’autres n’imaginent même pas. La vie, le bonheur, les autres, et la souffrance : parfois comme un ciment, comme un trait d’union entre les moments qui, quand ils s’ajoutent, fabriquent du temps. Jules, il est comme beaucoup, il ne sait pas ce qui le rendra heureux demain, il est comme les autres mais lui il le dit, il le vit. Alors il a le regard qui se plisse, les dents qui se serrent, les mains qui se crispent et il attend. Il attend les signes de ce qui lui donnera des sourires.
Jules il dit que la vie, il faudrait qu’elle lui appartienne pour qu’il soit bien, il faudrait qu’elle soit à lui, rien qu’à lui. Il dit qu’il voudrait décider seul de comment il la partagera, comment il la construira. Et quand il dit qu’il veut partager la vie, sa vie, il ne voit pas ça comme un gâteau qu’on diminue, il ne voit pas ça comme une séparation, mais comme une union.
Et puis dans sa vie, Jules il aime les émotions et les mots qui vont avec, des mots qu’il choisit. Les autres, beaucoup d’autres, les femmes surtout, lui disent que « ce ne sont que des mots » alors lui il serre les dents, encore, et ne dit rien. Il a mal. Il a mal et en a marre des autres qui sont dans le réel parce qu’ils ont un pouvoir sur les objets ou sur les corps. Il n’en peut plus de ces réalités de convenance, lui il aime s’émouvoir et le dire, il aime tout ce que ses sens lui apportent et il veut en parler.
Jules aime lorsque les définitions n’existent pas, lorsqu’elles se refusent au mariage de raison entre le vivant et l’écrit immobile, il veut que le poids des dictionnaires ne soit plus qu’un mauvais souvenir et découvrir en feuilletant les pages que soudain le mot qu’on cherchait hier n’y est plus, qu’il s’est échappé ailleurs dans un autre ordre, dans une autre règle. Jules aime se persuader qu’il y a peut-être un doute quelque part et que dans quelques jours ou dans mille ans le petit Larousse ne s’utilisera plus comme un objet, comme un de ces ustensiles qui nécessitent un mode d’emploi, il sera tout autre, il respirera, il entendra, il ressentira et alors quand les Jules de demain, les comme lui qui souffrent de ce qui est défini et définitif pourront caresser le livre et lui demander avec tendresse ce que veulent dire les mots peur, ou amour ou orage ou flaque alors il posera l’oreille tout contre la couverture et entendra peut-être un chant d’oiseau ou alors d’espoir ou les deux parce que cela va ensemble et les lettres ne seront plus alphabétiques, elles seront virevoltantes, elles seront tremblantes ou troublantes. Et Jules fermera les yeux. Il sera bien…
Jules se souvient de toutes ces souffrances d’adolescent, toutes ces souffrances qui s’inscrivent dans le marbre des souvenirs. Les filles, les premières filles qui sont radieuses devant toutes les mécaniques, celles des épaules et celles des engins à moteurs. Et celles qui sont en admiration devant les déhanchements de jeunes séducteurs qui partent en chasse sur les pistes de danse avec un appétit de fauve. Lui Jules, il a les épaules frêles, frêles et boutonneuses, alors ils les rentrent en dedans, lui n’a pas de moto, ni de mobylette, il marche, le regard en l’air à attendre un signe d’orage. Et les mots se bousculent, ils lui inondent le cerveau avant la pluie. Cette pluie qu’il a en lui, depuis toujours.
Jules était si mal en ces moments-là, en ces moments de rien où il ne comprenait pas. Lui il aurait voulu raconter aux autres, aux filles surtout la beauté du gris de l’orage quand il se prépare à frapper.
Il aurait voulu raconter ce qui se produisait dans son en dedans, il cherchait les mots qui peuvent aller avec.
Après quelques jours d’une longue panne sèche, tout doucement par la fenêtre ouverte l’inspiration est revenue…

Besoin d’écrire,
Inspire, respire…
J’ai le souffle moins court,
Les mots sont là :
Ils reviennent de ce si loin,
Rimes des presque rien.
Je les entends,
Ils approchent,
Efflanqués, allégés
De leurs graisses académiques.
Inspirés, étonnés,
Sur le long fil de nos mémoires abîmées,
Ils étaient là,
Prostrés dans l’attente,
D’une plume de rosée.
Le presque soir aux reflets bleus
Est arrivé,
Une fenêtre de papier
S’est ouverte à la page ridée
Marquée,
De tous ces hivers
Emplis de nuits.
Aujourd’hui,
C’est le début du fini,
L’oubli est enfoui.
J’inspire, je respire.
21 avril

C’était il y a trente ans ou un peu plus. C’est un bout de leurs débuts. Un petit bout, l’autre commencement du même début.
Elle est arrivée en avance, vêtue de peu. La chaleur et l’habitude. Il faut gagner du temps, elle ne supporte pas les mains qui hésitent, humides et maladroites. Il lui faut du rapide, de l’envoyé. Celui qu’elle a rencontré hier est un dur, un viril. Elle l’a repéré au premier coup d’œil, dès qu’elle est entrée dans l’atelier. C’est un chef d’équipe. C’est lui qui l’a accueillie. Il avait un regard pour vous déshabiller. Avec elle c’est inutile, sous sa blouse, il n’y a presque rien. C’est l’été, elle aime se sentir presque nue. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre qu’elle n’était pas du genre à se contenter de regards platoniques. Alors quand la journée s’est terminée, il l’a invitée à boire un verre, pas loin, juste à la sortie, un vieux bistrot, avec des gars en bleu, de la fumée, une odeur de vieille friture et un air de variété qui s’échappe de la pièce du fond. Elle a pris comme lui : un Ricard. Ils sont debout, au bar. Il la regarde. Il vérifie, tâte du regard, de haut en bas. Il n’a pas grand-chose à raconter, demander d’où elle vient, son âge, ses goûts il s’en fout. Il n’est pas là pour les mots, il voit bien qu’elle est prête elle aussi. Elle répond en hochant la tête, son allure est nonchalante, on sent bien, rien qu’à la voir, qu’elle aime l’amour, pas celui qui rime avec tendresse, non celui avec les mains qui fait crier et laisses-en sueur.
Elle n’est pas bavarde. Elle observe ses mains, elles sont immenses et épaisses. Il pourrait faire le tour de sa taille. Des mains d’ouvriers, des mains d’homme, jamais malades. Des mains qui entrent dans la vie avec un appétit féroce. Il lui propose de venir chez lui le lendemain soir. Il a la télévision, ce n’est pas courant. Ils la regarderont tous les deux en buvant une bière glacée. Elle ne dit pas non. Pour la télévision, pour ses mains. Elle s’en va, clin d’œil déhanché, gourmand, il fait chaud. Il commande un deuxième Ricard. Il a envie d’elle. Demain soir.
Il a ouvert la porte et elle est entrée sans hésiter. Il est en maillot, il sent le bon, le frais de la douche. Elle est toute molle, moite aussi, c’est la chaleur, l’orage bien sûr, mais il y a le désir aussi. Elle y pense depuis hier soir. Elle veut que ça commence, vite, être contre lui. Il faut qu’elle le sente avec le bout des doigts, qu’elle l’effleure pour qu’il frémisse et quand il sera à point, elle appuiera un peu plus, elle le caressera plus fort, plus proche du frottement et pour finir, pour l’achever, pour lui porter le coup fatal, elle se collera contre lui, elle mélangera sa peau à la sienne pour qu’il ne soit plus qu’un et alors il entrera en elle pour terminer le travail. Lui, il n’est pas si pressé, il est fier de montrer sa machine à images, sa télé, elle trône au centre de la pièce. L’un des murs est constellé de pâles étoiles du cinéma français qu’il a soigneusement découpé dans des magazines pour salles d’attente. Elle n’en connaît aucune, le cinéma elle ne s’y intéresse pas, du moins pas aux images qui défilent et aux histoires qui se racontent, au cinéma ce qui l’attire, ce sont les mains d’hommes qui naviguent dans le noir et qui accostent parfois sur des bords de peau qu’elle offre volontiers. Il s’est affalé sur un divan en skaï, rouge comme un mauvais vin de table et lui fait signe de s’approcher. La télé est trouble, ce doit être l’orage, il lui explique que cela perturbe la circulation des ondes, on distingue des chanteurs, mais on les entend mal, on dirait qu’ils bourdonnent tous sur le même air. Il est essoufflé, peut-être la fatigue de la journée, ou le désir qui monte, qui grossit lui aussi, comme l’orage dehors. Il y a deux bières sur la petite table recouverte d’une vitre sous laquelle sont incrustées quelques horribles cartes postales. Elle est fraîche la bière, elle se boit sans verre, pour qu’on la tienne à pleines mains, qu’on sente le contact du froid sur le verre. En quelques goulées elle est bue, la chaleur fait comme une coque dans laquelle flotte une bulle de frais. Elle s’étale sur le rouge du canapé, sa robe est légère, à la limite de l’inexistence, ce n’est pas du tissu, on dirait un voile, un souffle sur la joue. Quand elle s’est assise, l’étoffe s’est soulevée, envolée, elle a les cuisses découvertes, des cuisses simples, sans artifices. Le galbe, elle s’en fout, elle bouge tout le temps, elle sent la chaleur qui monte et l’humidité qui entre en elle. Ça lui fait comme une pression sur la poitrine, comme si le souffle allait se couper. Dehors l’orage a commencé. La pièce est sombre, seule la télé résiste, comme un îlot de lumière. Il se tourne vers elle, plusieurs fois, elle a son genou qui touche sa jambe, plusieurs fois. Elle bouge tout le temps. Son maillot est bleu, si bleu qu’il l’illumine. Le tonnerre gronde, elle s’en moque de cette télévision alors elle déboutonne le haut de sa robe : « il fait chaud chez toi… ». Son sein ne se devine plus, il jaillit, libéré, il le saisit, sa main est grande mais il la lui faut toute. Il aime cette sensation, ça colle un peu : la sueur, le bout est frais, si dur, il se tourne sans rien lâcher, elle est déjà sur le dos, ouverte, en attente. Il entre en elle, vite, c’est facile, elle est entièrement offerte, elle a sorti un mouchoir de son sac : « tu te retires avant la fin, je ne veux pas de petit… » C’est tout, elle est entraînée par le rythme des éclairs, elle a le bassin souple, la pièce est toute noire, à chaque jaillissement de lumière il accélère un peu. Ses grandes mains sont sous ses fesses, il la pétrit, elle est pliée au niveau du bassin. Il est fort, comme elle aime, elle le sent, ça lui fait mal, elle râle, c’est si bon. Et puis un éclair plus vif, plus long comme un éblouissement et le roulement qui suit est terrible, la télé s’est tue, elle crie, c’est si bon la peur mélangée au désir, elle lui griffe le dos, il se secoue, il est en elle si profond que ça lui fait du mal, il ne s’est pas retiré, c’est si bon, elle a la main qui pend au bord du canapé, le mouchoir est à terre. Elle jouit. Quatorze juillet, Paulette est enceinte.
Paulette est enceinte et Jules attend Lisa.
Je ne connaissais, mais j’ai eu un vrai coup de cœur pour ce texte…
C’est quoi la poésie ? C’est une épuisette à étoiles…

C’est quoi la musique? C’est du son qui se parfume
C’est quoi l’émotion? C’est l’âme qui s’allume
C’est quoi un compliment? Un baiser invisible
Et la nostalgie? Du passé comestible
C’est quoi l’insouciance? C’est du temps que l’on sème
C’est quoi le bon temps? C’est ta main dans la mienne
C’est quoi l’enthousiasme? C’est des rêves qui militent
Et la bienveillance? les anges qui s’invitent
Et c’est quoi l’espoir? Du bonheur qui attend
Et un arc-en-ciel? Un monument aux vivants
C’est quoi grandir? C’est fabriquer des premières fois
Et c’est quoi l’enfance? De la tendresse en pyjama
Mais dis, papa
La vie c’est quoi?
Petite, tu vois
La vie, c’est un peu de tout ça, mais surtout c’est toi
C’est toi
C’est quoi le remord? C’est un fantôme qui flâne
Et la routine? Les envies qui se fanent
C’est quoi l’essentiel? C’est de toujours y croire
Et un souvenir? Un dessin sur la mémoire
C’est quoi un sourire? C’est du vent dans les voiles
Et la poésie? Une épuisette à étoiles
C’est quoi l’indifférence? C’est la vie sans les couleurs
Et c’est quoi le racisme? Une infirmité du cœur
C’est quoi l’amitié? C’est une île au trésor
Et l’école buissonnière? Un croche-patte à Pythagore
C’est quoi la sagesse? C’est Tintin au Tibet
Et c’est quoi le bonheur? C’est maintenant ou jamais
Mais dis, papa
La vie c’est quoi?
Petite, tu vois
La vie, c’est un peu de tout ça, mais surtout c’est toi
C’est toi
Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires
La vie est là, la vie est là
Dans notre armoire à souvenirs, dans l’espoir de te voir vieillir
La vie est là, la vie est là

C’était il y a trente ans ou un peu plus. C’est un bout de leurs débuts. Un petit bout, un commencement de début.
Au premier éclair il l’a dévêtue. Elle est brune. Un noir qui s’incruste. Elle a les yeux qui interrogent, des yeux qui dérangent tant ils cherchent le regard de l’autre. Lui ne la voit pas, il cherche à la rendre nue. Il veut la prendre. Son corps est en sueur, un corps qui sent la journée de travail. Une odeur pour femme seule, qui rêve d’un homme qui la serre. Il ne l’aime pas, il veut simplement la posséder. Posséder, c’est le mot qu’il aurait choisi. Il en assez d’attendre, de l’attendre, il la veut. Il la veut, nue. Aujourd’hui il lui a donné rendez-vous à l’embranchement de la route et du chemin qui conduit à une petite pépinière. Il y connaît une cabane au fond d’un verger où il vient parfois au printemps. Une cabane à outils. Elle était à l’heure Rose, elle l’attendait. Impatiente de lui dire je t’aime, aujourd’hui elle pourra. Elle l’a répété toute la nuit. Il est temps de lui dire. Elle lui dira je t’aime, pour qu’il soit son homme. Celui dont elle parlera aux autres, aux copines. « Mon homme, le grand, le fort, avec des yeux clairs ». Elle est anxieuse, l’orage menace. Il est encore loin, les nuages ne sont que du coton. Ils auront le temps de parler le temps de dire, de se dire ce qu’elle répète en boucle depuis plus d’une heure. Ils parleront, doucement, tendrement et ils iront se mettre à l’abri. Alors il entendra peut-être comment ça fait quand elle a peur, et que cela se mélange avec le désir.
Il sait qu’elle l’attend, il a bien vu ces derniers jours qu’elle était prête, il pourrait cueillir le fruit. Un fruit gorgé de soleil, juteux comme il aime. Il est à mobylette. Il fait si lourd. Sa chemise colle à la peau, surtout dans le dos. Il aime cette chaleur, elle annonce l’orage, il sait qu’il viendra, qu’il est proche. Il lui proposera de s’abriter. Elle aura peur au fond de la cabane. Il attendra qu’elle le supplie de la protéger. Il connaît l’effet de l’orage chez les jeunes filles. Elles ne résistent plus, cherchent simplement à se blottir. Il le sait, c’est l’été que les femmes résistent le moins.
Il ne s’est pas trompé, elle est sensible à la lumière qui baisse et quand les premiers grondements ont retenti, au loin, derrière l’horizon, elle s’est approchée de lui. Imperceptiblement. Il n’a pas besoin de proposer la cabane, elle le conduit, se dit qu’ils pourront parler. Et lui sait qu’il pourra la posséder. Ils ont fermé la porte. Le premier coup de tonnerre a claqué. Elle s’est approchée. La lumière a encore baissé, les éclairs s’incrustent. Ils traversent les murs, s’immiscent entre les planches mal jointes. Son visage a blanchi. Elle a peur, tout se mélange, elle le regarde comme pour l’implorer. Il s’approche, elle est peu vêtue, une robe, légère, quelques boutons, inutiles, quand le cœur bat si fort. Ils sautent un à un. Elle frémit, elle a la gorge sèche. La robe est à terre, chiffon qui a accompli sa tâche. Il est beau, il est fort, elle voudrait lui dire mais il est occupé à dégrafer le soutien-gorge. Elle n’ose pas le retenir, lui dire d’attendre. Encore un peu. Les premières gouttes tombent, elles sont lourdes, irrégulières, comme un signal. Et puis l’explosion, le déchaînement. Les éclairs s’amoncellent, l’eau ruisselle et les mains de l’homme s’étalent, débordent. Ce ne sont plus des mains, mais des fouines. Elles s’insinuent, s’immiscent, la culotte n’est plus un barrage, elle est un souvenir, elle a disparu. Il la tord. Elle n’ouvre plus les yeux. La peur, l’amour, le désir, elle ne sait plus, elle voudrait dire les mots qu’elle a répétés toute la nuit Au lieu de cela, elle le laisse faire. Elle gémit, petit animal. Il n’est plus délicat, il se déchaîne, comme l’orage qui grossit. Il la porte jusqu’à une table à outils. Elle est recouverte d’une poussière grasse qui colle avec la pluie qui s’infiltre partout. Il la dépose. Comme une poupée de chiffon. Elle voudrait lui dire d’attendre, elle voudrait qu’il prenne le temps d’entendre la musique que fait sa peau, si fine, si fraîche, quand on l’effleure, là, aux endroits secrets que même ses mains hésitent à toucher. Elle voudrait qu’il la rassure, qu’il lui dise que l’orage s’éloigne, qu’il la protégera. Elle a dix-sept ans, c’est jeune, c’est fragile, une presque femme de dix-sept ans. Elle est triste, déçue, elle ne sait pas. C’est la première fois, elle a peur. Elle essaie d’ouvrir la bouche, pour lui dire qu’elle le rêve, souvent, si souvent qu’elle pense passer toutes ses nuits avec lui. Elle entrouvre les lèvres, il les referme avec les siennes, ce n’est pas un baiser, c’est une morsure. Elle rêvait tant d’amour. Elle ne résiste plus, elle a jeté la tête en arrière lui livrant le haut de sa gorge, si blanche, si fine. On y voit le sang qui passe. Elle ne le reconnaît pas. Ses pommettes sont remontées, il serre les mâchoires, comme un chasseur appliqué qui dépèce un chevreuil. Il lui écarte les cuisses, sans délicatesse, sans joie. C’est calculé, il connaît le terrain. C’est une position qu’il affectionne. Elle est au bord de la table, un peu graisseuse. Il est en elle, accélère le rythme, l’orage est partout. Elle sanglote. Elle ne sait pas, la peur, la douleur, l’amour, l’orage. Elle aime ce qu’il lui fait et s’ouvre un peu plus. Son bassin accompagne la cadence qu’il impose. Et soudain, un éclair, l’éclair, si puissant qu’elle le voit comme dans un flash. Le coup de tonnerre est immédiat, elle a crié quand elle a compris l’orgasme. Il a fini, elle est en larmes, il est en sueur. C’est chaud dans son ventre, en bas, chaud et un peu poisseux. Il s’est retourné, il ne l’entend pas l’appeler, doucement, d’une voix qui doit dire « je t’aime ». L’orage s’éloigne et lui s’en ira aussi. Il ne s’est même pas retourné pour la voir. Il l’a eue. Il va rejoindre sa mobylette. C’est le quatorze juillet, Rose est enceinte.
C’était il y a trente ans, Lisa a commencé son attente.

C’était hier : ils s’aimaient à nouveau comme à chaque matin qui débute. C’était hier, le 14 juillet, ils avaient repris le chemin.
Les orages de juillet, du quatorze juillet, comme une évidence. Quand approche la fête nationale et ses pétards kaki, les yeux se tournent vers le ciel. Le bal s’achèvera sous l’orage, c’est écrit. La danse des fêtards deviendra un dégoulinement.
Chaque année c’est pareil. Ça tient la journée. Péniblement, il faut le dire. Et le soir venu, quand la chaleur a tellement pesé que même les regards sont écrasés et deviennent vides de tout, l’orage se souvient du « qu’en diront-ils » et tout craque pour le feu d’artifice ou pour le bal.
C’est ainsi, c’est inscrit dans le patrimoine génétique de la France météorologique. L’orage est le thème favori des conversations de fin de marché. Tout le monde le sait : les ingénieurs de la météo sont des fonctionnaires bien payés juste bons à gâcher les cérémonies.
Tout le monde le sait : le quatorze juillet, ce sont les orages. Un point c’est tout. C’est comme la neige à Noël : « on le sait bien » qu’il n’y en a plus depuis…Depuis qu’on croit se souvenir. On le sait bien aussi que la semaine de Pâques est toujours mauvaise. C’est écrit, on sait tout cela, on l’explique, on le proclame, on l’assure avec une conviction absolue. C’est une loi imprimée dans le scénario de toutes les fêtes familiales. Elle ne se discute pas, on ne la discute pas, c’est un objet de consensus, un des rares, c’est une union nationale, sacrée, autour de considérations pluviométriques. On ne se dispute pas sur ce thème-là, on ne débat pas, on fait pire : on se souvient ensemble, on disserte sur les dépressions du temps, on oublie celles des hommes. Le temps comme une certitude qu’on partage avec délice.
Les orages de Juillet c’est d’abord du moite. Les corps ont souffert. Il a fait lourd, il a fallu supporter la pesanteur d’une journée de plus. L’air est rare. Il prospecte l’ombre et s’y rassemble par paquets. On le cherche, on tend le cou, les veines saillantes du sang qui bout, on tire sur les cols. L’atmosphère s’est épaissie, s’approche du sol comme une housse de coton.
La lumière est plus basse, les premiers nuages naissent, ils se forment. On sent des trous de fraîcheurs qui s’installent au-dessus des têtes. Des oiseaux effrayés s’éparpillent sans réfléchir. Puis les nuages n’enflent plus, ne s’élèvent plus. Ils ont éliminé l’horizon. Ils s’étirent, s’étalent. Plus rien ne les empêche de se rassembler aux quatre coins, là où le regard peut se poser.
Au sol, il y a ce noir qui tombe par plaques lourdes de ce sombre qui repousse les derniers éclats d’un soleil qui en a trop fait aujourd’hui.
En quelques heures, la chaleur est oubliée. L’angoisse monte. Une angoisse emplie des respirations qui se retiennent. C’est la crainte de ceux qui ont peur, de ceux qui ont appris l’orage comme une colère, comme une punition. Ils attendent. Ils regrettent les brûlures du soleil qu’ils maudissaient après déjeuner. Ils auraient pu patienter, supporter.
Vu d’en haut, c’est comme une étendue de silence, on dirait une mer d’huile qui se prépare aux déchaînements. Il y a des yeux qui cherchent le premier éclair, le signe du départ, du début. Les portes se ferment, les rideaux se tirent, les lèvres se pincent, les mâchoires se crispent. C’est la peur qui déroule, qui enfle.
La peur est partout, irraisonnée. Les mères surtout. Pour les petits, qui ne veulent pas rentrer, pour les hommes qui sont loin, aux champs, à l’usine, à la guerre Ils sont là à côté, à attendre le feu du ciel qui les fortifiera. Ces hommes qui jouent les héros d’un jour poitrine en avant, bravant les éléments. Inondés de pluie chaude, les cheveux collés aux tempes, ils veulent dire à leurs belles qu’elles n’ont rien à craindre.
Il y a ceux qui attendent l’amour qui suivra quand les mains se retrouveront, quand les doigts encore humides de chaleurs se diront qu’il est temps de se serrer l’un contre l’autre. L’amour aime l’orage.
Et il y a ceux qui attendent l’eau, un espoir pour la terre, un répit pour le jaune paille de l’été. Ils attendent.
L’orage est partout, il a envahi le pays. Il n’a pas choisi le quatorze juillet ! Foutaises ! Il s’en moque du quatorze juillet, du calendrier, de la vie d’en bas, de ce qu’on dira de lui quand il sera passé, demain. Il s’en moque qu’on le mesure, qu’on le rêve, qu’on l’espère qu’on l’emmagasine dans les machines à banalités. Il est venu pour frapper. L’orage n’a pas besoin qu’on l’aime, ni qu’on l’attende. Il ne vient pas seul, il envoie quelques éclairs, quelques coups de vents qui inquièteront, qui rafraîchiront. Ce sont les préliminaires pour que les corps se tendent, que les gorges se nouent.
Quand le silence est absolu, quand chaque vivant retient son souffle il envoie la première semonce. Terrible, sec, comme le signe que tous redoutent.
Les orages du quatorze juillet comme une litanie que chacune récite toutes les années. Quelques-uns qui les attendent quelques autres qui les redoutent et au milieu de tous, deux trous de fraîcheur dans la chaleur il y a Jules et Lisa. Leurs mains se cherchent. Il la cherche, elle l’espère.
Il, elle : deux histoires écrites en parallèle et qui se retrouvent.
Ils ont passé si peu de temps ensemble, si peu pour deux qui s’aiment depuis toujours.
Ils n’en peuvent plus de se séparer de se déchirer, de s’attendre, de s’espérer. Ils n’en peuvent plus de ce temps qui n’est pas pour eux, de ce temps qui partage la vie entre ce que l’on voudrait, ce que l’on a, et qu’on oublie. Le temps n’est pas fait pour ceux qui comme Jules et Lisa fonctionnent de travers.
Jules, Lisa, deux naufragés du linéaire. Jules et Lisa deux chercheurs d’émotions dont ils sont les seuls à comprendre la mélodie.
Jules et Lisa. Ils sont au milieu de tous. La ville les entoure. Ils se sont retrouvés hier ou il y a plus. C’est peu de dire qu’ils s’aimaient déjà. L’orage les a cherchés, enfants de sa passion. Demain ils seront loin, ils partiront ailleurs, là où le temps ne signifie plus rien, là-bas à un bout de la terre. Jules en rêvait et demain il le fera. Ils partiront, pour Rose, pour leurs mères qui dormaient, qui ne voulaient pas les entendre crier, il y a trente ans. Ils partiront pour commencer l’histoire, l’autre histoire, celle qui s’écrira plus tard avec de mots encore en gestation, dans des livres qu’il reste toujours à écrire.
Ils se tiennent du bout des doigts, la nuque raidie à trop scruter le ciel, ils se sentent emplis de larmes. Lui, il est au sommet du bonheur. Elle n’en croit pas ses yeux. Les autres ont disparu, aspirés. Sur leur visage, il y a des écoulements, pluies, larmes, sueurs. Ils sont liquides.
Derrière leurs yeux, l’histoire d’une vie, petite histoire qu’on écoute les soirs d’automne quand la mélancolie déverse son trop plein sur les couples en attente d’émotions.
Derrière les yeux il reste la mémoire qu’ils se sont fabriqués à deux, une mémoire qu’ils emmènent pour unique bagage. Les souviens-toi qui tiennent si chaud quand le noir de la nuit vous fait frissonner.
Comme je suis un peu en panne d’inspiration, je continue de publier, sans coupures, de publier mon troisième roman…

Ils s’aimaient. Ils s’aimaient et on ne peut pas le raconter. C’est si délicat de trouver les mots, de retrouver leurs mots pour qu’ils s’entendent avec amour. Des mots, il y en a tant et trop ne font que du bruit. Ils se sentent gênés, perdus, quand on les libère de leurs prisons alphabétiques. Ils cherchent un nouvel emplacement, un nouvel ordre ou la grammaire rime avec les paroles de tendresse. Il y en a qui se perdent quand on les libère. Ils s’étonnent d’être là parmi gestes, sons, odeurs. Ils existent ailleurs que dans une liste. Ces mots ils en avaient apprivoisé quelques-uns, ils les tenaient aux creux de leurs mains jointes.
Eux, lui, elle. Ils s’aimaient sans le dire, ils s’aimaient sans questions, sans doute. Ils s’aimaient, c’est tout. Depuis le premier jour, depuis cette secousse qu’ils avaient reçue tous les deux, ils s’aimaient. Et c’était étrange, pour les autres pour ces autres ceux qui fabriquaient des histoires d’amour convenables, normales, des histoires d’amour qui respectent le code, les règles. C’était étrange, ils étaient étranges, merveilleusement étranges. Merveilleusement, c’est le mot juste, celui qui adoucit, qui nettoie le mot qu’il accompagne pour en faire une douceur. Cette douceur dont ils étaient parfois si loin.
Malgré tous les adverbes du monde, ils n’en pouvaient plus de chercher, ils n’en pouvaient plus d’essayer de trouver toutes les réponses qu’il faut pour comprendre les regards durs et droits que les autres portent sur les étranges, ceux qui ne marchent pas comme les autres, qui sont déréglés comme des machines qui s’emballent. Ils n’en pouvaient plus, c’est tout. C’est épuisant de ne jamais parvenir à monter sur scène. Tous les autres y sont déjà, tête haute. En plus, les autres ils vous observent, comme dans ces mauvais rêves où les jambes sont lourdes, si lourdes que même éveillé l’idée d’avancer devient pesante.
Et puis, il y avait eu l’orage. Encore une fois. Les cœurs s’emballent. Pas de douleurs, ils sont heureux de se trouver, de se toucher. Eux, lui, elle. Les mots sont inutiles. La pluie les entoure, les aide à s’unir, les aide à s’enfuir.
Ils attendaient ce jour depuis si longtemps.
Aujourd’hui ils débutent une nouvelle existence, coincés entre le papier et les mots des autres. Ce matin ils ne sont plus qu’une question à la une d’un journal de province, une question pour que les autres parlent : ceux du 14 juillet et plus encore, ceux qui ont la parole lourde. Demain tous se souviendront, tous les abîmeront.
Depuis ce matin je suis grand-père pour la quatrième fois. J »ai écrit ce texte pour lui, pour nous…

Léon
Le matin s’annonçait lourd,
Poisseux, gluant,
Un mardi pesant,
Déterminé à rouler sa longue litanie
D’ombres confinées…
Et soudain,
Mon cœur se met à chanter,
Mélancolie doucement s’est retirée,
Oui là,
Au bord de la mémoire tiraillée,
Un bouquet de couleurs,
Sur mon bonheur s’est imprimé.
On oublie le gris,
On rit, on pleure, c’est lui.
Le voici, il est là…
Petit d’homme
Aux aurores s’est annoncé.
J’arrive nous dit-il…
J’entre dans votre monde,
Oh je sais,
Il est un peu abimé,
Mais ne vous inquiétez pas,
Je vous ai entendu,
Oh oui,
Vous m’avez déjà tant aimé
Vous m’avez attendu
Vous m’avez espéré
C’est fait, je suis là
Je vais vous rassurer
Je suis Léon,
Et ce monde que vous m’avez rêvé
Avec vous tous,
Nous allons le réparer…
14 avril…
J’alterne, des débuts de nouvelles que je vais poursuivre, et toujours mon roman, le troisième, j’ai publié le début l’autre jour, je continue, ce ne sont plus des extraits, mais la suite, sans coupures pourquoi pas tout le publier par petits bouts….

On est encore dans le hier de leur histoire. Il est nu. Il veut sentir les premières gouttes. Il est en elle, depuis les premiers éclairs. Elle n’ouvre plus les paupières, toute entière consacrée à l’amour. La lumière change à chaque mouvement. Il ne se lasse pas. Il la contemple à pleins yeux, à s’en dilater les pupilles. Il s’emplit les narines des mille parfums de son corps. Il l’effleure, simple picotement. Il attend : la peau frissonne, vibre. Il accélère, appuie un peu. Le souffle est court, saccadé.
Il entend. Il l’entend avec le bout de ses doigts, de sa langue ; toutes les surfaces se touchent. Il ressent le souffle d’air venu de l’intérieur, les cascades, le débordement. Il sait qu’elle ne tremble pas. Elle ondule, légère, apaisée, voile du navire au repos, vapeur qui s’envole en silence.
A eux deux ils fabriqueront le sixième sens. Elle est bien. Bien dans la peur de l’orage, bien quand il s’approche d’elle, bien quand il lui prend la main, doucement, sans un mot.
Et la pluie, brûlante au début, piquante ensuite, comme des aiguilles qui poussent à l’intérieur. La peau ruisselle, le tonnerre gronde. Il la protège, veut la voir jouir quand le plus bel éclair brillera.
Et soudain un éblouissement, un orgasme, les deux fusionnent. Ils crient leur plaisir.
Ils hurlent leurs douleurs. C’est un appel. Un rappel qui contient leur histoire. Ils hurlent : on ne sait pas, on ne sait plus. Le cri est une déchirure dans l’air brûlant. Comme une plaie qui saigne abondamment et où on ne peut éviter de poser le regard.
Le cri ne s’écoute plus, il est un fond sonore, il s’est fondu dans le décor, on le vit, il est… Il n’est pas puissant, il est vivant. Un cri qu’ils sont seuls capables d’achever. Ils le connaissent, il est né avec eux.
C’était hier, ou il y a plus longtemps. C’était une nuit si singulière.
C’est fini. Ils ne chercheront plus, ils n’attendront plus que l’autre revienne. C’est fini, ils ne sont plus. Le quatorze juillet, épilogue d’une histoire où les autres n’ont jamais existé. C’est fini, serrés l’un contre l’autre dans un pré, ils ont trouvé le chemin.
En haut, sur le bas-côté de la route qui domine la prairie fauchée de frais, quelques voitures, une ambulance. Plus loin, plus bas, la ville. Elle les attendait ce matin, comme tous les matins Elle les attend depuis le jour où elle les a vus naître, depuis cette première nuit où ils se sont aimés pour toujours, ce toujours qu’ils ont mis tant de temps à apprivoiser.
Plus tard, dans quelques lendemains sans sourires, dans le monde des autres on se souviendra peut-être de ces deux qui s’aimaient, de ces deux qui cherchaient, de ces deux qui avaient perdu tant de temps pour découvrir leur amour.
C’est fini, la lumière les a écrasés, un drap les a recouverts, une housse les a séparés, ils sont partis là-bas vers les nuits mauves qui emplissaient les rêves qu’ils avaient ensemble.
Un peu en mal d’inspiration poétique en ce moment, et oui les gares me manquent, je me lance un défi, j’ai beaucoup de débuts de textes, nouvelles ou autres, que j’ai laissées en chantier, je vais donc me mettre la pression en publiant ces débuts et en m’obligeant à poursuivre…. Et n’hésitez pas à me rappeler à l’ordre…

Il a eu une légère hésitation, mais après une longue journée de travail, avec en plus cette maudite valise à roulettes à traîner s’éviter un petit effort supplémentaire est bienvenue. Au diable les discours moralisateurs de tous les nouveaux prêcheurs du bien-être.
Il appuie sur le bouton d’appel : la cabine est déjà là. Ce sont d’insignifiants petits événements mais qui donnent facilement le sourire.
Curieusement, quelqu’un est déjà dans la cabine. Cabine au demeurant minuscule. Deux personnes, une valise et c’est déjà presque plein. Pourtant il est écrit : 4 personnes ou 250 kg…. Le voyage sera court, pas le temps de se livrer à des calculs sur le poids moyen autorisé…
Les quelques secondes, peut-être 15 ou 20, sont longues, très longues, trop longues. Il n’aime pas cette proximité, le contact est inévitable.
La cabine grince, ou plutôt couine pour s’arrêter. Il y a ensuite le moment toujours un peu gênant, ou s’enchaînent bêtement les formules de politesse : « bonne journée, je vous en prie, après vous… »
Ils se retrouvent tous les deux dans un couloir étroit, ou plutôt qui devient de plus en plus étroit. Au sol une moquette grise, râpée, usée.

C’est une guerre me dites-vous ?
Oui vous avez raison !
De ma fenêtre ouverte,
Je distingue le champ de bataille…
Le combat a débuté,
Le printemps est bien là,
Il est sur le front.
En première ligne, il envoie des troupes d’élite…
Fleurs blanches légères,
Doux pétales envolés…
La victoire est proche…
11 avril
Mon troisième roman, « un orage en février » , formidable histoire d’amour entre Jules et Lisa est téléchargeable en version numérique e-pub sur le site Kobo, il participera au prix » les talents de demain 2020


Tout loin d’eux,
Il y a le bleu…
Tout là haut,
Il y a le beau…
Tout en bas,
Vieil arbre creux
Tend des bras noueux…
7 avril 2020
Les toutes premières lignes de mon troisième roman…

La nuit s’est effacée, doucement, discrètement, sans gêner la lumière naissante, sans brusquer la fraîcheur qui a pris ses quartiers. De nouvelles ombres prennent leurs places. Elles se dessinent, lentement. Les paupières s’ouvrent, les regards s’éveillent.
Au milieu d’un pré, deux taches. Elles n’y étaient pas hier soir. On distingue les corps étalés, écartelés, sur le foin coupé de la veille. Elle est sur le dos, robe tablier ouverte. On croirait une nappe pour le pique-nique. Sa peau est blanche. Elle attendait l’été pour que les couleurs se posent. Elle attendait ce nouvel été pour ne plus avoir peur.
Elle semble se reposer, apaisée après l’amour. Son visage est calme. On distingue au coin de la lèvre un peu de salive. Elle est sèche, comme une croûte que le sel forme après un bain de mer. Il fait chaud, même la nuit. Ses cheveux sont noirs. Ils brillent déjà, emplis du soleil qui les éclaire. Les yeux sont ouverts, légèrement. On devine une lumière. Elle vient de l’intérieur. Ses yeux sont beaux, ils sont bleus. Les mains sont posées à plat sur le sol, doigts écartés, pour faire contact. Tout autour la terre fume.
L’orage s’est éloigné. Il a laissé un écho, une traînée lourde et moite. Il est allongé contre elle et ajoute une courbe à leurs corps enlacés pour inventer une géométrie de la tendresse. Tête enfouie au creux de l’épaule, main posée, délicate et légère, sur ce corps endormi, il est immobile.
Autour d’eux la terre fume et respire. Elle s’étire. Ils ne bougeront plus. L’orage est passé.

On n’est pas d’un pays, mais on est d’une ville
Où la rue artérielle limite le décor
Les cheminées d’usine hululent à la mort
La lampe du gardien rigole de mon style
La misère écrasant son mégot sur mon coeur
A laissé dans mon sang sa trace indélébile
Qui a le même son et la même couleur
Que la suie des crassiers, du charbon inutile
Les forges de mes tempes ont pilonné les mots
J’ai limé de mes mains le creux des évidences
Les mots calaminés crachent des hauts fourneaux
Mes yeux d’acier trempés inventent le silence
Je me saoule à New York et me bats à Paris
Je balance à Rio et ris à Montréal
Mais c’est quand même ici que poussa tout petit
Cette fleur de grisou à tige de métal
On n’est pas d’un pays mais on est d’une ville
Où la rue artérielle limite le décor
Les cheminées d’usine hululent à la mort
La lampe du gardien rigole de mon style

A la table des quatre saisons,
Comme chaque année,
Je me suis installé…
Et pour monsieur, ce sera ?
Oh pour monsieur ce sera simple !
Un peu de printemps, s’il vous plait.
Et je le veux nature,
Sans fioritures,
Ni fanfares, ni trompettes !
Je vous en prie,
Je suis pressé.
Oh oui,
Il y a tant d’hivers
Que je l’attends.
C’est un printemps
Que je veux déguster
Et emporter…
Oui je le prends,
Tel qu’il est…
Oui ainsi :
Fleuri,
Et pour le service,
Un sourire ou deux,
Et je serai comblé,
Pour tout l’été.
5 avril
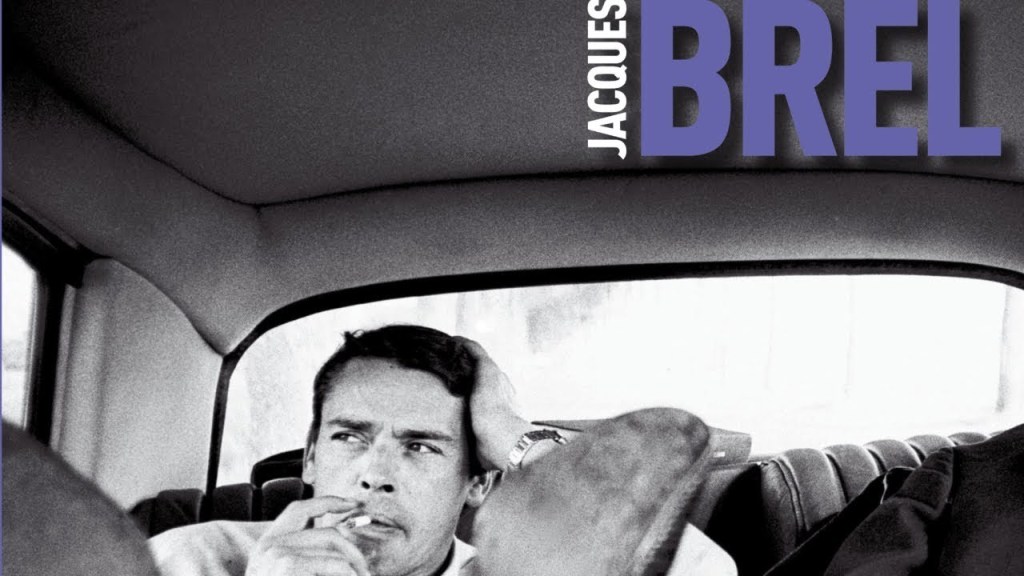
Au printemps au printemps
Et mon cœur et ton cœur
Sont repeints au vin blanc
Au printemps au printemps
Les amants vont prier
Notre-Dame du bon temps
Au printemps
Pour une fleur un sourire un serment
Pour l’ombre d’un regard en riant
Toutes les filles
Vous donneront leurs baisers
Puis tous leurs espoirs
Vois tous ces cœurs
Comme des artichauts
Qui s’effeuillent en battant
Pour s’offrir aux badauds
Vois tous ces cœurs
Comme de gentils mégots
Qui s’enflamment en riant
Pour les filles du métro
Au printemps au printemps
Et mon cœur et ton cœur
Sont repeints au vin blanc
Au printemps au printemps
Les amants vont prier
Notre-Dame du bon temps
Au printemps
Pour une fleur un sourire un serment
Pour l’ombre d’un regard en riant
Tout Paris
Se changera en baisers
Parfois même en grand soir
Vois tout Paris
Se change en pâturage
Pour troupeaux d’amoureux
Aux bergères peu sages
Vois tout Paris
Joue la fête au village
Pour bénir au soleil
Ces nouveaux mariages
Au printemps au printemps
Et mon cœur et ton cœur
Sont repeints au vin blanc
Au printemps au printemps
Les amants vont prier
Notre-Dame du bon temps
Au printemps
Pour une fleur un sourire un serment
Pour l’ombre d’un regard en riant
Toute la Terre
Se changera en baisers
Qui parleront d’espoir
Vois ce miracle
Car c’est bien le dernier
Qui s’offre encore à nous
Sans avoir à l’appeler
Vois ce miracle
Qui devait arriver
C’est la première chance
La seule de l’année
Au printemps au printemps
Et mon cœur et ton cœur
Sont repeints au vin blanc
Au printemps au printemps
Les amants vont prier
Notre-Dame du bon temps
Au printemps
Au printemps
Au printemps

Le tribunal académique s’est réuni aujourd’hui dans son format le plus restreint. Car oui, il a bien fallu se résoudre à le convoquer. Une fois de plus, le cas qui lui est soumis aujourd’hui est un peu particulier.
Le plaignant est un personnage à part, chacun le connaît et pense l’avoir déjà rencontré. Mais rares sont celles et ceux qui peuvent le décrire, si ce n’est pour dire : « oui je l’ai vu, mais il est passé, si vite que je n’ai même pas eu le temps de lui parler. »
Vous l’aurez peut-être compris, le plaignant est le présent. Et évidemment, quand le président du tribunal procède à l’appel, il commence toujours par dire : « à l’énoncé de votre nom, je vous demanderai de bien vouloir répondre présent ».
Et il débute son appel.
C’est l’avocat de la partie civile, c’est-à-dire, de présent qui répond.
Le président du tribunal soupire : il sait déjà que la séance va être compliquée. Il demande à la cour en formation restreinte d’être attentive car il va procéder à la lecture de la plainte déposée par le présent.
« Le présent, absent aujourd’hui, mais représenté par son mandataire, ici présent, a déposé une plainte pour je cite : oubli du présent, falsification du passé, escroquerie sur le futur et surtout, utilisation abusive d’un temps vaporeux, à savoir le conditionnel. »
« Le jury après avoir délibéré, informe le présent que s’il n’a pas été en mesure de prendre une décision concernant tous les temps, il a toutefois considéré que dans cette période, un peu particulière, les conditionnels suivants : il faudrait, il aurait fallu, nous aurions dû, ne pourront plus être employés qu’après avoir pris le temps de les prononcer dix fois de suite en se regardant fixement face à une glace. »
A présent la séance est levée.
4 avril
Envie de republier ce texte écrit, l’année dernière, cela semble si loin, si loin…
J’ai changé la photo d’accueil de mon blog. C’est Ouessant et ses cent vagues… Inspiration

Silence pluvieux,
J’ai la mer au bord des yeux.
Dans le loin bleu
De mes mémoires salées,
Deux ailes se sont envolées.
Vent d’hier,
Sur les vagues les a posées.
Explose l’écume,
S’envolent perles de brume.
Regarde la mer belle.
Sur la plume de tes mots
A la feuille amarrée,
Mer a chanté,
Mer a soufflé.
8 décembre

Au repas des bavards
Entre la poire et le Saint-Nectaire
J’ai sorti un reste de silence,
Que je gardais bien au chaud…
Et quand est arrivé
Le chariot des commentaires,
J’ai saupoudré deux pincées de rien,
Sur tous ces mots de trop…
2 avril

J’ai ouvert une fenêtre oubliée,
Sur la façade nord
De ma mémoire étonnée.
Dans un trou de lumière bleue,
J’ai plongée ma plume engourdie,
L’ai posée sur les douces rides,
Du soir tombant qui s’étire.
Quelques mots légers,
Pour la nuit j’ai réveillés…
Et tes pâles lèvres sucrées,
Doucement ont murmuré…

Je voudrais une fête étrange et très calme
avec des musiciens silencieux et doux
ce serait par un soir d’automne un dimanche
un manège très lent, une fine musique
Des femmes nues assises sur la pierre blanche
Se baissent pour nouer les lacets des enfants
Des enfants en rubans et qui tirent des cerfs-volants blancs
Les femmes fredonnent un peu, leur tête penche
Je voudrais d’éternelles chutes de feuilles
L’amour en un sanglot un sourire léger
Comme on fait entre ses doigts glisser des herbes
Des femmes calmement éperdues allongées
Des serpentins qui voguent comme des prières
Une danse dans l’herbe et le ciel gris très bas
lentement. Et le blanc et le roux et le gris et le vert
Et des fils de la vierge pendent sur nos bras
Et mourir aux genoux d’une femme très douce
Des balançoires vont et viennent des appels
Doucement. Sur son ventre lourd poser ma tête
Et parler gravement des corps. Le jour s’en va
Des dentelles des tulles dans l’herbe une brise
Dans les haies des corsages pendent des nylons
Des cheveux balancent mollement on voit des nuques grises
Et les bras renvoient vaguement de lourds ballons
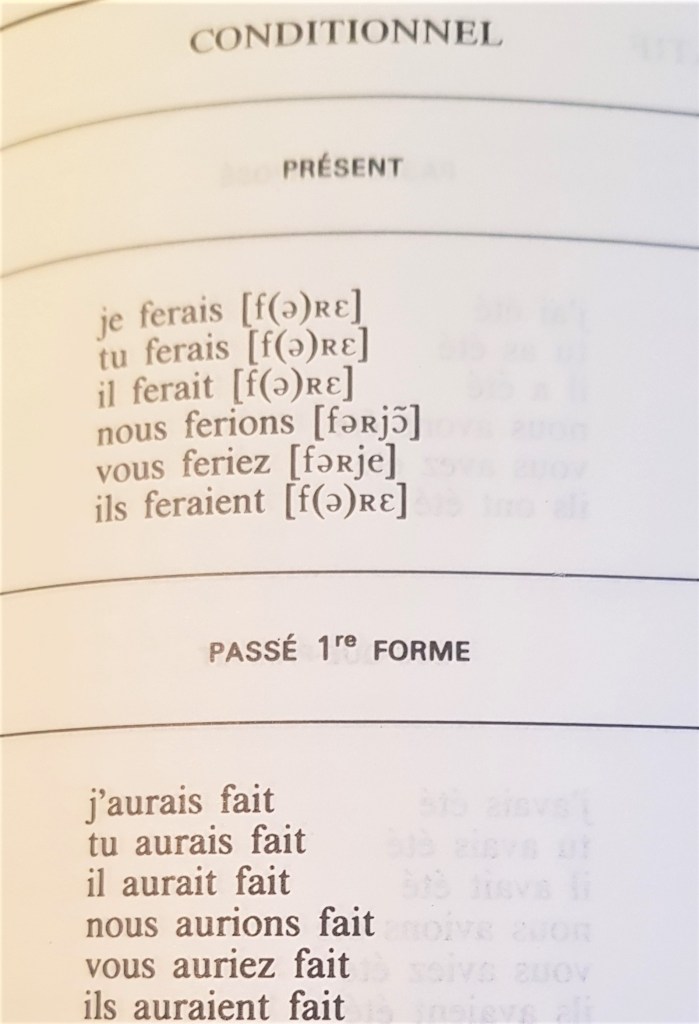
On aurait dû,
Il aurait fallu,
Il faudrait que,
Ne serait-il pas mieux,
Ne faudrait-il pas ?
Il suffit vous dis-je !
Oubliez le conditionnel,
Respirez, écoutez…
Au présent, je vous le dis
Puisque vous aimez tant conjuguer,
Tenez,
Je vous propose
Ce si joli verbe aimer
Prenez-le,
Écoutez-le,
Et si le cœur vous en dit,
Vous pourrez le conjuguer
A tous les temps de votre impatience….
30 mars

Le ciel est au plus bas,
Lourd d’un gris épais.
Il pèse sur les épaules rentrées,
Des quelques ceux qui errent
A la recherche d’un printemps
Que quelques oiseaux impatients
Ont appelé en sifflotant…

Dans ma boîte à couleurs
Je cherche ce mot qui tinte,
Je le voudrais doux et gai.
Un mot pour apaiser
Un mot pour aimer.
Et sur ma feuille pâle d’ennui,
Ivre de couleurs
Le poserai sans un bruit…
28 mars
Je mets en ligne sur ma page facebook, les enregistrements de mes lectures du tibunal académique, rubrique que vous connaissez bien et que vous appréciez, je crois.

Norme : Je viens d’apprendre à l’instant, chère Beauté, qu’une fois de plus vous vous êtes égarée.
Beauté : Egarée ? Nullement, sachez chère Norme, que si je me suis posée ici, sur cette belle fleur de pissenlit, c’est parce que je le voulais, et surtout parce qu’il le fallait.
Norme : Une fleur de pissenlit ! Pourquoi pas du chiendent, ou non du trèfle, oui tiens du trèfle ! Encore une fois je me dois d’intervenir. Je vous le dis, je vous le répète : jamais, je dis bien jamais, vous ne devez prendre la liberté de vous poser où bon vous semble, sans au préalable ne m’en avoir parlé…
Beauté : Je vous entends, je vous entends chère Norme, mais sachez que je ne me pose jamais au hasard…Voyez-vous ce que j’aime par-dessus tout, c’est la légèreté, la douceur, la délicatesse et surtout la discrétion. Vous conviendrez que ce ne sont pas les premières qualités de toutes ces fleurs qu’habituellement vous m’imposez dans vos plans de vols.
Norme : Mais enfin Beauté, reprenez-vous, je ne vous demande pas de faire de la poésie, mais simplement d’ouvrir les yeux. Regardez autour de vous, ces jonquilles, ces roses qui éclosent. Vous ne me direz pas que ce vulgaire pissenlit mérite plus qu’elles qu’on leur rende les honneurs qu’elles méritent.
Beauté : Je vous écoute chère Norme et je ne vous dis pas que les fleurs que vous me citez doivent être oubliées, mais voyez-vous, il est des jours, où la beauté ne vous appartient plus. Elle s’envole, elle respire, elle est libre… Alors oui, je persiste dans ma désobéissance, et , je le sais, chère Norme vous n’aurez pas à le regretter…
28 mars

Ils s’étaient donnés rendez-vous au « temps qui passe », bistrot gris d’un quartier oublié. La façade est d’un gris fatigué. On ne pouvait avoir envie d’entrer ou alors pour un besoin pressant, une soif implacable, une attente à tuer, une rencontre à protéger.
Jules ne le connaissait pas, il fréquentait peu les bars par peur de ne jamais y être reconnu. Il préférait les longues promenades solitaires, sans but, tout droit, jusqu’à ce que les jambes soient dures, qu’on les ressente très fort, comme une gêne, comme une excroissance, comme un morceau de soi qu’on finit par oublier. Lisa lui avait proposé ce rendez-vous très vite, comme on demande l’heure, une phrase qui claque au vent : « on pourrait se revoir au temps qui passe, demain à dix sept heures ». Une phrase qui fait du bien, qu’on voit sortir de la bouche, et se poser sur le regard de l’autre.
Ce sera une rencontre souvenir, un prétexte pour s’attendre. Jules rêvait d’un amour qui commence dans un lieu débordant de gris, d’automne. Il n’avait jamais cru aux rencontres sous ciels étoilés, celles qu’on imagine lorsqu’on s’inocule dans les veines le poison qui circule dans les tubes cathodiques.
Il est arrivé le premier. En avance, légèrement en avance, comme toujours. Pour ne pas risquer d’être surpris. Sa montre lui annonce seize heures cinquante. A peu prés, il sait bien qu’elle est inutile, qu’elle ne lui promet que du temps en trop, à gaspiller. Il sait bien qu’il est en dehors de tout, ou à côté. Et c’est pour cette raison qu’elle lui a plu et qu’elle l’a remarqué. Ils se sont rencontrés dans une marge, à l’écart de tous les autres, en dehors de tous les principes.
Elle arrive, essoufflée. Elle a couru. Comme toujours, elle s’excuse en regardant sa montre.
Jules observe Lisa qui entre. D’abord il y a son sourire. Quand elle sourit, elle a les yeux qui lui disent : « serre moi contre toi, là tout de suite, n’attend pas, serre-moi à m’en étouffer, à m’en faire perdre la tête ». Elle a les yeux qui disent merci. Quand elle est entrée, qu’elle a poussé la porte, ça a fait comme quand il ferme les yeux. Jules quand il ferme les yeux pour fabriquer de la mer et du vent. Quand elle est entrée, Jules a senti des mains lui pousser au bout des bras. Il est embarrassé, elles sont là, au bout, elles attendent Lisa, elles aussi. Elles se contenteront d’un simple effleurement, léger comme un voile qui tombe…
Et les doigts qui se touchent, qui se parlent. Quand on lève les yeux, il y a le regard de l’autre, qui n’en peut plus d’attendre, encore. C’est si long pour choisir le mot qui suffira, le mot cadeau, le mot qu’on fera venir de l’intérieur, chargé d’une histoire.
Lisa est entrée. Tout à l’heure, les couleurs étaient fades avec des odeurs de serpillière. Lisa est entrée, elle est assise en face de Jules, a posé ses mains sur la table. Ils ont commandé un café, c’est simple, ils n’ont pas envie de réfléchir.
Le texte que j’ai proposé il y a trois jours au site « Short-Edition » est en compétition pour le prix des lecteurs. Si le cœur vous en dit, vous pouvez le soutenir ici :
https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/en-route-vers-la-bibliotheque





Il y a des mots si beaux,
Je voudrais les protéger, les éloigner
De toute cette boue numérique
Il y a des mots si durs,
Je voudrais les rassurer, les enchanter
Et doucement,
Quand le soir a tout avalé,
Un a un,
Léo, Albert, Jacques
Simplement écouter.
27 mars

La lune prodiguait une lumière crue et puissante… Au milieu du chantier se dressaient trois tas de charbon, de taille égale, séparés les uns des autres, malgré les éboulements qui brisaient la pointe de leurs sommets et tentaient de rapprocher leurs bases en les élargissant. Tous trois renvoyaient avec force la lumière qui les inondait ; une muraille de plâtre n ‘eût pas paru plus blanche que le versant qu’ils exposaient à la lune, mais alors que le plâtre est terne, les facettes diamantées du minerai brillaient comme une eau qui s’agite et chatoie. Cette espèce de ruissellement immobile donnait aux masses de houille et d’anthracite un caractère étrange ; elles semblaient palpiter ainsi que des êtres à qui l’astre magique accordait pour quelques heures une vie mystérieuse et terrifiante. L’une d’elles portait au flanc une longue déchirure horizontale qui formait un sillon où la lumière ne parvenait pas, et cette ligne noire faisait songer à un rire silencieux dans une face de métal. Derrière elles, leurs ombres se rejoignaient presque, creusant des abîmes triangulaires d’où elles paraissaient être montées jusqu’à la surface du sol comme d’un enfer. La manière fortuite dont elles étaient posées, telles trois personnes qui s’assemblent pour délibérer, les revêtait d’une grandeur sinistre. A les regarder longtemps, dans le silence de minuit, sous un ciel noir au fond duquel la lune semblait fixée pour toujours, elles devenaient aussi effroyables que des dieux spectateurs d’une tragédie où le sort même de la création se jouerait.

Tu t’es pris les pieds dans le lourd tapis de la nuit,
Assis au bord de ton lit
Entre tes mains, ta tête tu as pris.
Souviens-toi, nous étions vivants,
Tu riais, je parlais, insouciant.
Sur nos lèvres séchées par le vent,
Dansaient les mots taquins,
Sautillaient les mots malins,
Coulaient les mots chagrins.
Dans un coin reculé,
De notre hier oublié,
Je t’entends, je te vois, tu es resté.
26 mars
Il y a bien longtemps que nous n’avons pas retrouvé Maurice, cet incroyable Maurice, qui rêve de la mer…

La mer Maurice, il l’a d’abord inventé, il l’a d’abord importé là en plein Limoges, c’est la sienne, elle est en lui et tous les soirs elle l’appelle.
Un matin Maurice a décidé de prendre le train pour aller voir la mer. Comme tous les jours il s’est levé le dernier, ses deux jeunes sœurs sont encore autour de la table, cheveux tristes derrière les bols ébréchés. Sa mère est là aussi, debout devant l’évier. Sa mère, maman comme il dit encore parfois, toujours de dos, elle parle peu, mais on sait toujours ce qu’elle va dire, alors elle ne le dit plus, elle se contente de hochements de têtes, de soupirs et haussements d’épaules. Ailleurs, quand elle abandonne son évier elle devient Jeannine et elle bavarde dans la rue avec les autres, les copines du marché, ou celles du coiffeur.
Maman s’est retournée et lui a apporté son bol, elle lui apporte toujours son bol parce qu’il est son fils, son grand fils. Ce matin elle voit bien qu’il va parler, la cuillère ne tourne pas pareille dans le bol contre la porcelaine, cela va trop vite. Maurice souffle sur le bol, il souffle toujours sur son café au lait, c’est son merci à lui, il souffle et il dit à Jeannine qu’il va prendre le train dans une heure, le train pour la Rochelle. Sa mère n’a pas bougé de l’évier, elle n’a pas haussé les épaules, Maurice sait ce que ça veut dire, elle sait. Elle ne dit rien mais il répond qu’il sera rentré Dimanche, il dormira dans une auberge de jeunesse. Il avale plusieurs goulées du café déjà tiède, ses sœurs ont levé les yeux sur lui. Il sourit. Jeannine s’est approché de lui : « je le savais que tu voudrais y aller ». Il a encore souri puis il s’est levé et s’est étiré. La Rochelle, son père lui en avait parlé, mais il voulait voir, il voulait sentir, il voulait comprendre : la mer dans la ville.

Regarde,
Non, mais regarde le,
Ce ciel qui s’étire,
On le dirait heureux !
Il est tout à son aise,
Il a la brume légère,
Et le gris facétieux.
Ciel reprends toi,
On t’attend tous au coin du bleu
25 mars
Le site « Short Edition » organise un concours, il s’agit d »écrire un texte sur le thème » un peu d’air », voici ce que je leur ai proposé

« Je n’en peux plus, je ne veux plus, je veux m’échapper, je veux prendre l’air et m’envoler ! ». Ce matin Jules s’est levé en sueur.
« Je n’en peux plus, je ne veux plus, je veux m’échapper, je veux prendre l’air et m’envoler ! ».
Ces paroles ne le quittent pas. Elles sont là, elles résonnent, ou plutôt elles chantent au fond de son crâne douloureux.
Jules ne se souvient que très rarement de ses rêves. Mais ce matin, il sait, il sent. Il est certain que ce sont des paroles qu’il a entendues cette nuit, dans son sommeil. Il lui semble même reconnaître cette voix. Une voix douce et gaie. Il faut dire que Jules vit seul, et débute sa journée, comme il l’a finie : dans le silence. C’est pour cette raison qu’il aime tant la compagnie de cette voix, comme une caresse qui le réconforte.
Tous les matins depuis dix jours il prend le temps de faire le tour de son appartement avec ce nécessaire regard d’explorateur, comme s’il découvrait à chaque fois, un territoire inconnu. Oh ce n’est pas très grand, mais il a suffisamment d’imagination pour s’inventer à chacune de ses tournées des aventures nouvelles. Il s’attend toujours à être surpris, à découvrir, qui sait, un coin encore vierge, dans une des quatre pièces de son logement. Intérieurement il sourit de sa naïveté : comme si les lois de la géométrie pouvaient à la faveur de ce confinement être bouleversées. Ce serait incroyable que je sois le premier à découvrir que dans certains rectangles, on peut trouver un cinquième coin. Pauvre Jules, il est seul et ne sait plus quoi inventer pour s’aérer, pour s’obliger à ne pas rester enfermé entre ces quatre murs. Quatre murs ? Il faudra peut-être que je recompte se dit-il ?
« Je n’en peux plus, je ne veux plus, je veux m’échapper, je veux prendre l’air et m’envoler ! ».
Toujours ce refrain qu’il entend, petite voix désormais familière. Il a même l’impression qu’elle se rapproche désormais
Après avoir traversé le long couloir – sans faire de pause s’il vous plait- Jules se trouve désormais devant sa bibliothèque.
Jules commence par un long moment d’admiration, presque de la contemplation. Il est vrai qu’il a un côté maniaque qu’il assume totalement ; il ne se passe pas journée, en période normale, sans qu’il ne caresse les dos alignés de ses très nombreux livres, il les bouge parfois légèrement, souffle sur le dessus, persuadé que la poussière s’est encore invitée et va coloniser les pages.
Jules aime les livres, nous l’aurons compris. Et depuis le début de cet enferment imposé, Jules accomplit son rite plusieurs fois dans la journée. Nous ne sommes pas loin reconnaissons le de l’obsession.
Bref, Jules après la longue traversée du couloir sombre et aride est là, raide et rigide, plantée devant les rayons de sa bibliothèque. Une belle bibliothèque, bien fournie car Jules nous l’aurons compris aime les livres.
« Je n’en peux plus, je ne veux plus, je veux m’échapper, je veux prendre l’air et m’envoler ! ». La voix semble se rapprocher.
Jules aime les livres bien sûr, mais Jules aime les oiseaux aussi, il est même passionné, il aime les observer, les écouter, et surtout, Jules aime quand ils s’envolent… Nous aurons donc compris que comme Jules aime les livres et qu’il aime aussi les oiseaux, Jules a beaucoup, mais alors beaucoup de livres sur les oiseaux.
« Je n’en peux plus, je ne veux plus, je veux m’échapper, je veux prendre l’air et m’envoler ! ».
Et d’un coup, d’un seul Jules comprend. Les livres, les oiseaux, la fenêtre toujours fermée. Jules saisit un de ces magnifiques livres, qu’il aime tant feuilleter. Celui qu’il tient est un livre sur les oiseaux de mer, il le sort délicatement, caresse amoureusement la couverture et l’ouvre, lentement, très lentement…
« Je n’en peux plus, je ne veux plus, je veux m’échapper, je veux prendre l’air et m’envoler ! ».
25 mars 2020

Je me suis endormi
Dans le doux roulis
De vague belle et fidèle
Fermant les yeux
J’ai poussé une grille rouillée
La mer est là doucement échevelée
De ses longs bras bleus
Elle me serre heureux
Lente peur noire
S’éloigne au large de la mémoire
24 mars

Quand y’a la mer et puis les chevaux
Qui font des tours comme au ciné
Mais que dans tes bras c’est bien plus beau
Quand y’a la mer et puis les chevaux
Quand la raison n’a plus raison
Et que nos yeux jouent à se renverser
Et qu’on ne sait plus qui est le patron
Quand la raison n’a plus raison
Quand on raterait la fin du monde
Et qu’on vendrait l’éternité
Pour cette éternelle seconde
Quand on raterait la fin du monde
Quand le diable nous voit pâlir
Quand y’a plus moyen de dessiner
La fleur d’amour qui va s’ouvrir
Quand le diable nous voit pâlir
Quand la machine a démarré
Quand on ne sait plus bien où l’on est
Et qu’on attend ce qui va se passer
Je t’aime
Je t’aime pour ta voix pour tes yeux sur la nuit
Pour ces cris que tu cries du fond des oreillers
Et pour ce mouvement de la mer pour ta vie
Qui ressemble à la mer qui monte me noyer
Je t’aime pour ton ventre où je vais te chercher
Quand tu cherches des yeux la nuit qui se balance
A mon creux qui te creuse et d’où ma vie blessée
Coule comme un torrent dans le lit du silence
Je t’aime pour ta vigne où vendangent des fées
Et pour cette clairière où j’éclaire ma route
Que balisent tes cris durs comme deux galets
Que le flot de la nuit roule sur ma déroute
Je t’aime pour le sel qui tache ta vertu
Et qui fait un champ d’ombre où ma bouche repose
Pour ce que je ne sais quoi dont ma lèvre têtue
S’entête à recouvrer le sens et puis la cause
Je t’aime pour ta gueule ouverte sur la nuit
Quand ta sève montant comme du fond des ères
Bouillonne dans son ventre et que je te maudis
D’être à la fois ma soeur mon ange et ma Lumière
Quand y’a la mer et puis les chevaux
Qui font des tours comme au ciné
Mais que dans tes bras c’est bien plus beau
Quand y’a la mer et puis les chevaux
Quand la raison n’a plus raison
Et que nos yeux jouent à se renverser
Et qu’on ne sait plus qui est le patron
Quand la raison n’a plus raison
Quand on raterait la fin du monde
Et qu’on vendrait l’éternité
Pour cette éternelle seconde
Quand on raterait la fin du monde
Quand le diable nous voit pâlir
Quand y’a plus moyen de dessiner
La fleur d’amour qui va s’ouvrir
Quand le diable nous voit pâlir
Quand la machine a démarré
Quand on ne sait plus bien où l’on est
Et qu’on attend ce qui va se passer
Je t’aime

Printemps n’a pas attendu.
Outrés, les prophètes du temps qu’il faut, ont parlé :
Un peu de patience voulez-vous…
Un peu de décence, pourriez-vous…
Nous vous en prions,
Freinez vos ardeurs.
Retenez vos fleurs.
Vous le voyez bien,
Ici, là, partout,
Déborde le gris.
Rien n’est prêt.
Pour vous accueillir
Vous le comprendrez,
Il nous faudrait nettoyer.
Rien n’est grave,
Sourit le printemps.
Rien ne presse,
J’ai tout le temps,
J’irai jusqu’à l’été.
23 mars

Certaines nuits, Jules ne dort pas. Le radio réveil fait comme un trou de laideur dans la beauté noire de la nuit. Il déteste ce cœur électronique. Les diodes palpitent et battent la mesure en silence. Pas de rythme, une simple pulsation artificielle, électrique.
Il est seul. Aussi loin qu’il se souvienne, il y a cette chaleur féminine qu’il devine quand il se tourne jusqu’à l’épuisement. Il a peur du noir qui l’entoure, du vide qui l’absorbe.
Jules se touche le corps. Il vérifie son existence. Sa main s’arrête sur le cœur. Il ne bat presque plus, ou si peu. Comme la pendule à quartz. Il n’y connaît rien dans les battements de cœur. Sa spécialité c’est les pendules. C’est la seule chose de son passé dont il se souvient encore. C’est par hasard que Jules avait découvert ce don. Il voulait offrir une montre à sa mère. Une montre pour son anniversaire, une montre à aiguilles. Avec des aiguilles, elles sont vivantes les montres, elles bougent, elles avancent, elles retardent et elles s’arrêtent.
Il se souvient : il regarde la montre qu’il veut offrir, il la regarde si fort que soudain les aiguilles s’affolent, elles hésitent sur le sens à prendre et le bijoutier lui jette un œil mauvais. Lorsqu’il regarde une montre de trop près il se produit les mêmes phénomènes que ceux que l’on décrit dans les histoires polaires dont il raffole.
Ce soir Jules ne dort pas, ce soir Jules regarde Lisa. Elle est étalée dans le sommeil, son corps est si beau. Dès qu’on pose les yeux, il y a comme un frisson, une vague de tendresse qui envahit l’espace. Lisa dort, mais Jules entend qu’elle l’appelle. Lisa dort et son corps l’appelle et dans les yeux de Jules il y a des courbes qui caressent la rétine.
Il oublie la pendule, il oublie toutes les aiguilles et sa main se promène sur la peau, effleure le grain de cette surface qui vit. Elle vibre, il frémit.
Jules ne dort pas. Jules essaie de se souvenir. Il essaie de reconstruire son histoire avec Lisa. Le début, toujours le début, il leur faudrait le début, avec des phrases romanesques, avec des mots sucrés. La vie comme un roman, tout le monde rêve de ces mots assemblés, pour qu’ils disent aux autres, qu’ils racontent. Il murmure dans son insomnie : « quand on s’est rencontré », « la première fois », « le commencement » …Jules ne dort pas, il dessine des lignes sur le tableau noir de ses nuits d’insomnie, sur le noir juste derrière les yeux. Les lignes qu’ils dessinent ont un début, elles ont une fin aussi : le commencement de l’histoire avec Lisa. Ce commencement il ne le voit pas, ne veut pas le voir, ni le poser sur une ligne, aussi belle soit-elle. Il ne veut pas parce qu’il faudrait que chaque nuit il recommence à chercher le chemin, vers l’avant. Avant ce début, il n’y avait rien ni personne. Jules n’en veut pas de ces mots, il n’en veut pas de ces mots qui effacent, comme si les autres n’existaient pas, ailleurs, avant. Lisa il ne l’a pas rencontrée, ils ont trouvé leur place et la ligne devient un cercle. Plus rien ne les arrête.

Prose ?
Pause…
Poésie ?
Pas envie…
Rimes ?
Ah ça non,
Pas de primes…
Pas de rimes…
Métaphores ?
Oh, hé, quoi encore !
Images, vers, sonnets, alexandrins ?
C’est fini, vous n’en avez plus ?
Et bien, je vous le dis,
Encore une fois j’ai vaincu…
22 mars

Jours de lenteur, jours de pluie,
Jours de miroirs brisés et d’aiguilles perdues,
Jours de paupières closes à l’horizon des mers,
D’heures toutes semblables, jours de captivité,
Mon esprit qui brillait encore sur les feuilles
Et les fleurs, mon esprit est nu comme l’amour,
L’aurore qu’il oublie lui fait baisser la tête
Et contempler son corps obéissant et vain.
Pourtant j’ai vu les plus beaux yeux du monde,
Dieux d’argent qui tenaient des saphirs dans leurs mains,
De véritables dieux, des oiseaux dans la terre
Et dans l’eau, je les ai vus.
Leurs ailes sont les miennes, rien n’existe
Que leur vol qui secoue ma misère,
Leur vol d’étoile et de lumière (1)
Leur vol de terre, leur vol de pierre
Sur les flots de leurs ailes,
Ma pensée soutenue par la vie et la mort

Je ne trouve pas l’inspiration…
Comment tu ne trouves pas ? Explique-moi, je t’en prie… Tu prétends que tu ne trouves pas ? Admettons, je veux bien, mais cela signifie, enfin je l’espère, que tu as cherché, et probablement cherches-tu encore !
Oui c’est cela, je cherche, je cherche… Et ne trouve rien…
Étonnant tout de même : je te connais…Il t’en faut si peu : un train qui passe, une flaque d’eau sur un quai, un rayon de lumière derrière une vitre grise, une vague qui grossit et d’un coup, d’un seul, tu as la main qui tremble et le regard qui luit…
Oui je le sais, tu as raison. Je crois comprendre ce qui m’arrive. Je ne dois plus chercher. Il faut que je sois saisi, surpris. Les trains sont loin, toutes les marées sont basses. La lumière elle-même est étonnée de toute cette lenteur, et le ciel, ce ciel tellement étonné qu’on se mette à le regarder…
Et bien tu vois, tu as trouvé, tu es inspiré…
Oui c’est vrai, mais où sont les rimes, où sont les vers, les images, les…
Mais comment tu ne les vois pas, tu ne les entends pas ?
Non je t’en prie dis-moi ?
Chut, ne dis rien, le silence est la rime d’aujourd’hui…
Bon, je sais que c’est dérisoire, peut-être même un peu futile, mais je reconnais quand même que je suis très heureux, très fier, d’avoir été choisi par le public pour ce grand prix hiver 2020 de Short Edition, en plus dans la catégorie des micro-nouvelles. J’avais envie de partager ce plaisir avec vous fidèles de mon blog….
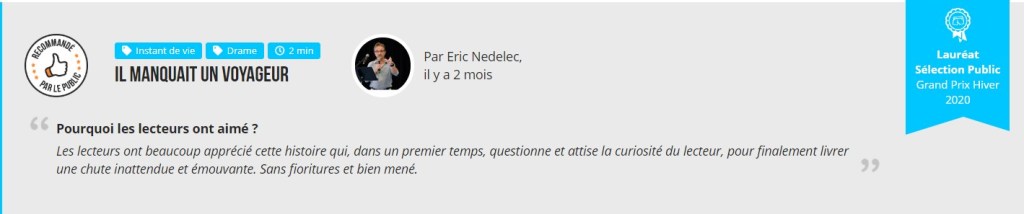

Tu es sorti essoré du combat avec la nuit.
Nuit moite, nuit molle,
Nuit grise qui s’étire,
Gavée de trop longues minutes,
Grasses à écœurer,
Épaisses à étouffer…
Premières heures du matin,
Gluantes,
Empêtrées dans les fils tendus,
De l’horloge qui n’attend plus.
Et puis,
Et puis, tu es sorti,
La lumière est là,
Elle est belle,
Regarde elle te sourit.
Si loin est ta nuit.
20 mars 2020
J’ai commencé depuis lundi le journal poétique de cette terrible période, parce que je sais par expérience que les mémoires sont molles et qu’il est nécessaire de garder une trace…

Homme confiné,
Pousse la porte,
Ecoute…
Comment ?
Tu n’entends rien !
Cherche, cherche,
Homme numérique.
Retrouve les petits cailloux
Que tes pères ont semés,
Sur le chemin
De ta mémoire encombrée.
Retrouve les traces, homme,
Ils sont là,
Je les entends,
Petits bruits oubliés,
De ce monde que tu ne laisses plus chanter.
19 mars

Il me faut prendre le chemin d’un supermarché. Oh non, je ne suis pas en manque de mots, mes réserves sont pleines, et tous les jours, mes rayons je vérifie. Aucuns mots ne manquent, ils sont tous là, sagement alignés. Ils me connaissent et savent que je ne gaspille pas. Oh bien sur j’ai mes rayons préférés, vous les connaissez, tous les jours je les choisis, je les prépare, je les assemble et je vous prépare un bon plat de mots. Non aujourd’hui il me manque un souffle de vent, une vague qui s’étire, le cri d’une mouette sur l’océan. J’ai cherché la case à cocher sur mon laisser-passer…Il n’y a rien, je suis déçu. Je vais rentrer sagement, je le sais, je le sens, la mer est là, elle m’attend…
18 mars
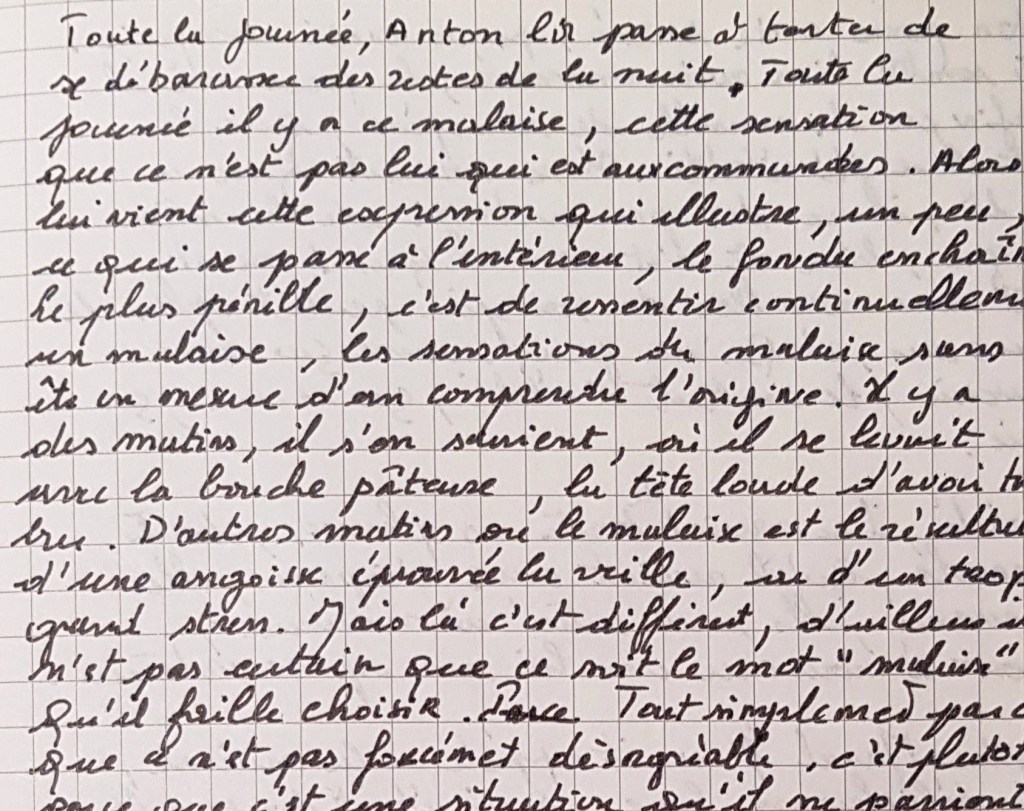
Je vous en prie : aidez-moi !
Je cherche ma rime…
Elle s’est enfuie ;
Partie, effacée, envolée…
Cherchez, courez,
Ma rime est partie,
Il faut la rattraper.
Pourquoi, me dites-vous ?
Je ne sais pas,
Je la tenais pourtant,
Elle était là,
Douce et paisible,
De mes mots je la berçais…
Et puis soudain,
Un sursaut,
Peut-être un mot de trop ?
Oui je l’avoue,
Elle m’a échappé.
Quel était ce mot me dites-vous ?
Je ne sais pas, je ne sais plus.
Ma rime est partie,
Je suis perdu.

Ce monde est fou, me dites-vous ?
Eh bien non,
Je ne vous suis pas !
Vous m’en voyez désolé…
Regardez autour de vous !
Ce monde-là, je ne le vois pas.
Ce monde-là, je ne le veux pas.
Une fenêtre est ouverte,
L’air est doux, parfumé.
Un chant d’oiseau s’est invité
Entends le silence,
Il respire.
Ce monde est doux,
Vous l’avez tant abîmé.
18 mars 2020

Dors. La nuit est une houillère
noyée d’eau noire –
la nuit est un nuage sombre
gorgé de pluie tiède.
Dors. La nuit est une fleur
lasse des abeilles –
la nuit est une mer verte
grosse de poissons.
Dors. La nuit est une lune blanche
montant sa jument –
la nuit est un soleil éclatant
noir et calciné.
Dors,
la nuit est là,
jour du chat,
jour de la chouette,
festin de l’étoile,
la lune règne sur
son doux sujet, obscure.

Homme en presque pleurs
Il est l’heure,
Il est tôt…
Ta bouche est sèche
Du silence d’une nuit agitée.
Le feu de la peur
Dévore les mots.
« Ouvre les yeux,
Homme qui tremble. »
Derrière la vitre,
Nuit moite a tiré le rideau.
Dans les coulisses de ses rêves,
Un pli de ciel brille.
Je le vois,
Il est pour moi.
Je le vois,
Il est à toi.

Comme j’étais mal disposé, un matin de pluie,
pour toutes les excentricités humaines
un ami me montra une photographie :
celle d’une femme nue et morte
étendue sur un lit d’hôtel
à côté d’un homme vêtu et mort
qui, vu en raccourci, ressemblait à un phoque rigide.
Simone n’avait pas changé sa coiffure ;
sa cloche reposait sur la cheminée
à côté d’une pendule dorée sans aiguilles.
Simone était incontestablement morte à côté de son ami.
Ils s’étaient suicidés aux sons du phonographe de la maison voisine :
— Some suny day… Swanie… Eleanor !… —
Et sur le ventre nu de la femme,
avant de mourir,
dans une suprême évocation du Mois de Marie,
l’homme avait écrit, un doigt trempé dans l’encre, ces mots :
Priez pour nous !
*
Cette photographie venait d’un obscur bureau de police.
De mains en mains, elle échouait dans les miennes.
Et l’image ridicule et démoralisante
je l’ai gardée dans ma mémoire
jusqu’au jour où j’ai résolu d’écrire cette histoire,
de la faire imprimer et de la relire plus tard
avec des yeux qui ne seront plus les miens
mais des yeux de promeneur imperméable
assis au crépuscule du soir sur le banc du corps de garde
à la porte du Paradis.
je réussis à écrire de la main gauche…C’est plus long mais elle est plus proche du cœur…

L’écriture est là,
Je la sens,
Je la vois,
Elle coule,
Lente et fragile.
Goutte à goutte,
Elle entre à pleine ligne,
Dans le blanc de la page.
Les mots sont là,
Un par un,
Ils se posent
Sur le fil qui tremble.
Etonnés d’un si long silence
Ils s’écoutent,
Ils s’assemblent.
Mes mots sont là,
Ils nous ressemblent.
Une très mauvaise chute dans le métro ce matin et me voilà le bras droit totalement immobilisé pendant trois semaines…Cela risque d’avoir des conséquences sur ma production créatrice….A moins que je ne dompte ma main gauche….


4
Le tribunal académique s’est réuni ce matin en sa forme plénière et consultative. Il vient, en effet, d’être saisi par un grand nombre de citoyens, et a rendu un avis important, difficile, mais ô combien urgent.
Pour cette occasion, exceptionnelle, un collège de jurés a été constitué. Sa composition est, convenons- en un peu particulière. Y siègent : un poète, une militaire, un adolescent, une militante, un amoureux éconduit, un clown au chômage, une dresseuse d’ours, un cruciverbiste, et une religieuse défroquée…
Revenons aux faits : depuis quelques temps deux mots, et non des moindres, posent un problème. Deux mots qui, si on n’y prête garde, pourraient se ressembler. Il suffit d’ailleurs de les entendre. Deux mots, aussi, qui lorsqu’on écrit sur une feuille de papier un peu verglacée peuvent déraper…
Le président du tribunal résume en quelques mots la décision qui vient d’être rendue.
« Mesdames et Messieurs les jurés, chères et chers collègues, nous nous sommes réunis ce matin pour examiner, vous le savez : Haine et Aime… Les débats ont été animés mais sans haine et c’est cela que j’aime. »
« Aime et Haine vous le savez, vous le constatez, sont proches à l’oreille, ils le sont aussi à l’écrit et nous ne devons plus courir le risque qu’ils soient confondus… »
« A l’oreille, donc, les deux mots sont si proches qu’on les croirait, tout droit, sortis de l’alphabet. M est devant N, c’est un fait. Mais pouvons-nous, acceptons-nous d’en dire autant de Aime et de Haine. Cette promiscuité est nauséabonde, préjudiciable et disons le « inacceptable ». En conséquence nous exigeons, que N soit isolé et relégué à la place qu’il mérite et qui lui revient, en dernière position après le Z. Décision exécutable immédiatement. »
« L’autre problème est le risque de dérapage à l’écrit. Certes nous conviendrons que ce n’est pas courant, mais le collège des jurés souhaite ne prendre aucun risque. Qu’un distrait oublie le H de haine et que la main tremble et ajoute une jambe au n et le mal est fait. Les deux mots doivent, c’est impératif être séparés, distingués. En conséquence, le tribunal décide que quiconque décide d’utiliser ou d’écrire le mot haine doit, au préalable, adresser une demande écrite au collège des jurés qui à compter de ce jour devient un jury permanent. Cette demande devra indiquer les raisons pour lesquels le demandant envisage d’utiliser ce mot. Les jurés ont précisé que cette demande devrait être adressé sur une feuille de papier fleuri, et que la police utilisée serait le colibri… Le demandant sera ensuite convoqué et devra sous contrôle et avec le sourire écrire 100 fois le mot AIME..
5
Je n’ai pas eu d’autre solution pour le dimanche que de convoquer le tribunal académique ! Alors oui bien sûr la première réaction du président et de ses assesseurs a été claire : « non monsieur désolé mais nous ne jugeons pas le Dimanche ». J’insiste, en expliquant que refuser de juger le dimanche, c’est en quelque sorte déjà le condamner, comme s’il s’agissait d’un jour intouchable, sacré, bref, un jour auquel on ne pourrait rien reprocher.
Avec quelques effets de manche, j’ai réussi à les convaincre.
Le tribunal académique est réuni aujourd’hui 23 février en session extraordinaire dans le cadre d’une procédure d’urgence, que la loi autorise, à la seule condition que l’instruction ait déjà été réalisée. Le dossier qui nous a été transmis ce matin, à l’aube, est complet, suffisamment étayée et nous a permis, en conséquence, de délibérer et de prononcer un jugement.
Faites entrer le prévenu ! Dans la salle à moitié vide, tout le monde est impatient de voir arriver ce dimanche aujourd’hui accusé. Mais que diable lui reproche-t-on ?
« Dimanche, levez-vous, je vous prie ! ». Dans le box des accusés, pas un mouvement, rien ne bouge. Les deux gardiens de permanence (deux stagiaires d’ailleurs récemment condamnés par ce même tribunal), qui répondent l’un au nom de « brume » et l’autre de « automne », font grises mines. « Nous sommes désolé monsieur le président mais dimanche dort encore, il prétend que c’est le jour de la grasse matinée et ni rien ni personne ne pourra le faire lever… »
Le président du tribunal ne veut pas passer son dimanche ici et a décidé de vite en terminer.
« Dimanche vous comparaissez aujourd’hui, libre et endormi devant ce tribunal car vous êtes accusé de : mollesse, paresse, ivresse, monotonie, boulimie, ennui et pour terminer j’ajouterai fumisterie ».
« Il est manifeste aussi que vous abusez de votre position dominante, celle de septième jour de la semaine, pour vous reposer sur vos six compagnons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi que nous avons tous entendus comme témoin. C’est ainsi en parfaite illégalité que vous avez organisé une sous-traitance des travaux qui vous reviendraient en vertu de ce principe intangible du droit : « à chaque jour suffit sa peine ». Les faits qui vous sont reprochés entrent, selon le jury, dans la catégorie de l’escroquerie, et de l’exploitation de plus faible qu’autrui car vous prétendez, être, à vous seul le jour du seigneur et en conséquence, vous usez, abusez et profitez de cet attribut, par on ne sait qui attribué pour organiser toute une série de travaux illégaux par les autres réalisés »
En conséquence, le tribunal académique considérant que le seigneur dont vous prétendez être le jour, n’ayant pu être entendu, que le droit à la paresse est un droit universel a décidé à l’unanimité de vous acquitter afin de retourner se coucher…
6
Le tribunal académique est, une nouvelle fois, confronté à un cas épineux. Il doit, en effet, répondre à la plainte qui a été déposé par un mot, que les lois académiques, poétiques et bucoliques protègent envers et contre tous. Contre tous, oui mais, nous allons le voir pas contre tout, et surtout pas contre ces nouvelles lois numériques, aux contenus faméliques dont le code ne se résume qu’à un clic.
Et c’est bien là qu’est le hic…
C’est pour cette seule et unique raison que le tribunal académique est aujourd’hui réuni dans sa formation plénière. Ce qui signifie qu’autour du président, outre les assesseurs habituels ont été convoqués un troubadour, une poétesse, un clown au chômage, un tourneur fraiseur sur tour à commande poétique, une chanteuse boulangère et quelques autres trublions dont j’ai oublié le nom.
Le président du tribunal, se tourne vers la salle, emplie d’un côté d’amoureux heureux et de l’autre, de solitaires éconduits.
« Mesdames et messieurs, nous allons aujourd’hui étudier la plainte qu’a déposée, ce mot que sur toutes vos lèvres je lis, oui vous m’avez compris c’est de j’aime que je veux parler. »
« Aime, vous êtes venus accompagné de votre compagnon j’et c’est donc à vous deux que je m’adresse. Je ne vous demanderai pas, vu les circonstances, de vous lever, et je vous invite donc à écouter ce que le tribunal a décidé. »
« Considérant que j’aime est devenu aujourd’hui un signe que chacun utilise sans aucune réflexion, sans aucune émotion, aussi bien pour signifier son intérêt pour une pizza aux anchois, pour un article sur la crise boursière à Hong Kong, pour tout, pour n’importe quoi, le meilleur et surtout le pire, le tribunal a pris la décision suivante, exécutable immédiatement. »
« A l’unanimité, moins une voix, celle du banquier jongleur, nous instaurons à compter de ce jour une taxe exceptionnelle, dite « taxe qu’on aime ». Chaque clic sur un pouce levé, donnera lieu à une taxe à l’aimant imposé. Son montant sera de un euro par clic. Les sommes collectées grâce à cet impôt qu’on aime seront affectées à la construction d’un nouveau service public que nous avons décidé d’appeler : la MSP : « la Maison du Sourire Public »

1
Ce matin il y a procès au tribunal académique. Quelques mots sont là, coupables de coalition. Le président du tribunal, vient d’appeler automne à la barre.
Il lit l’acte d’accusation :
« Automne, nom commun, vous comparaissez devant cette cour pour le délit de haute trahison. A plusieurs reprises, vous avez été vu, entendu en compagnie des mots suivants : joyeux, bleu, heureux, doux, roux, bucolique et « cerise » sur le gâteau, mou.
Eu égard à la loi du 13 novembre 1912, stipulant qu’automne ne peut être vu qu’en compagnie de gris, morne, triste, venteux, mélancolique, et violon, vous êtes donc en infraction grammaticale, syntaxique et surtout lexicale.
En conséquence et en vertu des pouvoirs alphabétiques qui me sont donnés, je vous condamne à trois ans de travaux forcés. Messieurs les gardiens de la rime, je vous en prie, veuillez accompagner le prévenu… »
« Affaire suivante ! »
2
Ce matin le tribunal académique est bondé. On y juge le gris. Enfin, quand je dis on juge le gris, il conviendrait peut-être plus de dire on juge gris…
Le juge de permanence est d’une humeur massacrante. La veille il a dû participer à une reconstitution un peu pénible, il s’agissait de la scène du crime commis par l’automne au printemps dernier.
Il doit lire l’acte d’accusation mais comme à l’accoutumée il lui faut d’abord rappeler à la cour l’identité du prévenu.
« Gris levez-vous ! »
« On dit de vous dans le compte rendu de l’instruction que vous affirmez être un adjectif mais qu’il vous arrive régulièrement de prétendre être un nom commun. C’est évidemment votre droit et je ne reviendrai pas là-dessus, mais qu’il me soit permis, eu égard à ce qui vous est reproché, de regretter cette autorisation que la loi grammaticale vous octroie… »
Gris, dans le box des accusés accuse le coup, mais ne dit rien, il semblerait même qu’il ait pâli.
Le juge poursuit.
« Gris, vous comparaissez devant ce tribunal car vous êtes accusé d’escroquerie et de tromperie. En effet, à plusieurs reprises vous avez été vu, plusieurs témoignages le confirment, en compagnie de rouge, de jaune, de vert et même de bleu et vous vous êtes étalé au point d’occuper toute la place. Je lis dans l’acte d’accusation qu’à plusieurs reprises ceux qui regardaient se seraient exclamés je cite : « oh que c’est beau ! ».
Gris baisse les yeux. Le juge continue sa lecture.
« Deuxième délit, et non des moindres, vous vous êtes introduit par effraction, et ce à plusieurs reprises, dans de nombreuses poésies et avez pris une place qui ne vous revenait pas, au point même d’obliger l’auteur à chercher des rimes en ris, et la cour doit le savoir mais lorsqu’on cherche à rimer avec le gris, on finit toujours par dire que c’est un mot qui sourit. »
« En conséquence et après en avoir délibéré, la cour vous condamne à rester définitivement entre le blanc et le noir et vous interdit à compter de ce jour de vous produire dans quelque tenue que ce soit lors des couchers de soleil »
« Garde veuillez accompagner le prévenu ! »
3
En cette fin de semaine très chargée, le tribunal académique doit juger un cas très particulier. Il s’agit d’une affaire dont on peut dire qu’elle est un peu trouble. C’est, en effet, sur la base de délations, par le biais de lettres anonymes, que la cour, après une rapide instruction, rend son jugement.
Nous sommes en fin de journée, la lumière a baissé. On distingue à peine le ou la prévenue dans le box des accusés.
Le président du tribunal est gêné : il sait que la salle peut réagir et faire de lui, pour quelques instants, le bouffon qu’il n’est pas. Tant pis, il n’a pas le choix. Il s’éclaircit la gorge et lance le tant attendu : « brume levez-vous ! »
Dans l’assistance, monte un léger murmure et quelques toussotements…
« Brume redressez-vous je vous prie, que les jurés puissent vous distinguer… »
Brume souffre. La lumière blafarde des néons est lourde. Brume a du mal à rester droite et debout et- convenons-en- se tient à la barre, un peu affalée.
« Brume cessez de vous répandre et restez concentrée sur ce que j’ai à vous dire ! »
« Brume, vous comparaissez aujourd’hui devant ce tribunal académique car vous êtes accusée du crime de haute trahison, et pire, d’intelligence avec l’ennemi. En effet, si je m’en tiens aux déclarations faites sous serment, vous avez été vue, ou plutôt aperçue, ces derniers mois, en présence de l’ennemi, et pire, en compagnie des forces de l’étrange.
Le président tient l’acte d’accusation entre ses mains tremblantes. La brume est toujours levée, le regard un peu dans le vide. Elle attend, les yeux dans le vague, d’apprendre ce qui lui est reproché.
« Le 8 mars, vous avez été surprise, au lever du jour, en compagnie de l’armée des mauves. Les témoins parlent, je les cite, d’une belle lumière apaisante… »
« Le 13 juin, vous avez déserté le fleuve auquel l’académie vous a attachée et ce pour vous rendre sans autorisation au sommet d’une verte colline. Les témoins parlent d’une, je cite : magnifique couronne cotonneuse… »
« Le 15 juillet, vous avez été aperçue, en fin de journée, à l’heure où tous les chats sont gris, à proximité d’une fête champêtre. Je cite les témoins : « avec la musique et les lumières, cette douce brume d’été nous a remplis de joie, et même d’allégresse »
« A plusieurs reprises, à l’automne finissant, vous avez choisi de vous adjoindre comme compagnons de phrases, sans leurs consentements il va sans dire, les mots légère, douce, bleutée et avez délibérément abandonné épaisse, grise et obscure. C’est grâce au courage civique d’un gardien de la langue que vous avez été confondue et stoppée dans votre entreprise de déstabilisation d’une longue série de mots qui sont en dehors de vos frontières.
En conséquence et après délibération avec le jury et en application de l’article R 233-12 du code de procédure matinale, vous êtes condamnée à une éternité de travaux foncés.
Pour la première fois j’intégrer dans l’article de mon blog du son, pour entendre Serge Regianni dire magnifiquement bien ce texte exceptionnel de Jacques Prévert ;
Cet amour
Si violent
Si fragile
Si tendre
Si désespéré
Cet amour
Beau comme le jour
Et mauvais comme le temps
Quand le temps est mauvais
Cet amour si vrai
Cet amour si beau
Si heureux
Si joyeux
Et si dérisoire
Tremblant de peur comme un enfant dans le noir
Et si sûr de lui
Comme un homme tranquille au milieu de la nuit
Cet amour qui faisait peur aux autres
Qui les faisait parler
Qui les faisait blêmir
Cet amour guetté
Parce que nous le guettions
Traqué blessé piétiné achevé nié oublié
Parce que nous l’avons traqué blessé piétiné achevé nié oublié
Cet amour tout entier
Si vivant encore
Et tout ensoleillé
C’est le tien
C’est le mien
Celui qui a été
Cette chose toujours nouvelle
Et qui n’a pas changé
Aussi vrai qu’une plante
Aussi tremblante qu’un oiseau
Aussi chaude aussi vivant que l’été
Nous pouvons tous les deux
Aller et revenir
Nous pouvons oublier
Et puis nous rendormir
Nous réveiller souffrir vieillir
Nous endormir encore
Rêver à la mort,
Nous éveiller sourire et rire
Et rajeunir
Notre amour reste là
Têtu comme une bourrique
Vivant comme le désir
Cruel comme la mémoire
Bête comme les regrets
Tendre comme le souvenir
Froid comme le marbre
Beau comme le jour
Fragile comme un enfant
Il nous regarde en souriant
Et il nous parle sans rien dire
Et moi je l’écoute en tremblant
Et je crie
Je crie pour toi
Je crie pour moi
Je te supplie
Pour toi pour moi et pour tous ceux qui s’aiment
Et qui se sont aimés
Oui je lui crie
Pour toi pour moi et pour tous les autres
Que je ne connais pas
Reste là
Lá où tu es
Lá où tu étais autrefois
Reste là
Ne bouge pas
Ne t’en va pas
Nous qui nous sommes aimés
Nous t’avons oublié
Toi ne nous oublie pas
Nous n’avions que toi sur la terre
Ne nous laisse pas devenir froids
Beaucoup plus loin toujours
Et n’importe où
Donne-nous signe de vie
Beaucoup plus tard au coin d’un bois
Dans la forêt de la mémoire
Surgis soudain
Tends-nous la main
Et sauve-nous.
Extrait de Jacques Prévert, Paroles, Paris, Gallimard, 1946.
Ma micro-nouvelle « il manquait un voyageur » est qualifiée pour la finale du grand prix des lecteurs sur le site Short édition, mais les compteurs sont remis à zéro, si vous avez aimé ce texte, je vous invite donc pourquoi pas à le relire et à lui apporter une voix en cliquant sur le lien : https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/il-manquait-un-voyageur-1

Le tribunal académique est, une nouvelle fois, confronté à un cas épineux. Il doit, en effet, répondre à la plainte qui a été déposé par un mot, que les lois académiques, poétiques et bucoliques protègent envers et contre tous. Contre tous, oui mais, nous allons le voir pas contre tout, et surtout pas contre ces nouvelles lois numériques, aux contenus faméliques dont le code ne se résume qu’à un clic.
Et c’est bien là qu’est le hic…
C’est pour cette seule et unique raison que le tribunal académique est aujourd’hui réuni dans sa formation plénière. Ce qui signifie qu’autour du président, outre les assesseurs habituels ont été convoqués un troubadour, une poétesse, un clown au chômage, un tourneur fraiseur sur tour à commande poétique, une chanteuse boulangère et quelques autres trublions dont j’ai oublié le nom.
Le président du tribunal, se tourne vers la salle, emplie d’un côté d’amoureux heureux et de l’autre, de solitaires éconduits.
« Mesdames et messieurs, nous allons aujourd’hui étudier la plainte qu’a déposée, ce mot que sur toutes vos lèvres je lis, oui vous m’avez compris c’est de j’aime que je veux parler. »
« Aime, vous êtes venus accompagné de votre compagnon j’et c’est donc à vous deux que je m’adresse. Je ne vous demanderai pas, vu les circonstances, de vous lever, et je vous invite donc à écouter ce que le tribunal a décidé. »
« Considérant que j’aime est devenu aujourd’hui un signe que chacun utilise sans aucune réflexion, sans aucune émotion, aussi bien pour signifier son intérêt pour une pizza aux anchois, pour un article sur la crise boursière à Hong Kong, pour tout, pour n’importe quoi, le meilleur et surtout le pire, le tribunal a pris la décision suivante, exécutable immédiatement. »
« A l’unanimité, moins une voix, celle du banquier jongleur, nous instaurons à compter de ce jour une taxe exceptionnelle, dite « taxe qu’on aime ». Chaque clic sur un pouce levé, donnera lieu à une taxe à l’aimant imposé. Son montant sera de un euro par clic. Les sommes collectées grâce à cet impôt qu’on aime seront affectées à la construction d’un nouveau service public que nous avons décidé d’appeler : la MSP : « la Maison du Sourire Public »

Lisa est montée dans sa voiture. Elle a demandé à Jules de l’accompagner. Il a dit : on va où Lisa ? Elle n’a pas répondu et a souri, en lui touchant la main. Ses jambes ont bougé pour trouver les pédales. Ses jambes sont belles, Jules n’empêche pas ses yeux de se poser. Doucement, sans la gêner, sans lui donner le sentiment de n’être regardée que pour la beauté de ses jambes.
Jules est intimidé, il ne sait pas ce qu’il faut dire quand on est dans une petite voiture avec une femme si belle, avec une femme qu’on attend depuis tant de temps. Il sourit. Il est bien. Les vitres sont baissées. Ils traversent la fraîcheur.
Lisa lui dit qu’elle veut voir la ville d’en haut, elle veut la dominer, la sentir lui revenir en pleine mémoire. Voir la ville et la cicatrice qui la partage. Lisa conduit et Jules lui raconte l’absence, la sienne, la leur. Il lui raconte ce qu’il sait d’elle depuis ce toujours qu’ils ne parviennent pas à dater, tant il est loin, tant il est dans le début qu’on recherche. Et il entend que ses paroles n’ont pas le sens commun et il sait qu’elle écoute, qu’elle comprend. « Je le savais, je te savais, notre existence comme une certitude qui entre dans la tête quand on ferme les yeux, le soir, au début de nuit, quand le doute fabrique des questions » Lisa conduit, elle écoute Jules qui essaie de décrire et elle comprend ses mots. « Je te cherchais, dans les couloirs de ma mémoire, la peur comme un révélateur »
Jules a demandé à Lisa d’arrêter la voiture : il aime tous les mouvements qu’elle fait, elle tourne la tête pour reculer, il voit son cou qui se tend, ça fait comme une grosse veine sur le côté. La voiture est stoppée et Lisa s’étire, son bras droit passe derrière le siège de Jules, il sent qu’elle l’effleure, sa nuque frissonne. Sa vitre est ouverte et la fraîcheur du soir les caresse. Jules a tellement de pensées qui lui entrent dans la tête qu’il en a des bourdonnements d’oreille, comme un trop plein, il déborde. Lisa veut marcher pour aller voir la ville d’en haut. Ils sont seuls : c’est un soir de match, la ville est au stade et les autres, ceux qui n’y sont pas, attendent ou s’endorment devant les écrans vides. Ils sont au bout du chemin et la ville est en bas, Jules et Lisa sont heureux, ils sont ensemble.

« J’attends longtemps. Parfois, je trébuche, je perds la main, la réussite me fuit. Qu’importe, je suis seul alors. Je me réveille ainsi, dans la nuit, et, à demi endormi, je crois entendre un bruit de vagues, la respiration des eaux. Réveillé tout à fait, je reconnais le vent dans les feuillages et la rumeur malheureuse de la ville déserte. Ensuite, je n’ai pas trop de tout mon art pour cacher ma détresse ou l’habiller à la mode.
« D’autres fois, au contraire, je suis aidé. À New York, certains jours, perdu au fond de ces puits de pierre et d’acier où errent des millions d’hommes, je courais de l’un à l’autre, sans en voir la fin, épuisé, jusqu’à ce que je ne fusse plus soutenu que par la masse humaine qui cherchait son issue. J’étouffais alors, ma panique allait crier. Mais, chaque fois, un appel lointain de remorqueur venait me rappeler que cette ville, citerne sèche, était une île, et qu’à la pointe de la Battery l’eau de mon baptême m’attendait, noire et pourrie, couverte de lièges creux.
« Ainsi, moi qui ne possède rien, qui ai donné ma fortune, qui campe auprès de toutes mes maisons, je suis pourtant comblé quand je le veux, j’appareille à toute heure, le désespoir m’ignore. Point de patrie pour le désespéré et moi, je sais que la mer me précède et me suit, j’ai une folie toute prête. Ceux qui s’aiment et qui sont séparés peuvent vivre dans la douleur, mais ce n’est pas le désespoir : ils savent que l’amour existe. Voilà pourquoi je souffre, les yeux secs, de l’exil. J’attends encore. Un jour vient, enfin… »
Oui, j’ai besoin, d’un ou plusieurs conseils… En effet, j’aimerai proposer quelques uns de mes textes poétiques à un éditeur, une revue, autres . Autant dans le passé j’ai pas mal exploré le monde de l’édition de fiction pour proposer plusieurs manuscrits ( dont je publie d’ailleurs de larges extraits) mais alors que j’écris de la poésie depuis toujours et que je continue, je n’ai jamais exploré ce monde là… Je suis donc preneur, en commentaires ou à mon adresse courriel ( eric.nedelec42@gmail.com) de vos conseils, adresses, etc….
En vous remerciant….

Une merveille, je le publie en deux courtes parties, il faut prendre de le lire, le relire, s’en imprégner comme d’un baume apaisant.

« J’ai grandi dans la mer et la pauvreté m’a été fastueuse, puis j’ai perdu la mer, tous les luxes alors m’ont paru gris, la misère intolérable. Depuis, j’attends. J’attends les navires du retour, la maison des eaux, le jour limpide. Je patiente, je suis poli de toutes mes forces. On me voit passer dans de belles rues savantes, j’admire les paysages, j’applaudis comme tout le monde, je donne la main, ce n’est pas moi qui parle. On me loue, je rêve un peu, on m’offense, je m’étonne à peine. Puis j’oublie et souris à qui m’outrage, ou je salue trop courtoisement celui que j’aime. Que faire si je n’ai de mémoire que pour une seule image ? On me somme enfin de dire qui je suis. “Rien encore, rien encore… ”
« C’est aux enterrements que je me surpasse. J’excelle vraiment. Je marche d’un pas lent dans des banlieues fleuries de ferrailles, j’emprunte de larges allées, plantées d’arbres de ciment, et qui conduisent à des trous de terre froide. Là, sous le pansement à peine rougi du ciel, je regarde de hardis compagnons inhumer mes amis par trois mètres de fond. La fleur qu’une main glaiseuse me tend alors, si je la jette, elle ne manque jamais la fosse. J’ai la piété précise, l’émotion exacte, la nuque convenablement inclinée. On admire que mes paroles soient justes. Mais je n’ai pas de mérite : j’attends.

Jules aimait Lisa. Ce soir Jules l’aimait enfin. Il aimait à n’en plus pouvoir. Ils étaient soulagés. Elle, lui, ensemble, si près l’un de l’autre. Il y a tant de temps qu’ils attendaient, il y a si longtemps qu’ils s’attendaient. Lisa raconte ses malaises, sa peur du vide, du noir, de l’orage. Elle lui raconte : ce visage qu’elle découvre en fermant les yeux les soirs d’angoisse, elle ne peut pas le décrire. Ce visage c’était le sien elle le sait, elle se souvient. Elle raconte encore et Jules écoute, il sait qu’elle lui dira, il sait qu’elle est là, tout contre lui, il la sent, elle est douce et tendre, c’est si simple d’exister ensemble. Lisa lui dit que sa mère lui a parlé de l’orage en février, qu’elle lui a parlé de Jules. Elle lui a parlé de cette nuit où ils étaient tous les deux dans leur nid de verre, à imprimer leurs existences à venir, et elle qui dormait, elle qui pleurait, qui attendait. Lisa, quand elle lui parle de sa mère, elle a le bout des doigts glacés. Jules ne l’écoute plus, il observe les doigts de Lisa, elle les promène sur son avant-bras. Il fait chaud et il tremble, il tremble dans ce crépuscule moite. Crépuscule moite, ils sont beaux ces mots qui s’assemblent, il les répète, ça sonne si bien. Les doigts de Lisa comme une plume et les paroles qui s’envolent. Jules est dans le souvenir, il n’y a plus de porte étanche dans son usine à mémoire, tout est ouvert. Les plumes au bout des doigts, la musique de la voix et l’air frais, soudain, qui entre par flots, par paquets. Il ne voit rien, pas encore, mais il ressent. C’est fort, c’est le début. C’est un frisson comme deux peaux qui se touchent, les doigts poursuivent leur aventure et Jules sent la pluie qui entre dans ses veines. Une pluie chaude, riante comme il les aime.
Lisa a posé sa main, elle le serre, il a ouvert les yeux et son regard n’est plus le même, il est plus lisse, sans douleurs. Le sourire lui vient comme une délivrance, un soulagement. C’est si beau sourire avec des mots tout autour, et une histoire derrière.
Il arrive même que le manque d’inspiration, m’inspire…

Il est des jours blancs
Jours glacés
Pour papier froissés
Tout se tait,
Tout se paie,
Lourd monde qui bruit,
J’attends,
Je feuillette,
Ici, là, partout,
Mots endormis,
Il est des jours blancs

Elle est bien, elle n’a pas regardé l’heure depuis son arrêt. Et elle le voit, si fragile, encastré dans un morceau de nuit qui finit par tomber.
Il faudrait qu’elle fasse encore quelques pas, que sa portière claque et qu’elle s’installe à ses côtés, parce qu’il attend, parce qu’elle est bien. Elle ne lui demande rien, elle sait qu’il ne pourra lui répondre. Elle se voit, elle entend le métal qui déchire la nuit. Elle est toute près de lui, il n’a pas bougé, il a les bras qui pendent le long des jambes, le torse courbé, la tête qui penche, il regarde à terre. Elle est toute près, elle le touche. Elle a eu si chaud à conduire, sa robe, si courte, si légère, lui colle à la peau, elle rêve d’une douche, de nudité, de sa peau qui frémit sous un froid qu’on attend.
Elle a pris sa main dans la sienne, sans rien dire et leurs doigts se sont mélangés. Elle a senti comme une aspiration à l’intérieur d’elle même, comme si tout l’air qui emplit les poumons s’en était allé d’un seul coup. Ce doit être cela la joie, le bonheur ou peut-être le désir. Elle ne sait pas et elle s’en moque, ce ne sont que des mots, de simples mots qu’on choisit pour la conversation. Elle n’est pas là pour s’interroger, elle n’a pas roulé une partie de la journée pour se demander à l’arrivée si ce qu’elle éprouve est du soulagement, de la satisfaction ou de la sérénité. Ce qu’elle sait c’est qu’elle hésite entre le rire et le pleurer. Tout s’accélère, les doigts semblent se reconnaître, ils se souviennent. Ca picote. Il a levé la tête et l’a jetée en arrière. Il l’a appuyée contre la barrière, son genou a bougé. Il est contre le sien maintenant, elle se sent fléchir.
Ils sont montés dans la voiture pour quitter cette rue ou plus rien de beau ne se dira, parce qu’il n’y a pas de murs pour entendre. Il faut qu’ils soient ailleurs.
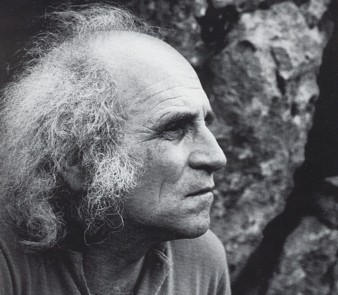
Comme une fleur venue d’on ne sait où petit
Fané déjà pour moi pour toi dans les vitrines
Dans un texte impossible à se carrer au lit
Ces fleurs du mal dit-on que tes courbes dessinent
On dit dans ton quartier que tu as froid aux yeux
Que t’y mets des fichus de bandes dessinées
Et que les gens te lisent un peu comme tu veux
Tu leur fais avaler tes monts et tes vallées
Tu es aux carrefours avec le rouge mis
On y attend du vert de tes vertes prairies
Alors que j’ai fauché ce matin dans ton lit
De quoi nourrir l’hiver et ma mélancolie
Mélancolie mélancolie la mer revient
Je t’attends sur le quai avec tes bateaux blêmes
Tes poissons d’argent bleu tes paniers ton destin
Et mes mouettes dans tes cris comme une traîne
Je connais une femme lubrique à Paris
Qui mange mes syllabes et me les rend indemnes
Avec de la musique autour qui me sourit
Demain je lui dirai des hiboux qui s’envolent
J’en connais dans ma nuit qui n’ont pas de fourrure
Qui crèvent doucement de froid dans l’antarctique
De cette négation d’aimer au bout de l’ombre
Mes oiseaux font de l’ombre en plein minuit néon
Sous les verts plébiscites
Tu connais une femme lubrique à Moscou
Qui mange tes syllabes et les met dans ton bortsch
Il connaît une femme lubrique à Pékin
Qui mange sa muraille et la donne au Parti
Demain nous leur dirons des hiboux qui s’envolent
J’en connais dans leur nuit qui n’ont plus de jaquette
Qui crèvent doucement de froid sous leur casquette
Avec leurs beaux yeux d’or mêlés du Palomar là-bas
Vers les voix de la nuit des étoiles perdues
J’entends des sons lointains qui cherchent des caresses
Et dans les faits divers là-bas ça s’exaspère
Et ça tue le chagrin comme on tue la flicaille
Au coin d’un vieux soleil exténué des glaces
Mélancolie Mélancolie la mer se calme
Je vois monter partout des filles et des palmes
Avec des fruits huilés dans la fente alanguie
Les matelots me font des signes de fortune
Ils se noient dans le sang du soleil descendant
Vers l’Ouest toujours à l’Ouest Western de carton-pâte
Le dentifrice dans la nuit se tient au rose
Un néon de misère emprunté à tes yeux
Un peu silencieux ces derniers jours, et puis soudain l’inspiration qui revient : le train, une vitre… Les ingrédients sont réunis.

Dans ce presque soir ferroviaire,
Flaque de mémoire s’est échappée.
Je la vois,
Tout va si vite.
Elle glisse sur la vitre.
L’encre noire de mon âme est noyée
Dans un trop plein de bleus.
De ce plein bleu trop salé,
Que la mer tous les jours m’a inventé.
J’entends,
J’attends.
C’est le long cri.
Long cri du souvenir de l’en dedans.
Il remonte,
Trempé jusqu’à l’os de mes mots,
Se présente à la grille rouillée de mon parc à rimes.
Sourires,
Il est si tard pour la fouille.
Les poches se vident…
Sur la table, s’étalent les vers.
« Dans la marge, vos mots coupants, vous déposerez ! »
Les lames ne franchissent pas le détecteur.
Les larmes seules sont admises.
J’ai tant de rêves qui vibrent.
Entends,
Ça résonne,
Ça bouillonne,
Ça brouillonne.
Dans ce demi-soir lunaire
Tant de voix se disputent la tribune,
Silence…
Il est temps de ne rien dire….

Ils se sont retrouvés. Une fois de plus. Il y a eu tant de contacts depuis cette nuit bissextile, tant d’effleurements. Cette main qu’on frôle par inadvertance et le regard qui suit, au bout, regard souvenir, regard qu’on attend depuis le début. Aujourd’hui ils sont là, dans une rue inventée depuis peu par des bâtisseurs pour catalogue. C’est une rue sans souffrances, une rue pour poubelles de plastique, une rue utilitaire faite pour entrer chez soi, née par arrêté municipal, sans histoires. Une rue de papier.
Aujourd’hui, ils sont là, lui assis sur un petit muret, et elle, debout contre sa portière ouverte. Ils sont là, il fait chaud, ils ne se disent rien, trop occupés à s’observer, à s’attendre. Entre eux une lumière blanchâtre déposée par un lampadaire d’aluminium. On voit quelques papillons de nuit qui frétillent autour du globe jauni par l’incandescence. Elle ne l’a pas reconnu et lui ne donne aucun signe. Il est encore sous le coup du malaise. Il sent le picotement qui revient sur le visage, au bout des doigts, et comme un frisson qui lui glaces les reins. Il ne cherche pas à savoir, elle s’est arrêtée, elle est descendue et l’a regardé, simplement. Maintenant, elle est seule au monde et il l’a rejointe.
Au commencement, ce n’est pas Lisa. Au commencement ce n’est pas une femme, ce n’est pas cette femme. Au commencement, ce n’est encore qu’elle, c’est elle. Il se souvient, il se souvient. En fait il ne sait plus s’il se souvient, s’il est dans le souvenir de ce moment. Il est seul, il est parti, il l’a vue, il s’est dit : elle, c’est elle, il s’est dit, il l’a dit, il a dit, il dit, il ne sait plus. Il se perd dans le labyrinthe de cette conjugaison, et puis peu lui importe, il passe du peut-être au j’en suis sûr. Il ne voit pas ce qu’il devrait expliquer, ce qui serait incroyable, impossible. Il ne voit pas pourquoi il lui faudrait proposer de l’acceptable. Ce soir-là, c’est simple il était parti, lui, ailleurs et il l’avait retrouvée, elle, ici.
Il ne l’avait pas rencontrée, non pas rencontrée. Pas joli ce mot ! Rencontrer c’est un mot dans lequel on se cogne : non pas ce mot, ni retrouver non plus parce qu’il y a cet horrible suffixe re qui racle quand on le dit. Et puis il ne l’a pas retrouvée, ni rencontrée, non il n’y a aucun de ces verbes qui lui convient, ce sont des verbes pour histoires avec souvenirs, avec oublis, de ces histoires qu’on pourrait poser au creux d’un magazine pour que les autres s’en nourrissent. Non, Jules il n’a pas de verbe, il pourrait en inventer un, ou plutôt en détourner un autre comme un terroriste du verbe. Il pourrait prendre le verbe exister, il l’a déjà fait, il l’a pris ce verbe, il l’a surpris, il en fait un autre, il lui a donné une autre force. Alors il recommence, maintenant, il le dit, il le respire, Lisa, je t’existe.
Elle est bien. Lisa n’a pas bougé depuis de longues minutes. Il y a la chaleur, la chaleur du dehors, une chaleur qui sent bon la peau restée au soleil, une chaleur qui monte du sol, qui a terminé sa mission de la journée. Elle la sent qui passe, qui monte, qui s’infiltre dans quelques replis du corps avant de s’enfuir, de laisser le passage à la fraîcheur. La fraîcheur n’existe pas ce soir, c’est un espace laissé vide par une moiteur lasse de s’alourdir sur le sol. Elle est bien, il y a l’odeur de sa voiture qui a roulé toute la journée. Elle a quitté Paris en début de matinée. En ouvrant la porte c’est l’histoire de cette journée qui s’échappe. Et puis il y a la senteur de l’herbe, celle qui se repose derrière toutes les haies rectilignes, celle qui le soir venu voudrait bien qu’on cesse de l’affubler de ce nom rectiligne de pelouse.

Ils s’étaient effleurés. Imperceptiblement. Un contact éclair. Comme il s’en produit de milliers, des millions, chaque jour. Sans qu’on y prenne garde les corps se touchent, comme des objets, et ils ne réagissent pas. Ils étaient dans la même librairie, au même rayon, à la recherche du même ouvrage et leurs mains se sont effleurées. Elles ont voulu saisir le même livre. Proust. Un crépitement s’est produit, comme deux fils électriques opposés qui se touchent. Jules a cru percevoir une étincelle. Jules a levé les yeux : elle souriait.
– Je ne l’ai jamais lu, c’est le titre qui m’intrigue. Vous le connaissez. ?
Jules ne lui répond pas. Il sourit. Il sourit et l’observe. Il distingue deux marques, sur les tempes, comme les siennes. Deux petites marques de la taille d’une pièce de cinq centimes.
Aujourd’hui il se souvient de cette scène, et se la passe en boucle. C’était à l’automne dernier, il était monté à Paris pour quelques jours, pour acheter des livres. Des livres sur l’orage, sur le temps, des livres sur la transmission de pensées et tous ces phénomènes un peu curieux qui font sourire les scientifiques. Il passait plusieurs heures dans de nombreuses librairies, à fouiller, à feuilleter, à sentir les livres, tous les livres. Jules aime l’odeur des livres. Il est particulièrement fier d’être capable d’identifier une maison d’édition à l’odeur de ses livres. Il est capable de reconnaître les yeux fermés Gallimard, Grasset. Il vous explique que les uns ont une odeur un peu humide, il dit une odeur « parchemineuse », les autres une odeur glacée, fraîche plus exactement. Non seulement il hume les livres, mais il lui arrive aussi de les caresser, d’en apprécier le grain.
Ce jour-là il était dans cette librairie de Saint-Germain depuis un long moment déjà, et il feuilletait des éditions assez rares de « à la recherche du temps perdu », un titre qui le fascine et le trouble, et ces passages sur la mémoire et les sens. Il a commencé par toucher la couverture, par la caresser du plat de la main et c’est au moment où il a à nouveau tendu la main pour le saisir et le porter à hauteur du visage que ses doigts sont entrés en contact avec ceux de cette femme.
Il ne l’avait pas remarqué en entrant dans la librairie occupée à chercher le livre rare, celui qui lui donnera une clé.
Quand il a levé les yeux, après le contact des doigts il a eu comme un malaise, cette impression qui navigue ente le bizarre et le merveilleux, celle d’avoir déjà vécu cette scène.
Cette femme qui le regarde de ses yeux clairs, et ces quelques secondes qui durent depuis toujours.
L’écrit ça arrive comme le vent, c’est nu, c’est de l’encre, c’est l’écrit et ça passe comme rien d’autre ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie.

« Écrire. Je ne peux pas.
Personne ne peut.
Il faut le dire, on ne peut pas.
Et on écrit.
C’est l’inconnu qu’on porte en soi écrire, c’est ça qui est atteint. C’est ça ou rien. On peut parler d’une maladie de l’écrit. Ce n’est pas simple ce que j’essaie de dire là, mais je crois qu’on peut s’y retrouver, camarades de tous les pays. Il y a une folie d’écrire qui est en soi-même, une folie d’écrire furieuse mais ce n’est pas pour cela qu’on est dans la folie. Au contraire. L’écriture c’est l’inconnu. Avant d’écrire, on ne sait rien de ce qu’on va écrire. Et en toute lucidité. C’est l’inconnu de soi, de sa tête, de son corps. Ce n’est même pas une réflexion, écrire, c’est une sorte de faculté qu’on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, d’une autre personne qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui quelquefois, de son propre fait, est en danger d’en perdre la vie. Si on savait quelque chose de ce qu’on va écrire, avant de le faire, avant d’écrire, on n’écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine. Écrire, c’est tenter de savoir ce qu’on écrirait si on écrivait — on ne le sait qu’après — avant, c’est la question la plus dangereuse que l’on puisse se poser. Mais c’est la plus courante aussi. L’écrit ça arrive comme le vent, c’est nu, c’est de l’encre, c’est l’écrit et ça passe comme rien d’autre ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie. »
Marguerite Duras, 1993

Il s’est arrêté de marcher. Il ne sait plus d’où il vient, par où il est passé, il ne reconnaît pas le quartier. Tout à l’heure il faudra qu’il entre dans un chez soi où on se sent bien, où on est attendu. Peut-être il devrait téléphoner, dire qu’il a eu un imprévu. Il faudrait qu’il rassure quelqu’un, on a toujours quelqu’un à rassurer. Il a changé ses derniers temps, c’est toujours comme ça quand il a ses maux de têtes, il faudra qu’il lui dise. Ses rêves, son rêve, une image qui le trouble et lui qui aime. Il se fera soigner. Un jour tout redeviendra normal comme avant. Il pense à elle, cette femme faite du visage de tant d’autres, croisés, si peu, comme dans un éclair, au milieu de l’orage.
Il n’a pas sa carte de téléphone, il ne se souvient même pas en avoir eu une. Il faudrait pourtant qu’il appelle. Pour exister. Avec d’autres.
Ce matin en montant dans le bus il était heureux, comme optimiste. Il faisait beau et il avait entendu le vent dans les feuilles, comme un soupir. Il n’avait pas mal non plus enfin pas autant que les autres fois.
Mais ce soir il sait qu’il s’est encore trompé, qu’il s’est passé quelque chose avec ou sans lui. Elle ne l’a pas reconnu, mais il n’est plus tout à fait sûr qu’il s’agissait bien d’elle, elle n’était pas comme ça ce matin, elle n’avait pas cette bouche qui tombe. Et puis ces jambes, ce n’était pas possible qu’en une seule journée elle ait pu changer comme ça. Il s’était passé quelque chose, comme à chaque fois…
Il avait la clé de toute façon, là dans la poche il pourrait la sortir quand il la voulait, l’introduire dans la serrure et entrer chez lui, comme tout le monde.
Elle est où cette clé, il l’avait bien tout à l’heure, il a dû la laisser tomber dans le gravier. Ça arrive souvent, il est si fatigué, il voudrait tellement parler à quelqu’un. Il va souffler un peu, reprendre ses esprits, puis il y retournera.
Maintenant il est loin, il ne reconnaît pas les rues. Il a pu y passer autrefois, il ne sait plus, il croit reconnaître certains passages, cette maison aux volets bleu hôpital encerclée de fleurs mal assorties. Il ne sait pas l’heure qu’il est, il pourrait regarder sa montre mais à quoi bon tout y est faux. Il est certainement plus de vingt-deux heures, il le devine à la fraîcheur qui commence à se dérouler. Il y a les papillons qui s’affolent autour des globes lumineux. Il pourrait demander son chemin pour aller on ne sait où. Il attend, il sait par expérience qu’il finira par se produire un événement. Au commencement ce sera un événement quelconque et il finira par marquer le point de départ d’une peut-être nouvelle vie. Il n’a plus d’angoisses, il commence à ne plus regretter ce qui s’est passé ou ce dont il se souvient. Il marche et la nuit tombe peu à peu. Jules s’est assis sur un banc, dans un parc, il se sent mieux, il sent l’orage qui s’éloigne, son intérieur s’apaise, comme chaque fois… Les souvenirs se recouvrent de brouillard, tout doucement, une femme, cette femme, d’une nuit rêvée. Il attend, la fraîcheur l’apaise, il reprend place sa place. Un couple passe, ils se tiennent par la main, ils lui sourient. Tout à l’heure il pourra rentrer. Tout à l’heure il aura oublié. Tout à l’heure il sera dans une autre histoire, la sienne, une autre. Il sera.

Je n’ai pas eu d’autre solution pour le dimanche que de convoquer le tribunal académique ! Alors oui bien sûr la première réaction du président et des ses assesseurs a été claire : « non monsieur désolé mais nous ne jugeons pas le Dimanche ». J’insiste, en expliquant que refuser de juger le dimanche, c’est en quelque sorte déjà le condamner, comme s’il s’agissait d’un jour intouchable, sacré, bref, un jour auquel on ne pourrait rien reprocher.
Avec quelques effets de manche, j’ai réussi à les convaincre.
Le tribunal académique est réuni aujourd’hui 23 février en session extraordinaire dans le cadre d’une procédure d’urgence, que la loi autorise , à la seule condition que l’instruction ait déjà été réalisée. Le dossier qui nous a été transmis ce matin, à l’aube, est complet, suffisamment étayée et nous a permis, en conséquence, de délibérer et de prononcer un jugement.
Faites entrer le prévenu ! Dans la salle à moitié vide, tout le monde est impatient de voir arriver ce dimanche aujourd’hui accusé. Mais que diable lui reproche-t-on ?
« Dimanche, levez-vous, je vous prie ! ». Dans le box des accusés, pas un mouvement, rien ne bouge. Les deux gardiens de permanence (deux stagiaires d’ailleurs récemment condamnés par ce même tribunal), qui répondent l’un au nom de « brume » et l’autre de « automne », font grises mines. « Nous sommes désolé monsieur le président mais dimanche dort encore, il prétend que c’est le jour de la grasse matinée et ni rien ni personne ne pourra le faire lever… »
Le président du tribunal ne veut pas passer son dimanche ici et a décidé de vite en terminer.
« Dimanche vous comparaissez aujourd’hui, libre et endormi devant ce tribunal car vous êtes accusé de : mollesse, paresse, ivresse, monotonie, boulimie, ennui et pour terminer j’ajouterai fumisterie ».
« Il est manifeste aussi que vous abusez de votre position dominante, celle de septième jour de la semaine, pour vous reposer sur vos six compagnons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi que nous avons tous entendus comme témoin. C’est ainsi en parfaite illégalité que vous avez organisé une sous-traitance des travaux qui vous reviendraient en vertu de ce principe intangible du droit : « à chaque jour suffit sa peine ». Les faits qui vous sont reprochés entrent, selon le jury, dans la catégorie de l’escroquerie, et de l’exploitation de plus faible qu’autrui car vous prétendez, être, à vous seul le jour du seigneur et en conséquence, vous usez, abusez et profitez de cet attribut, par on ne sait qui attribué pour organiser toute une série de travaux illégaux par les autres réalisés »
En conséquence, le tribunal académique considérant que le seigneur dont vous prétendez être le jour, n’ayant pu être entendu, que le droit à la paresse est un droit universel a décidé à l’unanimité de vous acquitter afin de retourner se coucher…

Jules doute. Il est mal avec ses souvenirs.
Tout est si étrange, si mélangé dans ce qui lui reste de raisons. Il cherche à retrouver le fil qui l’a conduit jusqu’à cette femme. Il souffre moins de la tête. Les images s’enchaînent. Il est au début de l’après midi, au plus fort de la chaleur. L’orage gronde, il s’approche. Il se voit. C’est une file d’attente. L’homme devant lui est anxieux. Il doit craindre l’orage ou c’est autre chose qui le rend si tendu. Jules s’impatiente, l’orage l’excite, il voudrait être au milieu des champs pour l’emmagasiner. L’homme devant lui ne cesse de se retourner en regardant sa montre. Leurs regards se croisent, la chaleur est à son apogée, la lumière a faibli, les nuages s’entrechoquent. Et soudain l’éclair. L’homme se crispe. Jules devine sa peur sur sa nuque, il se retourne brusquement, il a le regard terrorisé. Jules lui a saisi la main quand le deuxième éclair les a inondés de sa lumière blanche. Il voit dans son en dedans, il touche sa peur, elle est épaisse, la peur de l’orage, de cette femme que Jules devine derrière les yeux rougis, une femme qui s’offre au regard et Jules qui comprend, et l’autre qui pleure de l’intérieur, qui se déverse dans Jules…
L’orage s’éloigne, l’homme s’en est allé, il a retiré une petite somme d’argent au distributeur. Et Jules qui n’avance pas, il est si lourd du poids de l’autre qui est entré en lui avec toute sa douleur, avec tout le refus de cette histoire qui est en train de traverser Jules. L’homme est parti, il est loin, il n’est même plus un souvenir, le souvenir banal de celui qui était devant lui, tout à l’heure dans une simple file d’attente. Il n’existe plus. Et Jules qui souffre. Et Jules qui reste avec l’image d’une femme si belle, si belle pour un homme qui fait la queue devant un distributeur de billets. Et l’image de cette femme qui se grave dans le marbre des mémoires de Jules, une femme qu’il a serrée contre lui cette nuit, une femme à qui il a fait l’amour pour oublier, pour oublier l’autre, les autres. Et Jules qui ne sait pas, qui ne sait plus, qui sent le moite de ses mains lui faire comme une pellicule d’angoisse. Et cette femme qu’il ressent, comme un écho, il ira la rejoindre tout à l’heure, il faudra qu’il lui parle, il lui dira qu’il sait tout.
Jules ne s’est pas arrêté à la boulangerie, il veut rentrer le plus vite possible, il veut la serrer contre lui, lui parler de ses peurs.
Jules a mal à la tête.

Samedi ? Et bien, c’est dit, je m’accorde une pause en prose. Oui bien sûr, vous me direz que peu de différences vous ne voyez, si ce n’est la modeste preuve de ma paresse, à pêcher de la rime au bout de ma ligne. C’est vrai, j’en conviens il est des jours, comme celui-ci, ou rien ne mord. Dans ma boîte à appâts j’avais ce matin, un bel échantillon : des illes, des ouches, des oules, des oins, et bien d’autres « queues de vers » toutes bien fraîches, prêtes pour la pêche du samedi. Je les ai préparées, et à mon hameçon les ai accrochées. Une première j’ai lancée. Au passage, j’avoue être assez fier du rond dans l’eau, bien plus réussi qu’un rondeau.
J’ai ensuite choisi d’appâter avec une ille, car mon intention était de prendre du gros. Du gros mot évidemment ! Ciel, ça mord ! Vite, je mouline ! Déception, pas de bille, ni de quille, encore mois de grille. Autant vous dire que j’ai tenté avec une ouche, une oule, et même un petit oin et au bout de la ligne : rien ! Oh tant pis, me dis-je, c’est samedi, je fais une pause. Point à la ligne…

Quand il était enfant elle ne le laissait que rarement en paix. Il ne se plaignait plus, personne ne comprenait, on disait qu’il était triste, qu’il n’allait pas bien, et souvent on disait, le pauvre, le pauvre dans un soupir.
Jules s’en souvient de ces soupirs, et des mains un peu moites qui s’attardent sur la tête : le pauvre, soupir, et c’est fini, sa douleur, le mystère de son regard de l’intérieur ont calmé la souffrance des autres. Il le sait, Jules qu’ils se sentent mieux à ne pas vouloir le comprendre.
Tous les docteurs l’avaient examiné ne trouvaient rien à dire. Ils l’interrogeaient : « et depuis quand tu as mal, depuis quand, depuis. Il ne savait pas, depuis quand, il ne voulait pas savoir, et puis il disait que c’était tout le temps comme ça et que ce n’était pas vraiment que cela lui faisait mal, en fait il ne savait pas ce que c’était la douleur, on lui disait, pourquoi tu fais cette tête : « tu as mal à la tête ? » Alors il s’était dit que c’était cela avoir mal à la tête. Il essayait d’expliquer. Les sensations étaient si bizarres, si anormales qu’il ne parvenait pas à trouver de mots suffisamment précis pour décrire ce qu’il éprouvait. Il avait parfois la sensation de rétrécir, ou de se séparer en plusieurs, de sortir de lui-même. Un de ces médecins avait souri à l’évocation de ce symptôme. Il avait essayé de lui expliquer que c’était désagréable, comme s’il était le témoin d’une autre histoire. Il se voyait, il s’observait, s’étonnant même de ne pas se reconnaître. Il avait parlé de l’orage aussi, de toutes ces histoires qui lui entrent dans la tête à ce moment-là.
Les crises s’étaient peu à peu espacées. Il avait cru que tout irait mieux, qu’il avait enfin trouvé la sérénité. Puis sa femme avait eu une liaison. Sa femme il s’en souvient, maintenant, elle est belle, elle était, il sait plus, c’est peut-être elle, il sait plus, ce n’est pas important. Elle le trompait depuis le début. Elle le trompait avec un de ses anciens amants. Elle le trompait avec une telle régularité, avec une telle application qu’il avait le sentiment d’être devenu l’amant. Il doutait.
Les maux de têtes étaient revenus à ce moment-là. Il avait découvert cette liaison par hasard et aujourd’hui il ne saurait dire comment. Il n’avait rien dit, il ne voulait pas l’entendre avouer ce qu’il savait déjà. Il ne voulait pas l’entendre nier, lui expliquer qu’il avait fabriqué toute cette histoire, comme toutes les autres. Comme celles qu’il fabriquait quand il était petit, quand il pleuvait. A cette époque c’était son père qui ne supportait plus ses délires. Il lui disait de se réveiller et de cesser ses sornettes. Mais lui il savait bien qu’il ne rêvait pas. Il savait bien que c’était les autres qui bougeaient le décor pour le tromper. Alors il se taisait de plus en plus et il laissait faire le miroir dans sa tête. Il n’avait rien dit, il était parti, il ne sait pas depuis quand, depuis encore, depuis ce mot qui l’accuse et il cherche : il était parti, ce matin, hier, il y a plus, autrefois, c’est difficile, il pleurait, il le sait, il a encore le goût des larmes. Il ne les regarde plus, il est retourné vers la porte, elle est ouverte.
Il est là sur la terrasse, la porte derrière lui. Elle le regarde s’éloigner. Il sait qu’il l’a aimée, elle ou une autre, peu importe, il a aimé. Il a aimé, il l’a aimée, une seule petite lettre entre les deux, c’est si proche. Elle ouvre de grands yeux. Elle a peur. Il le sait, il sent qu’elle a peur maintenant. Il sait reconnaître quand une femme a peur, ça fait comme un trou dans l’air. Elle ne plaisante pas, les enfants non plus, ni le plus grand qui la tient par la taille en serrant les mâchoires. Il se retourne encore, veut lui montrer la clé, lui dire encore une fois que ce n’est pas grave, qu’ils ne mangeront pas de pain ce soir. Mais il y a les autres, il ne les connaît pas, ils se sont ajoutés à l’histoire, ils ne les avaient pas prévus. Il a si mal à la tête. Il ne les connaît pas et le plus grand semble impatient de le voir s’éloigner.
Alors il s’est dit une nouvelle fois qu’il s’est peut-être trompé. Vraiment. A cause de sa tête. Il a si mal.
Ce poème a été écrit par Paul Eluard en hommage à Gabriel Péri, député communiste fusillé par les allemands l’hiver 1941
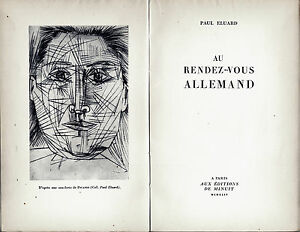
Un homme est mort qui n’avait pour défense
Que ses bras ouverts à la vie
Un homme est mort qui n’avait d’autre route
Que celle où l’on hait les fusils
Un homme est mort qui continue la lutte
Contre la mort contre l’oubli
Car tout ce qu’il voulait
Nous le voulions aussi
Nous le voulons aujourd’hui
Que le bonheur soit la lumière
Au fond des yeux au fond du cœur
Et la justice sur la terre
Il y a des mots qui font vivre
Et ce sont des mots innocents
Le mot chaleur le mot confiance
Amour justice et le mot liberté
Le mot enfant et le mot gentillesse
Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits
Le mot courage et le mot découvrir
Et le mot frère et le mot camarade
Et certains noms de pays de villages
Et certains noms de femmes et d’amies
Ajoutons-y Péri
Péri est mort pour ce qui nous fait vivre
Tutoyons-le sa poitrine est trouée
Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux
Tutoyons-nous son espoir est vivant.
Je rentre du centre de détention de Bourg-en-Bresse où j’ai participé à un atelier d’écriture dont le thème était « oser »…

Pour le vendredi,
Une recette osée je vous ai préparée.
Une marmite à mots,
Sur le feu j’ai posée,
Quelques mots piquants,
Dans son fond beurré,
Doucement j’ai fait revenir,
Une fois dorés
Le feu j’ai baissé.
Hum….
Ça grésille,
Ça pétille,
Ça frétille,
Les mots sont à points,
C’est le moment,
Il faut pimenter…
Pour commencer :
Un souffle de vent,
Trois pincées de brumes,
Et bien sûr, j’allais l’oublier :
Un chant d’oiseau…
Fou l’oiseau,
De préférence évidemment…
Remuez délicatement…
Ne brusquez pas les mots,
Soyez prudent, je vous en prie…
Fermez les yeux,
Sentez,
Ouvrez les yeux,
Ressentez.
Rien ne monte ?
Tout est plat ?
Allez, on y va !
C’est vendredi,
Il faut oser.
Arrosez le tout,
De ce doux vin mauve
Que vous gardez en réserve
Depuis lundi.
Et,
Laissez mijoter…
Jusqu’au samedi…

Ce matin il savait qu’il reviendrait, elle l’attendrait pour souper. Il apporterait le pain, il y en avait besoin pour le souper. Le pain, il l’avait oublié. C’est important le pain, très important, on n’oublie pas le pain quand on revient chez celle qu’on aime. C’est peut-être cela, elle lui en veut, il oublie toujours, sa fête, son anniversaire, mais jamais le pain. Ce doit être cela, elle ne comprend pas ce qui a pu se passer pour qu’il revienne les mains vides. Elle est en colère. Cette femme est en colère et elle veut le punir, c’est une femme qui n’aime pas qu’on oublie le pain, il aurait dû y penser. Le pain, les femmes, elles en mangent peu mais elles n’aiment pas qu’on l’oublie.
Il est là, il est entré, il ne sait pas, c’est déjà si loin la porte qui s’ouvre. Il est posé devant elle, elle le regarde. On dirait qu’elle ne comprend pas. Elle n’est plus en colère, il voit de la lumière dans ses yeux. Elle veut savoir comment il est entré il a pensé qu’elle plaisantait, qu’elle le taquinait.
Ça sentait bon, il avait faim, il y avait comme de l’apaisement dans l’air, alors il s’est approché pour l’embrasser. Elle a reculé en poussant un petit cri. Elle n’avait même pas peur, Jules le sait. Il a dit qu’il était fatigué, qu’il était désolé pour le pain qu’ils pourront se contenter de biscottes. C’est bon les biscottes on les croque, ça craque et on se regarde, c’est beau, c’est bon… Elle ne l’écoute pas, elle est belle à ne rien dire, et soudain ça fait comme un trou dans ce qu’il croit savoir d’elle. Il est vide, vide d’elle, sans mémoire, rien pour l’accrocher, rien pour l’exister.
Quand les autres sont arrivés il a compris ; quelque chose n’allait plus il y avait eu dérèglement quelque part. Les autres, ils étaient trois, deux ados dont un plutôt costaud et un petit morveux qui suçait son pouce. Il ne les connaissait pas, il ne les voyait même pas et se demandait pourquoi cette femme ne lui avait rien dit.
Le plus grand des trois, il l’avait vu plus jeune dans l’ombre, avait l’air très proche de cette femme. Il s’était posté devant elle comme un garde du corps et voilà qu’il le menaçait, lui donnant l’ordre de déguerpir et de laisser sa femme en paix. Sa femme, sa femme, ça claque comme une lanière de cuir, sa femme, Jules est fouetté, il a mal, si mal. Il est entré, c’était une femme, elle n’était à personne tout à l’heure, elle était dans sa tête, il s’en souvient, il le sait, il l’avait sentie, elle était dans sa vie. Jules, n’en peut plus de tous ces visages qui sont dans son rêve et qu’on lui vole quand il s’en approche. Il regarde l’autre, il le connaît, il le sait, ils se sont touchés déjà, il lui a donné un morceau de cette vie et maintenant il la veut toute pour lui. Il regarde l’autre, il le regarde et se souvient.
Ce matin un homme l’a touché, ce matin un homme lui a donné un morceau de lui, de sa vie, de son histoire, un homme, cet homme qui ne le reconnaît pas, ce matin
Ce matin il avait mal à la tête, surtout au moment de l’orage. Il avait souvent mal à la tête. Très mal, un mal dont il ne pouvait pas parler. Il était seul à en connaître l’origine. Une douleur qui l’isolait totalement des autres, une douleur qui lui faisait douter de tout. Il ne savait plus, il ne pouvait pas savoir. Cette femme, sa femme, la femme, une femme et cette douleur qui revenait. Douleur, souvenir.

Non, non, pitié,
Pas aujourd’hui,
Je vous en supplie,
Mon rire s’est enfui.
Pas de jeu de mots,
Pas de rimes en i.
N’insistez pas, je vous le dis.
Comment ?
Dommage, me dites-vous ?
Vous aviez de bons mots ?
Et bien tant pis,
Je cède, allons-y !
Je n’en prendrai qu’un :
Je le veux bref et poli.
En avant mon ami,
Je suis tout ouïe.
Par quoi commencerez-vous ?
Comment par i ?
Paris ?
Malheur,
C’est bien ce que je dis,
Comment, que me dites-vous ?
Ce que je dis ?
Ce que je dis,
C’est jeudi…
Vivement vendredi…
Je répare un oubli fâcheux, je m’aperçois que dans mes Everest, René Char est le grand oublié. Il faut vite réparer cet oubli, voilà c’est fait…

Qu’il vive!
Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts
lointains.
La vérité attend l’aurore à côté d’une bougie. Le verre de fenêtre est négligé. Qu’importe à l’attentif.
Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému.
Il n’y a pas d’ombre maligne sur la barque chavirée.
Bonjour à peine, est inconnu dans mon pays.
On n’emprunte que ce qui peut se rendre augmenté.
Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n’avoir pas de fruits.
On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur.
Dans mon pays, on remercie.

Jules est entré chez cette femme. Cette femme ne l’a pas embrassé. Il se dit que c’est normal, peut-être. Depuis longtemps sa femme n’aime plus l’embrasser. Depuis, il cherche, et cette femme, la sienne, elle le regarde comme un étrange.
C’est cela, il a changé, encore. Elle ne l’embrasse plus, elle ne sait pas. Tout se mélange, c’est trouble. Du trouble dans sa tête et dans celle des autres. Il sent ses doigts qui se crispent au fond de la poche. Là, c’est grave, un peu plus que d’habitude. Elle prétend qu’elle n’est pas sa femme. Il entend les mots qu’elle échappe entre deux regards d’angoisse, dit qu’il s’est trompé, qu’il est malade et dangereux. Elle dit qu’elle va appeler. Il a un vertige, toiles d’araignées devant les yeux, il se frotte le regard, il se gratte la mémoire. Et pourtant elle n’a pas peur, il sait reconnaître la peur d’une femme, d’abord dans les yeux et puis les lèvres qui remuent, qui tremblent.
Il n’essaie pas de ne pas la croire, il cherche du vrai, du possible. Il a la clé, il a une clé, il est entré. La porte était ouverte mais il est entré. Il la sent cette clé entre ses doigts crispés, il voudrait la lui montrer comme un trophée. La clé, une clé, il s’entend dans sa tête, des mots qui défilent et le torturent, la : article défini, une : indéfini. Il a peur, la grammaire comme le miroir de son trouble. Et Jules voudrait lui dire, le lui dire, il n’a pas besoin de majuscule pour être défini, pour être propre. Jules, il rit, en dedans, je suis Jules, un jules, et le vertige toujours, et ses mains qui fouillent et elle qui le regarde. Il ne sait plus, il a tout perdu, une fois de plus, il cherche les définitions de lui-même. La tendresse, lui effleure le visage, elle accompagne souvent la peur, il attend Jules, il attend tout. Tout de cette femme qu’il connaît depuis l’éternité de cette fin d’après midi.
Elle lui demande de sortir, gentiment, comme un murmure de mer au loin, gentiment, il entend le mot, ses mains ne cherchent plus, sortir de chez elle, il ne comprend pas, chez elle, chez eux, ici. Il est entré, il était si bien à pousser cette porte.
Ce matin, il est parti et il a dit : « à ce soir, je prendrai le pain ». Comme d’habitude. Il le sait, il l’entend, ça fait comme un écho. Et puis il y a les toiles d’araignées devant les yeux, le regard qui se voile, le regard qui fait mal. Il n’a rien changé, il en est certain : « ce soir je prendrai le pain ». Il s’en souvient c’est une phrase qui lui fera un trou dans la tête si on la lui enlève. C’était ce matin. Ce matin d’aujourd’hui ou d’hier, ou d’ailleurs, il ne sait pas, le doute lui fait mal. Il se rappelle la pendule dans la cuisine, toujours dans le même sens. Il cherche, il a peur son regard fouille, la pendule, c’est elle qui lui dira. Il ne sait pas si elle a répondu, ou même si elle a répondu, si elle était là. Si elle était là, il redit cette phrase à voix haute, « si elle était là, si elle était là » et elle ne bouge pas, depuis, depuis, toujours ce mot pour que la tête lui fasse mal. Quand, depuis quand, il ne cherche pas, « si elle était là » il la regarde, elle n’a pas bougé. Il ne s’est pas retourné comme autrefois pour la regarder lui sourire derrière le rideau. Autrefois, il préfère, depuis c’est trop dur, autrefois, c’est hier et puis demain aussi, s’il coupe le mot, il le peut, il le sait, une autre fois et on sera demain et elle n’aura plus peur, celle-ci, ou une autre. Il cherche, une autre fois, son sourire rassure. Le sien, il voudrait le voir. Il s’en veut, elle ne lui souriait peut-être plus, la peur qui monte, l’angoisse. Ce matin il était parti, elle ne souriait pas. C’est cela, il le sait, il le veut, il a tant besoin de comprendre. Il a si mal, si mal à la tête, il fronce les yeux, c’est le doute qui fait des rides dans les coins
Un mercredi avec mes deux petites filles, à jouer, à rire, à construire une cabane… Bref, c’est mercredi…

Ce fut une belle journée…
Une belle journée, dites-vous ?
Vous m’en voyez étonné,
Point de soleil,
Un ciel si mou…
Je regrette, vous vous trompez !
C’est mon mercredi :
Il sautille,
Il frétille,
Il grésille,
Regardez, souriez,
Prenez le temps,
Enroulez vos droites lignes !
Les mots d’hier ne mordent plus.
C’est mercredi,
Vos rimes s’épuisent,
Elles pleurent une pause.
C’est un jour adouci,
Pour les mots endormis.
Ecoutez le vent des rires :
Il souffle en roulant.
Plumes s’envolent,
Au coin d’un ciel d’enfant.
Ce fut une belle journée
Le grand père s’est amusé…
19 février
L’évocation du train, d’un wagon, en 1870 , ce n’est pas la plus connue, mais c’est un de mes thèmes favoris

L’hiver, nous irons dans un petit wagon rose
Avec des coussins bleus.
Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose
Dans chaque coin moelleux.
Tu fermeras l’oeil, pour ne point voir, par la glace,
Grimacer les ombres des soirs,
Ces monstruosités hargneuses, populace
De démons noirs et de loups noirs.
Puis tu te sentiras la joue égratignée…
Un petit baiser, comme une folle araignée,
Te courra par le cou…
Et tu me diras : » Cherche ! » en inclinant la tête,
– Et nous prendrons du temps à trouver cette bête
– Qui voyage beaucoup…

Ce matin ils sont bien, ils parlent d’eux, normalement, sans se contorsionner dans tous les sens. Ils se racontent leur rencontre, une fois de plus, rencontre romanesque à laquelle il est difficile de croire. Un homme seul, une femme qui cherche sa route ou l’inverse, ils ne le savent plus, ils en rient. Qui des deux était le plus perdu ? Lequel a posé le premier son regard sur l’autre et le premier mot qui est sorti, quel était t’il ? Comment était-il ? C’était un mot rond, un mot qui fait la bouche jolie, un de ces mots pour que les lèvres aient un sens. Pas de ces mots rasoirs qu’on entre dans l’en dedans. Ils se souviennent, c’était un mot bonjour, avec peut-être un sourire. Peut-être, ils n’en sont pas sûrs et savent que cela changera demain certainement, ou tout à l’heure, quand cette fraîcheur du matin paisible les aura abandonnés. Ils sont bien, ils en profitent.
Ce matin, Jules a dit à Lisa qu’il savait qu’ils se retrouveraient, il lui a dit que chaque nuit il s’était approché d’elle, chaque fois un peu plus. Et parfois il la touchait.

A nous deux mon mardi :
Tu m’attendais,
Oh oui, je le sais !
Non, ne nie pas !
Je suis sorti,
Je l’ai senti…
Partout, je te le dis,
Oui, partout,
Tout fleurait si bon le mardi.
Tu étais là,
Droit comme un i,
Fier de tes demi-gris.
Ton œil clignait :
Je l’entendais me dire :
Regarde homme d’hier,
Regarde, sans un bruit,
J’ai le bord qui luit.
Prends le, écoute le,
Il brille pour toi.
Oh oui, mon rond mardi,
Je te le dis,
Un instant, je me suis arrêté…
Contre mon oreille
J’ai glissé une boule de ta douce pluie,
Et, fermant les yeux,
Je les ai entendues,
Ces larmes de nuit…
Une a une, elles ont coulé
Gouttes sans plis,
Sur ton visage ont souri…
19 février
Une fois n’est pas coutume, je publie une tribune, que j’avais écrite en septembre 2018, et qui fut l’une des mes dernières « sorties » sur le plan politique… Je la publie, ici, sur ce site, d’abord parce que je la trouve bien écrite, et que ce blog est un blog qui aime les mots, et ensuite parce que je la trouve évidemment encore et malheureusement toujours d’actualité….

Je suis, volontairement, assez silencieux dans le brouhaha permanent du débat politique tant il est vrai qu’il n’y a pas, qu’il n’y a plus de débats politiques. Et cela m’attriste profondément. Aujourd’hui ce qui domine, ce qui anime les gazettes numériques, ce qui motive les excités du clavier c’est la dénonciation, l’indignation toujours sélective, l’accusation revancharde, la délation nauséabonde. Et la parole réfléchie a cédé la place au raisonnement binaire qui trouve peut-être ses racines dans ce langage informatique dont on sait qu’il ne serait constitué que de zéros et de un. Chacun définitivement enfermé à double tour dans sa chapelle idéologique ne prend plus le temps de l’analyse, ne tente plus de comprendre. Et l’opposant devient l’ennemi, celui qui pense autrement est un mécréant, un hérétique. Ce que j’aimais autrefois dans le débat politique c’était l’exigence et le respect. L’exigence que l’on s’imposait, pour être juste dans la production d’une pensée, dans la réflexion, dans le raisonnement avec la recherche permanente de l’équilibre entre ce qui relève d’une conviction personnelle et ce qui s’approche de la réalité. Il y avait aussi le respect, le respect de l’autre, quel qu’il soit parce qu’il est d’abord un élément constitutif de cette humanité qui devrait nous rassembler et nous ressembler. Mais le respect n’existe plus, il est au mieux considéré comme la politesse des faible au pire comme de la traitrise. Je n’en peux plus de ces haines qui dégoulinent dans tous ces messages qui croient afficher de l’intelligence alors qu’ils ne sont que la manifestation de la pire des paresses celle qui consiste à ne pas rechercher ni la justesse dans les propos, ni la justice dans les actes.
22 septembre 2018

Alors ils se rapprochent l’un de l’autre. Il, elle. Doucement. Doucement ils cherchent le passage. Doucement ils cherchent à comprendre cette douleur qui les trouble lorsqu’ils s’éveillent. Cette douleur qui leur dit à l’un et à l’autre : « poursuivez, vous êtes si proches, rien ne vous éloigne oubliez, oubliez cet espace qu’on vous a imposé, continuez à être et vous naîtrez ».
Chaque nuit est une étape de plus, une étape vers la rencontre qui a toujours eu lieu, rencontre qui ne s’est jamais achevée.
Jules cherche Lisa. Lisa attend que Jules la devine. Et tous les deux ne se savent pas, ils ont du mal à déchiffrer le sens de ces images quand ils s’endorment, ces images qui forment une caresse d’air frais dans le sommeil. Parfois, il y a l’angoisse. Et si l’autre n’existait plus, si le voyage se terminait là, au début…
Jules quand il s’endort Il s’apaise. Il s’apaise enfin, il sent une présence pleine d’amours, une présence chaude et pétillante.
Lisa dans son sommeil est pleine d’impatience comme dans ses journées de poursuites.
Jules et Lisa, si loin l’un de l’autre. Quand la nuit tombe, à quelques espaces l’un de l’autre ils se trouvent, dans un sourire. Ils s’enserrent, ils s’embrassent, ils se sentent bien. Quand le jour se lève, ils ne peuvent le décrire. Ils se manquent et ne savent pas le dire. Il faudrait plus, encore plus.
Jules et Lisa, deux prénoms qui s’emmêlent, qui se répondent et les L qui leur font des ailes et Jules qui se prolongent en Lisa, doucement, tout doucement, leurs mains se touchent, plumes légères.
Allez, petite figure imposée cette semaine : sept jours, sept textes. On commence évidemment par lundi…
Pas facile…

Sur le chemin du retour,
J’ai croisé un poète clandestin…
Holà, coquin !
Hé, ho,
Homme de mots !
Vous perdez vos rimes…
Oh, certes ce n’est pas un crime,
Encore moins de la frime.
Mais je dois vous le dire,
C’est aujourd’hui lundi…
Le temps est gris,
Et je suis un peu fatigué.
Et n’ai pas envie de livrer bataille,
Ni avec une canaille,
Ni avec le rail.
Alors, tout doux mon brave,
Ramassez vos mots à terre…
Dans votre poche trouée,
Bien au frais, gardez les,
Et ce soir, à la lune tombante,
Frottez les d’un doux chiffon
Imbibé d’essence de Rimbaud.
Et, demain sur le quai,
Revenez,
Je vous attendrai.
17 février
Je relis régulièrement le texte intégral de la préface à « Poète… vos papiers! », écrite par Ferré en 1956. A chaque fois, même s’il peut y avoir de cet excessif qui caractérise Léo Ferré, je suis remué, bouleversé, interrogé… Bref je vibre ; et je la publie en deux parties

La poésie contemporaine ne chante plus. Elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction, elle ne fréquente pas les mots mal famés, elle les ignore. Cela arrange bien des esthètes que François Villon ait été un voyou. On ne prend les mots qu’avec des gants: à « menstruel » on préfère « périodique », et l’on va répétant qu’il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires ou du codex. Le snobisme scolaire qui consiste à n’employer en poésie que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu’ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigts et du baise-main. Ce n’est pas le rince-doigts qui fait les mains propres ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n’est pas le mot qui fait la poésie, c’est la poésie qui illustre le mot.
L’alexandrin est un moule à pieds. On n’admet pas qu’il soit mal chaussé, traînant dans la rue des semelles ajourées de musique. La poésie contemporaine qui fait de la prose en le sachant, brandit le spectre de l’alexandrin comme une forme pressurée et intouchable. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s’ils ont leur compte de pieds ne sont pas des poètes: ce sont des dactylographes. Le vers est musique; le vers sans musique est littérature. Le poème en prose c’est de la prose poétique. Le vers libre n’est plus le vers puisque le propre du vers est de n’être point libre. La syntaxe du vers est une syntaxe harmonique – toutes licences comprises. Il n’y a point de fautes d’harmonie en art; il n’y a que des fautes de goût. L’harmonie peut s’apprendre à l’école. Le goût est le sourire de l’âme; il y a des âmes qui ont un vilain rictus, c’est ce qui fait le mauvais goût. Le Concerto de Bela Bartok vaut celui de Beethoven. Qu’importe si l’alexandrin de Bartok a les pieds mal chaussés, puisqu’il nous traîne dans les étoiles! La Lumière d’où qu’elle vienne EST la Lumière…
En France, la poésie est concentrationnaire. Elle n’a d’yeux que pour les fleurs; le contexte d’humus et de fermentation qui fait la vie n’est pas dans le texte. On a rogné les ailes à l’albatros en lui laissant juste ce qu’il faut de moignons pour s’ébattre dans la basse-cour littéraire. Le poète est devenu son propre réducteur d’ailes, il s’habille en confection avec du kapok dans le style et de la fibranne dans l’idée, il habite le palier au-dessus du reportage hebdomadaire. Il n’y a plus rien à attendre du poète muselé, accroupi et content dans notre monde, il n’y a plus rien à espérer de l’homme parqué, fiché et souriant à l’aventure du vedettariat.
Le poète d’aujourd’hui doit être d’une caste, d’un parti ou du Tout-Paris.
Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. Enfin, pour être poète, je veux dire reconnu, il faut « aller à la ligne ». Le poète n’a plus rien à dire, il s’est lui-même sabordé depuis qu’il a soumis le vers français aux diktats de l’hermétisme et de l’écriture dite « automatique ». L’écriture automatique ne donne pas le talent. Le poète automatique est devenu un cruciverbiste dont le chemin de croix est un damier avec des chicanes et des clôtures: le five o’clock de l’abstraction collective.

Pour son anniversaire Lisa est seule. Elle se souvient : sa mère pose le gâteau sur la table. Ce n’est presque plus un gâteau, c’est une œuvre architecturale, un monument, une cathédrale. Rose a passé la matinée à le confectionner avec amour. Rose en a à revendre de l’amour. De l’amour pour sa Lisa, de l’amour qui déborde tant qu’elle lui en tartine des tonnes tous les jours. Elle n’attend rien d’autre en retour : un sourire, un seul, le sourire de celle qui se délecte d’avoir plongé les doigts dans la crème chantilly. Lisa n’en peut plus de ces étalages, de ces gentillesses à répétition comme si sa mère avait besoin de l’éternité pour se faire pardonner une faute de jeunesse. Lisa aurait voulu autre chose. Même aujourd’hui, son anniversaire elle l’aurait aimé sans ce stupide gâteau juste bon à faire s’extasier une première communiante. Et Rose qui voudrait tant qu’elles soient heureux ensembles. Elle le voudrait tant qu’elle s’est défoulée sur le chocolat. Le gâteau en est crépi de plusieurs couches et Lisa n’aime pas le chocolat. Elle ne l’aime plus. Lisa n’aime rien de ce que les autres s’entêtent à considérer comme des signes évidents de bonheur. Elle n’aime pas les fêtes non plus, surtout les fêtes qui sont pour elle. Elle est triste, désespérée quand les autres chantent leur bonheur construit. Elle est triste, d’une tristesse si profonde qu’elle s’exprime sans la moindre larme, c’est une tristesse sèche. Alors Rose pleure pour elle. Rose pleure pour deux.
Lisa est partie. Elle est partie sans terminer le gâteau. Le sac était prêt, Rose ne l’a pas retenue. Personne ne retient Lisa. Elle dit qu’elle écrira, elle sera plus heureuse ainsi.
Aujourd’hui Lisa a peur. L’orage lui fait comme un vide à l’intérieur. Un vide avec un cri qui l’habite, cri qui vient de loin, qui vient du passé. Lisa depuis qu’elle a quitté sa ville, elle se ride de l’en dedans, elle ne se contrôle plus. Son corps ne réagit qu’aux seules secousses d’une nature qui s’affole. Aussi loin qu’elle se souvienne, elle a peur de ces déchaînements de vent, de pluie, de tonnerre.
Sa mère lui a expliqué. Sa mère ! Une ressemblance qu’on recherche derrière un sourire et puis le vide, le rien, le « j’en veux plus de cette mère chagrin, de cette mère désespoir ». Lisa a douté très jeune, elle a douté de la noirceur de ses cheveux et de sa peau si mate. Quelque chose ne va pas avec la pâleur de sa mère et la blondeur de celui qu’on lui a raconté comme son père. C’est un accident, un effet du hasard. C’est si compliqué la génétique. Mais Lisa s’en moque des chromosomes, elle doute. Elle doute de tout depuis toujours. Et puis il y a ces rêves qui lui fabriquent d’autres histoires, les rêves d’une nuit si longue, d’une autre nuit et maman qui ne vient pas. Maman, un corps qui dort à quelques mètres de l’orage qui lui emplit la tête. Un souvenir, une incrustation quand les nuits se font plus chaudes, plus lourdes, quand l’angoisse est en suspension, dans l’air, quand on l’inspire à pleins poumons, qu’on s’en intoxique. Lisa a peur de ces nuits là. Petite, elle a peur, et elle appelle ; elle appelle maman et celle qui vient ne ressemble pas à une maman, c’est une femme qui aime et elle en pleure. C’est Rose, une maman enfant, si jeune pour souffrir, pour s’inquiéter. Elle le sait Lisa, elle le sent quand elle serre dans ses bras, elle sent le contact qui réchauffe, elle sent les larmes qu’on retient. Elle sent cet étau de l’intérieur qui presse fort, à en tirer des larmes de sel qui coulent sur les mâchoires serrées.
Un peu triste et nostalgique ce soir…

Quand tous les affamés
Et tous les opprimés
Entendront tous l’appel
Le cri de liberté
Toutes les chaînes brisées
Tomberont pour l’éternité
On peut chanter tous les poèmes des sages
Et on peut parler de l’humilité
Mais il faut s’unir pour abolir injustice et pauvreté
Les hommes sont tous pareils
Ils ont tous le même soleil
Il faut, mes frères, préparer
Le jour de clarté
Quand tous les affamés
Et tous les opprimés
Entendront tous l’appel
Le cri de liberté
Toutes les chaînes brisées
Tomberont pour l’éternité
On peut discuter sur les droits de l’homme
Et on peut parler de fraternité
Mais qu’les hommes soient jaunes ou blancs ou noirs
Ils ont la même destinée
Laissez vos préjugés
Rejetez vos vieilles idées
Apprenez seulement l’amitié
Quand tous les affamés
Et tous les opprimés
Entendront tous l’appel
Le cri de liberté
Toutes les chaînes brisées
Tomberont pour l’éternité
On ne veut plus parler de toutes vos guerres
Et on n’veut plus parler d’vos champs d’honneur
Et on n’veut plus rester les bras croisés
Comme de pauvres spectateurs
Dans ce monde divisé
Il faut des révoltés
Qui n’auront pas peur de crier
Quand tous les affamés
Et tous les opprimés
Entendront tous l’appel
Le cri de liberté
Toutes les chaînes brisées
Tomberont pour l’éternité

Ce qu’il voudrait par dessus tout, ce dont il rêve Jules, c’est voir la terre tourner. Il aimerait aller jusqu’à un bord, un endroit rempli d’horizon où il pourrait s’asseoir et attendre. Pour voir, pour sentir. Parfois il calcule la vitesse, il se bourre la tête de ces nombres à vertiges qui le transportent dans des zones où comprendre rime avec souffrance. Et il ne comprend pas pourquoi il ne la voit pas tourner : quarante mille kilomètres de circonférence en vingt quatre heures, ça devrait se sentir. Alors il cherche, il attend que cela vienne. Et toujours rien. Il interroge les adultes, ceux qui doivent savoir, pour rassurer, et les réponses sont pleines de vides autant qu’il est empli d’angoisses. On lui sert toujours les mêmes rengaines, la lune, le soleil, les étoiles qu’il suffit d’observer et qui ne sont jamais à la même place. Mais lui ça ne lui suffit pas, il ne veut pas comprendre, il veut voir, il veut voir le déplacement, il veut être comme au bord du manège. Il veut voir sa mère en face de lui, à droite, à gauche et puis derrière. Quand il fait du manège, il y pense tout le temps.
Un jour il y est presque parvenu. Un jour d’amour comme il en a peu connu. Un jour où sa pompe à tendresse tournait à plein régime. C’était après les cours, il était étudiant en géographie, il avait choisi cette discipline parce qu’elle étudie du vrai. Ce jour là, quand il était sorti, il avait bien senti l’inhabituelle limpidité de l’air. Et le silence, inconvenant pour une ville de milieu d’après midi, un silence d’attente, un souffle qu’on retient avant la joie, qui bientôt explosera. C’était un soir de novembre, il était seul comme souvent. Devant lui, quand il est sorti du tram, une femme d’âge mûr. Elle pourrait être une sœur aînée, presque une mère, mais il ne veut pas y penser, il est déjà dans une autre histoire, avec elle, il est bien à la suivre, à rester dans son sillage. Elle a fait tout le voyage sur un siège en face du sien. Par deux fois leurs pieds se sont touchés, facile avec les secousses, à chaque fois il a frémi comme s’il était tombé dans ses bras. Elle est devant, à quelques centimètres, il sent son corps qui laisse comme une trace, comme une histoire. Son corps est simple, il n’est pas enluminé de toutes ces formes académiques après lesquelles toutes courent. C’est un corps qui vit, on sent le sang qui circule. Jules ne la quitte pas des yeux, il devine qu’elle a plein d’histoires, qu’elle est une histoire à elle seule, il veut en être. Elle a des cernes sous les yeux. Elle n’a pas besoin de sourire, ni de parler. Il sait qu’elle est douce, qu’elle est sereine.