
Dans le peuple de l’aube
Pas un qui ne bouge
Sur la table basse
De la nuit qui s’achève
Quelques restes de silence
Une odeur de café
Charme les papilles endormies
Battement d’ailes
Les paupières s’étirent
C’est un matin qui sourit

Dans le peuple de l’aube
Pas un qui ne bouge
Sur la table basse
De la nuit qui s’achève
Quelques restes de silence
Une odeur de café
Charme les papilles endormies
Battement d’ailes
Les paupières s’étirent
C’est un matin qui sourit
Ma micro-nouvelle « il manquait un voyageur » est bien classé dans le concours hiver 2020 organisé par le site Short-Edition, il est encore possible de lui donner quelques voix
https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/il-manquait-un-voyageur-1

Il m’en reste encore, que je retrouve de ci, de là…. En voici un, une pépite, écrite en 1981…

La liste de tes dégoûts
Dépassaient l’infini de ta soif
T’ajoutes de la pluie
A tes yeux secs
Ton soleil brillait
Le soir à intervalles réguliers
Entre deux cris de présence
Tu filtrais les paroles
En enfilant les vers
Sur des fils sans bouts

Jules est fatigué. Il y a la vie qui lui fait mal, elle est pesante. Les autres le voient, il passe. Il est une ombre qui glisse. Les regards se taisent, n’osent pas. Jules est dans la souffrance, il en est un élément. Il y a cette boule qui navigue de l’abdomen à la gorge et cette envie de pleurer quand rien n’y prépare. Jules est une erreur, une erreur sur toute la ligne.
Jules n’aurait pas besoin de vivre, ça ne sert plus à rien. C’est trop compliqué. Le temps passe et il s’enfonce. Et parfois Jules crie, Jules hurle, il est mal dans son corps qui lui pèse. Jules a rêvé Lisa, un matin. C’était un matin pluie, et il l’a rêvée. Elle, une main qui le frôle. Elle, une odeur, une odeur de peau. Jules rêve Lisa, il sait qu’elle existe. Il l’entend, c’est comme un souffle, Jules rêve, Lisa est là, elle est en vie, il faut la trouver. Il cherche et les autres ne l’aident pas. Les autres, ils ne l’existent plus. Il est effacé, aspiré, il est dans le ventre d’un trou noir. Et ce matin, il rêve, alors il veut sortir. Il veut s’en sortir, c’est Lisa qui le dit. Elle appelle. Elle est là, quelque part derrière ses yeux. Elle est là, elle attend, elle l’attend depuis toujours, depuis l’orage.
Enfant, Jules s’était inventé un don. Il voulait offrir une montre à sa mère, une montre pour sa fête, il en rêvait. Il n’avait pas d’idées sur le modèle à choisir. Il préférait les montres avec des aiguilles plutôt que ces nouvelles machines à quartz. Les aiguilles, elles bougent, elles vivent, il passe souvent de longues minutes à observer la grande aiguille de la pendule de la cuisine. Il se sent puissant quand son regard est capable de capter l’infime mouvement, l’imperceptible frémissement. Il aime ces moments un peu creux, un peu sirupeux compris entre un presque et un déjà. Il aime ces moments où il est capable de percevoir des mouvements que d’autres ignorent.
Toutes les choses bougent, tous les objets vivent, il en est persuadé. Alors il observe et attend les yeux dans un vide qu’il est le seul à remplir, et quand les autres, ceux qui sont là pour dire ce qui est bien, le surprennent dans ces attitudes prostrées, ils le semoncent, lui conseillent de se réveiller, de devenir un autre, un comme tout le monde. Un qu’on ne remarque pas. Sa mère, si belle qu’il en a peur, le secoue et lui ne dit rien, il est ailleurs. Elle ne comprend pas le plaisir qu’il peut avoir à fixer un cadran. Il voudrait pouvoir lui expliquer qu’il cherche à voir les aiguilles des heures bouger. Il la fixe à s’en faire mal au regard.
Mon maître absolu, définitivement…
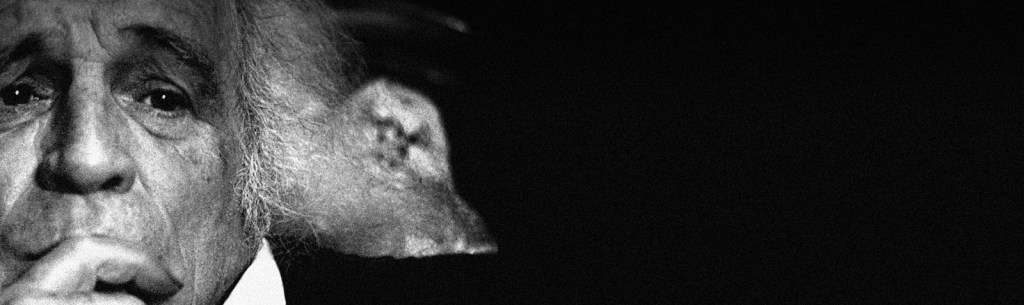
Un jour je te dirai pourquoi j’écris. La poésie s’arrange toujours ; il suffit d’être là, truelle en main et sueur suintant au soir, devant la soupe, comme un maçon. Tu es maçon, je suis maçon avec au bout de ma plume des tonnes de ciment gueulant de soif dans le désert de mon « inspiration ». J’ai une muse suspecte qui a des bas de châtaigniers toujours verts, des avoines à Mercedes et de l’eau claire qu’elle pompe à longueur de minutes séchées dans ma gourde frileuse. Et je musarde malgré ça !
J’ai le culte d’un certain désordre, une porte mat ouverte sur un assemblage imbécile où flirtent, maladroitement, une vieille page de garde d’un livre ancien, roux d’ennui, une grosse boîte d’allumettes, une paire de bretelles, une boîte à mauvais violon acheté pour rien chez un mauvais chineur, un tube de produit pharmaceutique, un emballage de film. J’ai le culte des mares où volettent des moustiques, des mouches, toute une floraison de veinules griffées d’ongles. Dans le désordre de ma maison, dans celui de la mare, je projette de m’aliéner, bêtement, fumant cigarette sur cigarette, grattant, ressassant dans le pénible crépuscule de la soixantaine des souvenirs que je voudrais bien équivoques pour mieux les immoler aux terreurs bourgeoises que je détecte jour après jour autour de moi. Je m’aliène dans les mots. Quand je dis : « Je vous méprise ». je me donne à vous quand même sous le couvert d’un mot, d’une injure. Vous m’avez à portée de mépris, vous aussi. Je boite. Rien n’égale en ivresse cette attente au bout de l’ennui quand bâillent les violettes, quand plongent les lourds nuages de Baudelaire, Ici-bas, vers les météorologies secrètes et dont jamais aucun météorologue ne pourra dire l‘exacte définition. Tout est dans tout. Mon âme ainsi, pareille aux désordres qui m’assaillent se trouve toujours aux confins des miettes, du regain, du déjà fait. J’arrive toujours en retard car je ne pars jamais. Et pourtant, je vis dans d’autres cas. Je me décline secrètement à l’aide de suffixes bien à moi. Je suis un langage fermé.
Les mots, voilà votre misère et ce par quoi vous êtes aux fers, irrémédiablement. Aucun espoir, aucune ouverture au-delà des pièges à sots. J’ai la vertu qu’il faut pour ne m’encanailler jamais qu’en connaissance de cause et de Code Pénal. Il est beau ce monument grave dans la mémoire des coups-de jatte.
On ne fait pas la poésie avec des tracts. On la fait avec sa gueule bien ouverte sur les verbes habituels et de préférence actifs. C’est par le style, où qu’il loge, que je me déshumanise et grimpe aux cimes du non-dit, de l’incontrôlé. Le style, c’est cette personnalité du doute enfin traqué. C’est une ombre en détresse qui cherche à se lover sous le soleil de l’admis, du tout fait, du symbolisme courant.

Lisa quand elle s’endort, il y a comme un trou dans sa tête, un trou dans son histoire. Elle cherche. Elle a mal. C’est sa mère. Elle nourrit sa souffrance. Sa mère, comme une question, comme un doute. Elle n’y croit pas, plus, ce n’est pas elle, impossible, il n’y a rien qui l’attache, elle a perdu le fil.
L’orage l’effraie, l’orage comme une secousse dans le cerveau. Sa mère parlait de l’orage, avec des flammes dans les yeux. Et la peur lui entre dans la tête, la folie si proche, là juste derrière le regard qui se souvient. Sa mère lui a parlé de la naissance, peut-être la sienne, une nuit terrible, une nuit de février. Il y a la neige qui s’accumule, elle tombe par vagues, couches après couches. Et le silence prend toute la place. La neige comme une douceur, comme une mère qui se prépare. Et le tonnerre gronde, frappe comme une punition.
Lisa ne croit plus à cette histoire. Une histoire de cette femme qui ne joue même plus à être sa mère. Elle n’y croit plus. Elle n’a plus la force. Elle pleure.
Elle pleure et pourtant elle vient de faire l’amour. Elle aimerait trouver un autre verbe d’action pour accompagner l’amour plutôt que cet ignoble verbe faire qui se marie avec tant de compléments sans émotions, faire la vaisselle, faire le marché, faire son devoir, faire sa toilette. Faire l’amour ça abîme la tendresse, ça détruit le geste. Elle a cherché dans les dictionnaires, mais rien pour lui donner l’émotion, rien que des mots viandes qui suintent l’obscène. Copuler, s’accoupler, baiser, elle n’en veut pas, ça lui fait mal quand elle les dit, ça laisse comme un mauvais goût dans la bouche, un peu fauve, si loin du parfum de l’amour.
Elle a choisi de ne plus compromettre ce mot. Elle le dit seul, sans artifices, sans emballages. Les autres sourient quand elle dit : « j’amoure ». Ils sourient mais ils l’aiment. Comme celui de ce soir, il est bien, il l’a aimée, et maintenant il la regarde qui pleure. C’est un beau gosse comme on en voit dans les magazines, soigneusement mal rasé et les dents blanches. Il y a cinq minutes, il était encore en elle. Pour la quatrième fois, appliqué, méthodique. On aurait cru qu’il passait un examen ou le permis de conduire. Elle avait joui, bien sûr, bruyamment et sans difficultés. Difficile de s’en priver avec un tel outil dans le bas ventre et des yeux aussi verts. Mais maintenant elle pleure Lisa.
Elle pleure, comme à chaque fois, comme à chaque orgasme. Ça lui fait comme une décharge électrique. Elle voit la même image, subliminale comme disent les publicitaires. Un bébé : il pleure, il crie, il a peur. Il est proche, elle le sent, contre sa joue, elle sent son souffle, un souffle neuf. Et puis il y a l’orage, elle l’entend, elle tremble, se recroqueville. Elle ne veut pas se retrouver seule.

Pas un pli, pas un cri,
Fleuve est en cage.
Rien ne glisse, tout est lisse
Ville est enfermée.
Vite,
Efface ces traces d’ennui,
Sur les pages usées
De ton regard habitué.
Et,
Dans le fond bleu
De ta boîte à envie,
Prends une couleur.
Oui, celle-ci,
Elle est si belle,
Dans le pli de tes yeux…
13 février

Dans la rousse lande
D’une île du Ponant,
Hommes en berne,
Ceuillent un bouquet de silence.
De vagues en vagues,
Pleurant l’ami emporté,
Au fond du vase l’ont déposé.
Une à une, fleurs engluées,
Ivres de brume, se sont dressées.
Sous le vent levant,
De vert se sont poudrées.
Hiver est là, sec, pressé.
Hommes en pleurs
Sous une lourde pierre
Deux larmes ont posé…
12 février

C’était un demi-soir où il attendait. C’était un de ces moments qu’on ne peut définir, qui hésite, entre bleu et noir, instant fragile où tout peut basculer avec un simple sourire. Il attendait. Attendre, il savait. Il ne savait faire que cela, attendre. Il n’attendait rien ou si peu, qu’il ne se souvenait plus quand il avait commencé. Il attendait mécaniquement, dans l’espoir qu’il se passe quelque chose, dans l’espoir qu’il participe au voyage.
Pour tuer le temps il le regardait passer. Il aimait ces moments de rien où il parvenait à percevoir son existence. Il comparait le trajet de sa trotteuse avec celui qu’effectuait celle de la pendule en formica. Une pendule de cuisine, un peu bleue, en plein centre du mur le plus vide. Une pendule à la géométrie arrondie pour faire moderne ou sport. Quand il avait commencé, elles en étaient au même point, sur le six. Il les suivait du regard, comme deux coureurs à la cadence réglée. Tout avait bien commencé. Les premiers tours se déroulaient sans problèmes. C’est à partir du dixième tour que la trotteuse de sa montre pourtant plus fine, plus légère, plus suisse en fait, montra les premiers signes de fatigue. Jusqu’au six tout allait bien, elle déroulait parfaitement sa foulée. C’est dans la remontée vers le douze qu’elle a commencé à perdre un peu de terrain. Oh, pas grand-chose ! La pendule en formica était en tête d’une toute petite seconde. Le plus inquiétant c’est que malgré la descente elle n’a jamais pu combler son retard et au bout d’une heure la pendule annonçait fièrement 19 h 02 tandis que sa montre n’en était qu’à 19 h 00. Elle s’était laissé distancer de deux minutes : énorme sur un tel parcours qu’elle connaissait parfaitement. Un parcours qu’elle avait déjà accompli des milliers de fois. Il y avait certainement un problème.
La pendule en formica ne pouvait être digne de confiance, elle avait toujours fait preuve de fantaisie. C’était une pendule de cuisine après tout ! Elle était faite pour annoncer les repas, elle était destinée à rythmer les déglutitions de soupes chaudes. Elle ne pouvait s’habituer à attendre. Le silence ne lui convenait pas, et elle accélérait sûrement à l’approche des premiers sons de fourchettes.
C’était une pendule qui avait appartenu à sa famille. Elle était l’objet qui lui rappelait le plus sa mère. Aujourd’hui il l’observait d’un air menaçant. Il avait commencé par la secouer. Un geste machinal, un besoin kinesthésique, c’est ce que lui aurait expliqué un psychologue. Il avait ce besoin constant de toucher, de palper, de tâter. Quand il devait acheter une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, il ne pouvait s’empêcher d’en frapper violemment les pneus à grands coups de pieds. Ridicule. Ridicule mais indispensable. Il fallait bien que les objets comprennent qu’il était le maître, le seul, l’unique.
Il remplacerait cette antiquité et achèterait une pendule au mécanisme plus fiable. Il en avait repéré une sur un catalogue, elle était d’une telle précision que l’annonce prétendait qu’elle était réglée pour plus d’un million d’années. Plus d’un million d’années, il se sentirait enfin en sécurité absolue grâce à un tel objet. Il la commanderait et renouvellerait l’expérience : si sa montre persistait à prendre du retard dans les côtes, alors les Suisses l’entendront !

Oh navire ferroviaire,
Tous les matins, je t’attends…
Sur le quai, tu le sais,
J’invente la mer.
Un oiseau passe,
Il m’offre une rime.
Je ferme les yeux,
Tous les matins, je t’entends.
Ne dis plus rien,
Je n’ai pas mieux…
Tu essaies

Sur le chemin des écoles vides
Trois mots d’amour se sont perdus ;
Pas une rime pour se guider.
Seuls et légers,
Sur un fil de douce rosée,
Ensemble se sont posés.
Pas un cri, pas un chant,
Les enfants sont oubliés.
Trois perles de silence
Sur leurs L se sont posées.
Mots d’amour,
Tendrement se sont regardés.
Dans un souffle de vent frais,
A tire d’aile se sont envolés.
11 février 2020

Longue nuit de feu,
Dansent flammes aux langues bleues.
Tremblent les hommes gisant.
Entrouvertes, les fenêtres des amants
Laissent entrer un rêve d’enfant.
11 février
Après avoir publié de larges extraits de mon premier roman » quelques mardis en novembre », je vais publier aussi des extraits de mon troisième manuscrit, « un orage en février »

Et à chaque fois il faut recommencer, Jules le sait. Il faut repartir de zéro en serrant les dents, accepter que rien ne fonctionne comme il le voudrait.
Jules est seul et il ne comprend pas.
Jules interroge le monde. Et le monde ne répond pas. Le monde a oublié Jules. Les autres continuent de vivre. Jules observe autour de lui les autres, le monde. Il s’interroge, il interroge. Le monde a changé. Ce n’est déjà plus une question. Jules est englouti : que s’est-il passé ? Tout ne va pas à la même vitesse : les questions que l’on pose, les réponses que l’on attend. Jules comprend : les autres passent et pensent et lui reste, là, tout petit, grain de sable. L’orage est passé, il s’éloigne. Jules est immobile, les bras qui pendent au bord du corps, la tête emplie de toutes ces histoires qui ont traversé.
Jules se souvient de son maître d’école qui expliquait l’immensité de l’univers. C’était fascinant : il comparait la terre à un grain de sable. Il précisait même : « un petit grain de sable » … Le soleil était une orange. Une orange qu’il sortait du fond de son cartable. Elle était lumineuse. C’est peut-être cela qui l’éblouissait le plus, l’orange brillait. Lui ne mangeait que des oranges fripées, la peau ternie par des séjours prolongés dans la cuisine surchauffée.
Jules n’est plus le même, il est autre. Jules est dans le monde qui l’absorbe, qui le digère et lui ne peut rien. Il se tait et continue. Jules est dans le monde qui l’entoure. Il est dedans et il attend. Il attend les prochains orages. Jules aime l’orage. Personne ne comprend et à chaque colère du ciel il est puni d’être bien, d’être heureux. Alors le monde des autres le gomme, l’efface. C’est fini, il n’existe pas, pas de traces, pas d’histoires. Les autres le voient comme un détail. Un infime détail.
Jules se souvient. Il sentait les secondes pénétrer en lui, elles se répandaient, fourmis qui ont découvert le passage. Il les sentait, les voyait, les entendait. Elles débutaient leur vie dans un monde mécanique puis disparaissaient, sautaient du cadran, s’échappaient et le pénétraient comme de petites vrilles. Il leur en voulait de le faire tant souffrir. Il leur en voulait de s’additionner, de s’agglutiner par grappes charnues. Il aurait voulu qu’elles soient légères mais elles étaient pesantes, oppressantes, elles occupaient tout son temps.
Parfois il passait de longues minutes à les observer, à les interroger. Il tentait de saisir l’instant où elles se matérialisent, cet instant si bref, cet instant sublime qui se situe entre le passé et le futur. Il essayait de les vivre entièrement, l’une après l’autre. Il aurait voulu éprouver la sensation du temps qui passe, qui coule mais n’y parvenait pas. Il aurait voulu apprivoiser cet espace qui doit bien exister quelque part entre deux unités. Il n’admettait pas d’être impuissant et de ne pas maîtriser la course folle, la course en avant.

Je voudrais écrire,
Oh oui, je le veux…
Écrire pour deux,
Pour toi, pour eux.
Je voudrais écrire
Heureux,
Entre deux lourdes marges en feu.
Oh, je voudrai tant écrire,
Ce mot qui caresse,
Là, seul,
Il attend, rien ne presse.
Je voudrais tant écrire
Tendresse,
Sur une feuille d’automne
Aux rimes mauves
Sur le titre accrochées.
Je voudrais tant…
Tremper ma plume
Dans une flaque de rires jolis.
Je voudrais tant entendre
De longs mots aux ailes bleues.
Ils chantent, ils dansent,
C’est eux, ils sont arrivés.
10 février 2020

Homme en plaine,
Ta mer est si loin,
Il te faut la rêver.
Elle est là, c’est elle.
Je l’entends.
Dans l’arrière-pays de ta tête,
Elle chante et danse,
De vagues couplets aux reflets bleus.
C’est si long,
Toute une nuit passée,
A pousser des cris de vent gris.
Au matin du levant,
Impatient,
Homme en peine,
Coeur à marée basse,
Ouvre les lames de ses yeux.
Il pleut des larmes salées,
Sur le sable fleuri.
Doucement, sans un bruit,
L’homme sans haine,
Lève son regard bleu,
Le pose au fond du ciel endormi.
Regarde-le,
Il pleure une vague échouée…

Depuis quelques jours, tout s’accélère. Je sens bien que la mort est entrée en moi par une porte dérobée que j’ai toujours eu l’idée de laisser entrouverte. Je la sens bien qui rôde, mais je ne sais pas encore ce qu’elle est venue faire. Je ne sais pas encore qui de nous deux est le maître. Je ne vois plus, je ne pense plus qu’en noir et blanc. Depuis ce mardi où Héléna a été exécuté toutes les couleurs ont revêtu leur tenue de deuil.
Tout s’accélère, je ne vois plus personne, nulle part. Je n’ai plus parlé à personne depuis plusieurs jours, j’ai oublié le sens des mots.
Ce n’est plus un malaise qui est en moi, c’est moi qui ai pénétré en lui. Je l’ai pénétré avec fureur, avec douleur. Je suis entré en lui par les chemins de la haine. Je suis en lui, jusqu’à l’écœurement, jusqu’à l’aboutissement. Tout cet univers de choses qui m’entourent et m’attendent ne me produit pas plus d’effets que la vision d’un amoncellement hétéroclite d’objets inanimés et sans importance. Quand j’erre dans ce monde en putréfaction, j’ai la nette impression que tous mes sens se sont regroupés en un seul. C’est une sensation, une oppression plus qu’un sens, et il est si nouveau qu’au début il désoriente, il déséquilibre, il inquiète. Lorsqu’il naît, il est tout d’abord comme une boule de coton au creux du ventre. Puis il se diffuse dans tout le corps, il envahit tous les autres centres de perception, et peu à peu, je ne suis plus qu’une déchirure, qu’un trou dans ce qui entoure tous les autres.
Le temps ne s’écoule plus pour moi, il s’agite par vagues successives au fur et à mesure que je me rapproche du bout. Je n’espère plus rien dans ce qu’il me reste de chemin à parcourir. J’ai abandonné mon statut de vivant, je n’en suis même plus l’apparence. Même si demain existe dans l’ascension vers la décomposition totale, je me suis définitivement arrêté. Je me suis arrêté à hier, à un seul hier, un hier que je ne partagerai plus jamais avec personne. Mon hier à moi, je le garde bien au chaud, au creux de ce qu’il me reste de souvenirs. Mon hier, je ne le distribue pas en pâture aux langues déliées. Ce hier, c’est le seul fil qui me reste, c’est mon tombeau, c’est mon arme. C’est vous, c’est tous qui me l’avez fabriqué depuis que les Mardis de novembre ont été introduits dans mon calendrier. Un jour, peut-être que je reviendrai à aujourd’hui, mais il m’aura fallu couper les fils. Et je ne saurais pas de quoi sont faits les lendemains.

Sous les pavés
La plage effondrée.
Tend son oreille libérée,
Pas un chant d’amour,
Plus un souffle d’espoir.
Les coeurs sont asséchés,
Au coin de son regard effarée
Une larme de sel a séché.
Partout on crie,
Partout on hurle,
Haines aigres retirez vous !
Mes vagues vont déferler…
Que dire, sinon qu’on atteint le sublime…
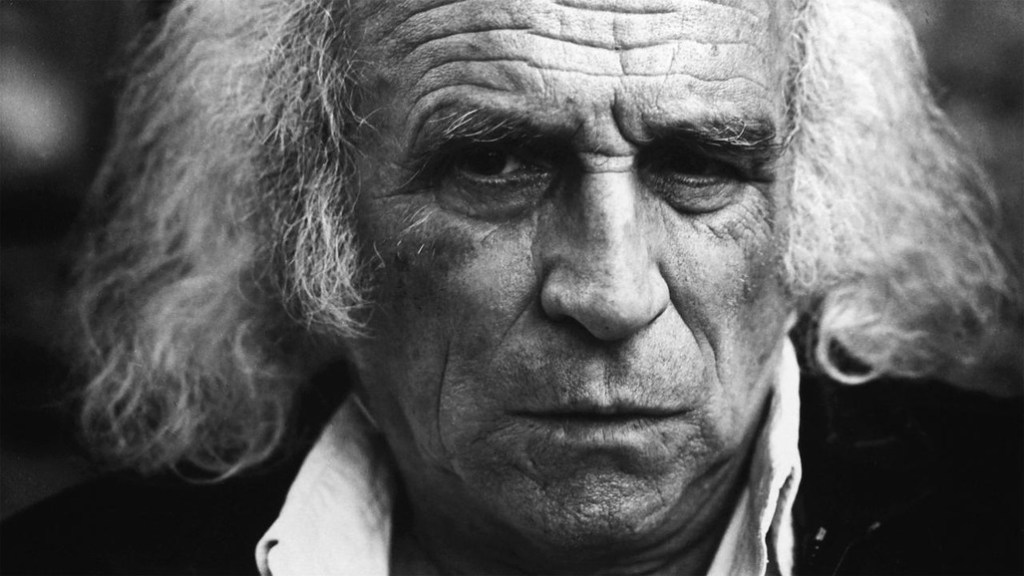
…La solitude est une configuration particulière du mec : une large tache d’ombre pour un soleil littéraire
La solitude c’est encore de l’imagination
C’est le bruit d’une machine à écrire
J’aimerais autant écrire sur des oiseaux chantant dans les matins d’hiver
J’ai rendez-vous avec les fantômes de la merde
Les jours de fête, je les maudis, cette façon de sucre d’orge donné à sucer aux pauvres gens, et qui sont d’accord avec ça et on retournera lundi pointer
Je vois des oranges dans ce ciel d’hiver à peine levé
Le soleil, quand ça se lève, ça ne fait même pas de bruit en descendant de son lit. Ça ne va pas à son bureau, ni traîner Faubourg Saint-Honoré et quand ça y traîne, dans le Faubourg, tout le monde s’en rengorge. Tu parles ! Ni rien de ces choses banales que les hommes font qu’ils soient de la haute ou qu’ils croupissent dans le syndicat. Le soleil, quand ça se lève, ça fait drôlement chier les gens qui se couchent tôt le matin
Quant à ceux qui se lèvent, ils portent leur soleil avec eux, dans leur transistor.
Le chien dort sous ma machine à écrire. Son soleil, c’est moi
Son soleil ne se couche jamais… Alors il ne dort que d’un œil
C’est pour ça que les loups crient à la lune. Ils se trompent de jour
Les plantes ? Les putes ? Les voitures ?
Cette voiture aussi qui débordait… C’était terrible… Qu’est-ce qu’on riait !
Et je rêve aujourd’hui d’une voiture monoplace
Et ce bois de chauffage qui s’est gelé des tas d’hivers en attendant mon incendie
Je vous apporterai des animaux sauvés, l’innocence leur dégoulinant des babines ou de leurs yeux
Je mangerai avec eux, de tout, de rien
Je boirai avec eux le coup de l’amitié et puis partirai seul vers un pays barré aux importuns
Presque tous
Je suis un oiseau de la nuit qui mange des souris
Je suis un bateau éventré par un hibou-Boeing
Je suis un pétrolier, pétroleur de guirlandes et de marée plutôt noire comme mes habits, et un peu rouge aussi, comme mon cœur
J’aime la multitude, la multitude, les chiens, les hiboux, les horreurs ! La multitude, les chiens, les hiboux, les horreurs !..

Celui qui me l’a prise, je ne veux pas le connaître. Il a eu beaucoup de chance, il n’a eu que des blessures légères. Cet accident, Héléna, ne seront bientôt plus pour lui qu’un souvenir de calendrier. Je ne veux pas le connaître et encore moins le voir. Je ne veux pas gaspiller quelques secondes de ma douleur à contempler un visage déjà rencontré des milliers de fois. A chaque coin de rue, à chaque coin de foire, à chaque coin de laideur. Je ne veux pas le voir exister, je veux qu’il reste comme une hypothèse que je ne pourrai jamais vérifier.
Il est tard. Cela fait six jours que je ne suis plus qu’un reflet. Je suis dans un tram, l’un des derniers, celui où les solitudes s’entrechoquent. Ils étaient deux à regarder cette fille que je n’avais même pas voulu remarquer. Ils étaient le cœur au garde à vous face à une odeur d’alcool national. Ils étaient deux à l’observer comme s’il s’agissait d’un de leurs vulgaires défilés de majorettes. Ils ne voulaient pas la violer bien sûr, ils voulaient simplement l’inclure dans leur collection. Ils la tâtent et la tutoient du regard. Je ne supporte pas leurs yeux, ce sont les mêmes qui auraient pu salir Héléna. Les Héléna du monde entier. Leurs yeux, c’étaient de ceux qui pourrissent la moindre parcelle de printemps. C’est à ce moment précis que je me suis levé, et me suis mis à crier, à hurler, comme jamais je ne l’avais fait. J’ai hurlé, longtemps. Je ne peux pas dire dans quel registre je pourrais classer ce hurlement. Mais ce que je sais c’est qu’il était long, terrible, effrayant, douloureux. Ce que je sais c’est qu’il m’a empli d’une vibration qui ne m’a pas quitté depuis. J’ai hurlé pour moi, pour elle, pour les autres. J’ai hurlé pour Héléna. J’ai senti tout mon corps hurler. Je l’ai senti qui n’en pouvait plus d’assister à cette nouvelle mise à mort. J’ai senti mon ventre plus noué que celui d’un orphelin du premier matin. Mon corps n’est plus qu’un miroir, un miroir dans lequel Héléna est encore en train de mourir une nouvelle fois. Comme dans un cauchemar, je me suis levé. Pas un son civilisé ne parvient à sortir de mon trop plein de haine. Je n’étais plus qu’un corps, un corps désespéré, tout entier voué aux cris. J’étais devenu un simple corps torturé, une ombre indescriptible, l’ombre d’Héléna.
Je leur ai vomi dessus, tout en les frappant. Ils se sont crus alors obligés de rajouter au drame se jouant depuis des siècles des injures si usées qu’on a l’impression qu’ils étaient eux‑mêmes inscrits en petites notes supplémentaires en bas de page de la liste des montreurs de virilité. Ce n’étaient plus mes poings qui les frappaient, c’étaient eux qui s’y écrasaient avec force, avec conviction même. Je ne comprends pas pourquoi ils sont partis si vite, peut‑être pour ne pas être obligés de comprendre le rôle qu’ils jouent dans cette pièce. Leur victime ne comprend pas non plus. Elle doit avoir l’habitude de ce genre d’attitude et me regarde comme si j’étais quelqu’un d’autre. Ses yeux auraient pu me dire merci, mais elle s’est contentée d’un : «ne fallait pas vous mettre dans un état pareil pour si peu ! « Je ne sais plus si je pleurais lorsqu’elle m’a dit cela. Je sais seulement que je suis parti en courant.
Il y a bien longtemps que nous n’avions entendu les chamailleries de la norme et de la beauté. Grâce à cette magnifique photo transmise par mon ami Roland, de Martigues, elles se sont réveillées…

La norme et la beauté, n’en finissent jamais de se chamailler. Leurs désaccords sont profonds. Je vous laisse juger…
Beauté : Ce soir je suis heureuse, tellement heureuse, ce n’était pas simple mais j’y suis arrivée.
Norme : De quoi me parles-tu ? De ce gribouillis fumeux que tu es allée me poser sur cette horrible plage que je me tue à dissimuler.
Beauté : Gribouillis fumeux, horrible plage…Chère norme, as-tu bien regardé ? Mais je m’égare…Comment la norme peut-elle simplement regarder ? Tu n’es là que pour mesurer…
Norme : Quelle impertinente ! Beauté, mais as-tu simplement regardé, ces traces que tu as laissées ? Que va-t-on dire ? Où sont tes limites ? Quatre cheminées ! Et pourquoi pas un pétrolier !
Beauté : Un pétrolier, quelle bonne idée, et j’y ajouterai aussi un amandier, un parolier, un cabanon, un réservoir, et surtout, surtout, norme engourdie, un peu d’espoir…
Norme : Il suffit beauté, je ne peux tolérer de tels écarts, tu le sais !
Beauté : Je te comprends norme, je le sais, tu n’y es pour rien. Je te demande une simple petite faveur…
Norme : Je t’écoute beauté.
Beauté : Ferme les yeux. Pendant quelques instants, oublie ce qu’on t’a raconté. Attends bien quelques minutes et doucement, tout doucement, soulève tes lourdes paupières et là, je te promets, tu verras. Et tu vivras…

Je suis retourné chez mes parents pour quelques jours. Je voulais éprouver ma souffrance dans un autre lieu que celui de la solitude. Tout était difficile à supporter, ils auraient tant voulu savoir ce que je ne pouvais à peine imaginer. Ils voulaient m’aider, ils voulaient me remettre sur les rails, me refaire une santé, m’aider à retrouver le moral… Mais moi, je ne les écoutais même plus, je ne les entendais pas.
De toute façon, depuis quelques jours, je n’entendais plus rien, ni personne. Le seul son qui accompagnait mes silences était celui produit par les battements de mon cœur qui se répercutaient très nettement dans le vide de mon crâne.
C’est samedi soir. Je suis retourné dans le bar où j’avais passé ma dernière soirée avec Rémi. Rien n’a changé. Dès que je suis entré, l’odeur un peu particulière m’a frappé en plein souvenir. C’est une odeur indéfinissable parce que constituée de multiples mélanges. Mais on ne l’oublie pas, elle s’incruste, elle s’installe secrètement dans un coin tranquille de notre mémoire et à la première occasion, elle réapparaît. Les personnages ne sont pas les mêmes, mais les visages sont identiques. Je suis seul à ma table, comme beaucoup, et je sens les regards des autres qui s’efforcent de s’approprier quelques particules de ma souffrance. Je bois et je pleure. De tous ces liquides qui m’inondent je m’entoure avec délice. La bière que je bois, un peu aigre, un peu amère, rime bien avec ma grisaille intérieure. Elle me pénètre calmement, et imperceptiblement me conduit aux limites de ce que je crois être le bout. Ma douleur est de plus en plus vraie, de plus en plus formée. Elle se répand, s’insinue dans tout ce qui subsiste aux quatre coins de ce monde visqueux. Elle se heurte aux sons métalliques d’une musique de fond et me revient aux oreilles imprégnées de mélodies plaintives. Elle se heurte aux couleurs mauves des tentures et me revient par plaques noirâtres et jaunâtres. Elle se heurte à leurs regards vides et me revient encombrée de questions sans réponses.
Je passe encore quelques minutes à boire et à tirer de mon cerveau les dernières images nettes qu’il peut produire. Je ne sais même plus ce que je cherche au fond de ma mémoire. Lorsque je me lève pour sortir, je sens qu’il y a du Rémi dans ce geste banal. Je sens que je ne reviendrais plus dans ce lieu.
Je marche dans la ville endormie, dans la ville fantôme. Je marche et je ne sais plus si j’entre dans la ville ou si c’est elle qui me pénètre. Je suis dans la ville, elle est en moi. Nous sommes un et nous nous livrons une bataille sans merci. C’est une bataille de deux corps déchirés, de deux corps dont la cervelle est tiraillée de tous les côtés. Je la sens qui vibre à chacun de mes pas, je me sens vibrer à chacune de ses secousses. Je la sens qui respire, qui s’excuse de sa noirceur. Je la vois qui essaie de briller, je la vois qui tend l’échine pour que ressorte l’éclat vertébral de ses deux rails centraux. Elle pourrait être fière, rassurée par la présence géométrique de ces bouts de métal. Et pourtant ils lui font comme une cicatrice qui ne cesse de se rouvrir.
La nuit est belle. Elle m’accueille dans sa fraîcheur comme elle accueille la ville dans son humidité. Mon cœur bat très fort, comme si j’avais raté une correspondance importante, une correspondance pour une ville où même quand il pleut les gens peuvent sourire.

Il y a un navire dans mon jardin !
Un navire, mon ami, impossible, vous divaguez !
Oh non, vous dis-je, ce n’est pas un mirage…
Hier soir, c’est vrai,
Avec la nausée je me suis couché.
Toute une journée perdue à naviguer
Sur le bleu électrique de l’océan numérique.
Oh je le sais, c’est laid,
Pas une vague, pas un souffle salé.
Pour ce long naufrage à tous imposés.
Oh oui, bien sûr,
Parfois un peu de mousse
Sur la crête pâle des mots enfermés.
Alors oui, je le concède,
Quand le soir est tombé,
J’étais triste et abandonné.
Tant de bruits, tant de cris
Ce monde est fou.
Dans les bras de la nuit, je me suis blotti.
Doucement mes lourdes paupières j’ai baissées.
Tous mes rêves bleus se sont éveillés.
Un à un, ils se sont envolés
Au fond du ciel noir de ma mémoire meurtrie.
Et ce matin, oui c’est vrai ,
Il y a un navire dans mon jardin…
3 février 2020

Mon âme est comme un ciel sans bornes ;
Elle a des immensités mornes
Et d’innombrables soleils clairs ;
Aussi, malgré le mal, ma vie
De tant de diamants ravie
Se mire au ruisseau de mes vers.
Je dirai donc en ces paroles
Mes visions qu’on croyait folles,
Ma réponse aux mondes lointains
Qui nous adressaient leurs messages,
Eclairs incompris de nos sages
Et qui,lassés,se sont éteints.
Dans ma recherche coutumière
Tous les secrets de la lumière,
Tous les mystères du cerveau,
J’ai tout fouillé, j’ai su tout dire,
Faire pleurer et faire rire
Et montrer le monde nouveau.
J’ai voulu que les tons, la grâce,
Tout ce que reflète une glace,
L’ivresse d’un bal d’opéra,
Les soirs de rubis, l’ombre verte
Se fixent sur la plaque inerte.
Je l’ai voulu, cela sera.
Comme les traits dans les camées
J’ai voulu que les voix aimées
Soient un bien, qu’on garde à jamais,
Et puissent répéter le rêve
Musical de l’heure trop brève ;
Le temps veut fuir, je le soumets.
Et les hommes, sans ironie,
Diront que j’avais du génie
Et, dans les siècles apaisés,
Les femmes diront que mes lèvres,
Malgré les luttes et les fièvres,
Savaient les suprêmes baisers.

Héléna, notre rêve est fini. Il était si beau. Ce matin la grande rue n’en finit plus de s’étirer. Tu ne la traverseras plus. Un autre t’a effacé. Il ne te voulait plus comme je t’aimais. Il te voulait facile et sans questions, un sourire à chaque retour. Il te voulait pour être un couple, pour dire aux autres « regardez-moi, je suis un homme, elle est à moi ».
Quand t’es partie je savais que tu oublierais notre ville. Je savais que tu n’en voudrais plus, je savais que quand tu reviendrais t’aurai la nostalgie de cet ailleurs qu’on voit sur les photos glacées des magazines de salle d’attente. Je savais que t’aimerai le soleil. Ce soleil qui brille tout le temps, et si fort, qu’il en oublie de laisser une chance à toutes les couleurs. Je savais que tu oublierais qu’il y a du bleu dans le gris quand on sait le supporter.
Moi, je t’ai rêvé avec application. Chaque soir, chaque moment où le temps flotte, où il hésite entre le présent et le passé, je t’ai rêvé. J’y ai mis toutes mes forces, j’ai rassemblé tous mes souvenirs de toi, de nos premières rencontres et j’en ai fait de multiples paquets à déguster les yeux fermés sans modération. Je t’ai rêvé si fort, si vrai que je ne savais plus si je dormais. J’étais bien à te faire vivre, à te faire rire à te fabriquer des souvenirs que je suis le seul à connaître. Et quand vient le matin, quand vient la fin, je me souviens de toi, de toi, de ton corps qui vibre quand on l’effleure au creux du sommeil.
Héléna notre rêve n’était pas terminé. Tu m’as réveillé, t’as plus voulu que je t’invente d’autres couleurs. T’as plus voulu que je t’écrive des mots que je suis le seul à trouver beau. Et pourtant tu m’aimais, je le sais, je le veux. Tu faisais des efforts pour ne pas me le dire. J’entends encore tes pas mouillés quand tu sors de sous la douche. T’es fraîche et ta peau est tendue. Le bout de tes seins est dur comme un noyau de cerise. Je t’aimais Héléna, je t’aimais nue au milieu de la pièce à attendre d’avoir froid pour que je te serre, pour que je parle à ta peau, à tes seins, tes cuisses et ta bouche qui espère la rencontre. J’aimais ton désir d’abord discret comme une brise qui se lève, léger, insignifiant, juste pour dire qu’il arrive et puis le vent qui grossit, qui gonfle, le vent qu’on entend, qu’on touche qu’on sent.
Souviens-toi Héléna, comme j’avais mal quand tu m’ignorais, quand tu me transformais en élément du décor. J’avais mal et je te le disais. Je te montrais l’endroit de ma souffrance, là, juste au-dessous du sternum, comme un morceau avalé de travers. Et toi tu haussais les épaules, parce que ce n’était pas normal. Je n’aurai pas dû crier, je n’aurai pas du pleurer. Tu voulais plus d’un homme qui gémit, tu voulais quelqu’un qui ait de la poigne, de l’autorité sur ses propres sentiments.
Aujourd’hui, t’es partie Héléna, t’es partie, et moi je reste seul dans cette ville qui t’a prise et me laisse subsister… Mon corps est de bois, il est étendu, irrémédiablement. Je me sens si lourd, si creux, si terne, si triste. Dehors des gens bougent, ils se déplacent vers d’autres, qui les attendent ou qui les espèrent. Ils parlent, de la vie, de leur vie.
Héléna, je ne souffre plus, je suis calme. Tout est devenu si clair pour moi, tout est si achevé. L’angoisse a disparu, elle a fondu. La haine s’est incrustée. Fondamentale. Elle s’est cristallisée dans le prolongement douloureux de ton départ définitif.
Le malaise n’existe plus, il n’a jamais existé, et n’existera jamais. Le malaise n’existe plus, il est moi, et plane au-dessus des autres pour encore quelque temps…
Je fouille, je fouille, je cherche et je trouve encore quelques textes, très anciens, expériences anciennes de mon laboratoire poétique…

Je suis d’ une autre grammaire que la vôtre
Je n’ai pas de proposition principale
Je ne parle qu’en subordonné
Au temps présent qui s’écoule
Et qui m’attend
Les plaintes ne nourrissent pas la vérité
Elles ont brûlé mon trop plein d’espoir.

« Héléna, il est mardi, un mardi débutant, et je t’écris parce qu’il ne peut en être autrement, parce qu’aujourd’hui il y a tant de mots qui se sont fait mal, qui se sont salis pour te faire disparaître que je vais leur donner une nouvelle chance, une dernière chance, pour te parler. Je sais maintenant que tu es partie. Je l’ai appris par hasard, quelques jours après. Mais ça n’a pas d’importance, tu es partie, et je suis là, à attendre. Je crois que vendredi la gare sera infiniment petite en l’absence de ces deux êtres qu’elle regardait se retrouver chaque semaine. Héléna, tu es partie, parce qu’on t’a poussé. Tu as terminé ton voyage sur une autoroute.
Tu es partie, un an après Rémi. Et aujourd’hui, je suis seul, définitivement. Je n’ai plus personne à qui montrer que même les hommes pleurent. Je n’ai plus personne. Mes larmes, c’est tout ce qui me reste de toi, c’est tout ce qui me restera de toi. Je les garde précieusement, et les enferme au plus profond de ma haine. Et je les ressortirais, chaque soir, chaque jour où tu viendras m’inonder de ta présence. Je reste seul au milieu de cette foule de coupables qui ont lu leur journal du matin avant moi et ce soir pourrissent un peu plus dans leurs pantoufles en s’inoculant toutes leurs inepties nationales. Je reste seul parce qu’un des leurs, un de ceux qui font rimer le bonheur avec leur réussite commerciale a voulu te sortir de ce qu’il croyait être un trou. Je ne le connais pas ce conducteur du mardi, je ne le connais pas mais je le suppose et je l’imagine…
Je n’en veux pas à tes parents de ne pas m’avoir prévenu. Ils ne m’aimaient pas et je le leur rendais bien, de toute façon cela n’aurait rien changé, ni pour toi, ni pour moi. Aujourd’hui, je suis seul, et mes larmes sont mon seul lien avec toi, avec ce monde dans lequel nous avions essayé d’ouvrir des parenthèses. Je ne sais pas ce que sera demain. Je ne vis pas pour demain, je ne vis pas pour aujourd’hui. Je ne vis plus, je suis le prolongement du dernier cri que tu as dû pousser. Et, comme la lumière des étoiles, qu’elles naissent ou qu’elles meurent met plusieurs années avant de nous atteindre ce cri mettra plusieurs années avant de s’éteindre. Ce cri, qui est le tien, qui est entré en moi par l’intermédiaire d’un banal coup de téléphone, ce cri, il grossit chaque seconde, il s’amplifie merveilleusement. Il puise son énergie dans les soutes de la haine et de la souffrance que je croyais avoir refermées pour plus longtemps. Ce cri, il ne pourra plus disparaître, il ne pourra que se poursuivre, se prolonger. Il faudra pour cela qu’il en fasse naître d’autres, beaucoup d’autres. Il sera alors cri de haine, de douleur ou de désespoir et peut être alors il aura terminé sa course.
Hier je pleurais pour Rémi. Avec toi. Aujourd’hui je pleure pour toi. Seul. Je pleure et les quelques lignes qui me resteraient à t’écrire me sont de plus en plus pénibles, parce que je sais que demain tous ces mots se seront tus. Définitivement. Héléna, j’aurais tant voulu commencer un nouvel été avec toi, ici, ailleurs peu importe, mais avec toi… «

Je suis allé au siège du journal local. Je leur ai demandé s’il était possible d’avoir les journaux de la semaine dernière. Ils m’ont amené un tas de papier grisâtre dans lequel je trouverais peut-être la dernière trace d’Héléna. Je ne sais même pas ce que je cherche, je ne sais même pas ce que je veux. Bien sûr, sous la rubrique des faits divers je ne trouve rien. Il ne s’agit que d’un banal accident de la circulation. En plus il a eu lieu dans une autre région. Il n’y a donc aucun intérêt à gaspiller du papier pour relater un événement qui n’aurait pu même pas m’intéresser.
C’est en lisant la rubrique nécrologique que j’ai compris que le coup de téléphone de tout à l’heure était bien réel. « Madame et monsieur Vaudour ont l’immense douleur de vous apprendre le décès accidentel de leur fille Héléna dans sa vingt- deuxième année. Ni fleurs, ni couronnes, ni condoléances. La cérémonie et l’inhumation, à la demande de la famille se dérouleront dans la plus stricte intimité »… Mes yeux ne se détachent pas de ces lignes, où quelques lettres se sont aujourd’hui arrangées pour écrire une formule de mort. J’en veux à cet alphabet parfois capable d’écrire les plus beaux mots d’amour, mais qui aujourd’hui, avec la complicité d’un papier de mauvaise qualité annonce aux citoyens cultivés qu’un des leur est parti pour toujours.
Je n’achète jamais le journal, je ne pouvais pas être au courant. De plus, pendant la semaine, je vis avec des horaires un peu décalés. Quand les autres rentrent chez eux, moi j’en sors. Et puis le retour d’Héléna était si proche, je ne pouvais pas m’imaginer même dans mes moments les plus noirs qu’elle aussi pouvait ne plus revenir. Je n’arrive plus à penser, il faudrait que j’aie du remords, il faudrait que je m’en veuille de n’avoir rien fait, de n’avoir pas su, de n’avoir pas été là. Il faudrait que je remonte le temps jusqu’à ce mardi soir où Héléna m’a quitté par deux fois.
Il est cinq heures, je marche. J’ai toujours le journal à la main. J’ai les dents si serrées que j’en ai les mâchoires douloureuses. Je marche, tout droit. Héléna, décédée, accidentellement. J’ai ces mots en tête, et à force de les entendre, à force de me les répéter, je ne les comprends plus, ils deviennent de simples sons qui rythment mes pas. J’accélère pour vérifier si je peux contrôler quelques-uns uns de mes muscles.
Il est tard, je ne sais pas ce que j’ai fait de ma journée. Je ne suis pas allé au ciné‑club, je ne les ai pas prévenus. Je suis assis devant un verre de bière. Je n’ai plus aucune sensation. Je suis la sensation elle-même. Je suis une sensation, un bouquet de sensations à la recherche d’une victime. Je suis le cri qui a déjà eu lieu et qui attend d’être entendu. Je suis la souffrance qui s’excuse de ne pas être plus forte. Je suis en train de passer dans une journée placée sous le signe de la pluie, placée sous le signe du lundi. Une journée où le seul symptôme de vie tient en quelques lignes au milieu d’un mauvais journal de province. Il fait nuit. Partout. Je pleure sur un grand lit. J’ai vu que le journal n’était que de papier, je me suis souvenu que tout ce dont je croyais être sûr ne m’avait été annoncé que par des objets inanimés. Je voudrais que les lettres de papiers n’existent jamais, que les mots transportés dans des câbles électriques ne puissent être que fabriqués. Pourtant je sais aussi que partout des yeux se sont promenés et se promènent encore sur les mêmes lettres. Je sais que partout il y en a d’autres qui continuent à rire, à espérer. Je sais que partout il y a des jeunes filles qui pourraient s’appeler Héléna et qu’on les attend, qu’on les attend pendant que d’autres s’efforcent de les supprimer « accidentellement » dans leurs magnifiques cercueils d’acier. Il est de plus en plus tard, et je vais t’écrire Héléna, je vais t’écrire cette lettre que tu aurais pu attendre, pour demain, pour tous les autres jours



Vitre grise est en sanglot,
Petites gouttes s’enfuient.
Tout va si vite.
C’est le train qui traverse.
C’est le train qui transperce.
C’est le train qui oublie.
Pas un visage contre la vitre,
Pas un regard pour la terre meurtrie,
La pluie est seule,
Elle s’ennuie.
Homme pressé
Ecoute-là, je t’en prie,
Quelques larmes
Sur la vitre elle essuie…
30 janvier 2020
On comprend aisément à la lecture de ce passage écrit il y a quarante ans, que Internet, les textos n’existaient pas. En effet je parle de « télégrammes » . La préhistoire…..

Cette nuit-là, l’orage est terrible. Il fait si chaud, rien ne va plus. Je n’arrive pas à dormir. Il faudra encore attendre demain pour la revoir. Ce matin-là, une odeur de Rémi flottait en moi. J’avais tant envie de la revoir, de lui parler de cette dernière semaine que nous aurions à passer l’un sans l’autre.
Elle n’était pas au train habituel. Je me suis dit qu’elle a peut‑être eu un contre temps, je ne laisse pas l’angoisse s’installer tout de suite et décide de me renseigner sur les horaires des prochains trains.
J’ai passé le week‑end à attendre. Héléna n’est pas venue. Je ne sais pas quoi faire, je n’ai pas le moindre numéro où la joindre. Je me résigne à attendre le lundi pour appeler au magasin. Je me dis qu’elle essaie aussi de me joindre. Peut‑être. Elle aurait pu m’envoyer un télégramme. J’attends, je n’arrive pas à me résoudre à autre chose qu’attendre. Demain ça ira mieux, je l’entendrais au bout du fil, au bout de ce cordon qui nous relie depuis un an.
Ici le personnel des Nouvelles Galeries embauche à huit heures. Je me dis qu’il doit en être de même là-bas. A huit heures moins dix je suis déjà devant une cabine. Je connais le numéro par cœur. J’entends mon impatience au creux de l’écouteur imprégné d’une désagréable odeur de tabac froid.
‑ Bonjour, je voudrais parler à Héléna.
‑ A Héléna, monsieur ? Vous êtes sûr, vous êtes un de ses proches ?
‑ Je ne suis pas un de ses proches, je suis celui qu’elle aime. Je l’ai attendu tout le week‑end. J’ai envie de lui parler, s’il vous plaît, passez-la-moi. Ce ne sera pas long, je veux juste l’entendre…
‑ Si c’est une plaisanterie je ne la trouve pas du meilleur goût, surtout pour Héléna !
‑ Je ne comprends pas ce que vous me dites, je n’ai pas envie de plaisanter. C’est tout simple, je l’aime et j’ai envie de le lui dire.
‑ Je crois que je commence à comprendre. Mon pauvre monsieur ! Vous n’êtes pas au courant ?
‑ Mais au courant de quoi !
‑ Ecoutez, c’est pas facile à dire, mais il faudra bien que vous l’appreniez un jour ou l’autre. Héléna a eu un accident de voiture. Elle a été blessée mortellement. Mardi soir… Elle rentrait chez elle. Elle a été tuée sur le coup. C’est notre nouveau directeur qui conduisait. Il la raccompagnait chez elle. Ils avaient eu une réunion…
‑ …
‑ Monsieur, vous m’entendez ? Vous savez, ce n’est pas étonnant que vous n’ayez pas été prévenu. Ses parents sont venus reconnaître le corps et dès le lendemain ils l’ont fait ramener chez eux. L’enterrement a eu lieu jeudi. Je crois qu’ils ne voulaient pas que cela se sache. Ils étaient tellement abattus.

Nous ne sommes pas rentrés tout de suite, nous avons marché dans les rues. Même la grande rue, d’habitude si droite, si austère s’est sentie obligée de composer avec les courbes harmonieuses que décrivait notre amour retrouvé. Nous nous sentions fous, nous nous sentions vrais, comme si nous étions les explorateurs d’un premier pays. La ville nous entourait, comme un relief involontaire. Nous la forcions à s’habituer à nous. De toutes ces avenues rectilignes, nous faisions des chemins, des rivières. Les gens qui nous croisaient, nous les épinglions à notre tableau de chasse de la tendresse. La ville avait disparu, elle était entrée dans notre déclinaison de bonheur.
Je ne pourrais pas raconter ces deux jours. Il n’y a pas encore de mots suffisamment affranchis de leurs lourdeurs grammaticales pour mériter de figurer en bonne place dans le compte rendu de ces émotions. Lorsqu’elle est repartie à la fin de ce week‑end, j’étais heureux, j’avais hâte de me retrouver seul pour jouir égoïstement de chacun de nos souvenirs. Tout s’était enchaîné si intensément, violemment presque, que j’en étais essoufflé. J’avais besoin de tout relire, de m’imprégner plusieurs fois des plus belles pages que nous avions écrites. Je ne lui ai pas parlé de mes angoisses. Elle ne m’a pas parlé de son soleil. Nous nous sommes contentés de nous-mêmes et nous sommes aperçus que c’était déjà beaucoup.
Pendant quelques temps nos week‑end se sont succédé comme s’ils étaient plus nombreux. Les semaines n’étaient même pas de simples parenthèses, elles n’étaient plus que les inspirations obligées que nous prenions avant notre remontée à la surface. Héléna me paraissait de plus en plus proche de moi. Je voyais en elle tout ce dont je m’étais persuadé au cours de mes brèves accalmies optimistes. Je m’efforçais de l’apprendre par cœur chaque fin de dimanche pour me la réciter au cours de mes nuits solitaires. Mais je me plaisais à oublier un peu d’elle, pour la redécouvrir avec passion à chacun de ses retours. Je lui parlais de plus en plus, avec douceur, avec lenteur. Sa personne flottait toujours en moi, comme une présence discrète et de plus en plus indispensable. Tout était si nouveau, tout était si simple.
Nous sommes presque arrivés au bout de notre parcours. Héléna pourra bientôt revenir dans la région. Elle a fait ses preuves et n’aurait pas de mal à obtenir une nouvelle mutation. Il ne nous reste plus que deux ou trois week‑end et nous serons à nouveau ensemble, à plein poumon. Aujourd’hui, Héléna est bizarre, sa présence ne paraît pas être totale. Il y a dans le balancement de ses regards une espèce d’aller-retour vers un ailleurs dont j’essaie de supprimer l’apparence géographique. Je ne suis pas inquiet, je me dis qu’elle est en train de réaliser que bientôt nous n’aurons plus besoin de ce quai de gare.
Voici bien longtemps que le tribunal académique ne s’était réuni. Le problème à traiter est on ne peut plus d’actualité….


Le tribunal académique s’est réuni ce matin en sa forme plénière et consultative. Il vient, en effet, d’être saisi par un grand nombre de citoyens, et a rendu un avis important, difficile, mais ô combien urgent.
Pour cette occasion, exceptionnelle, un collège de jurés a été constitué. Sa composition est, convenons- en un peu particulière. Y siègent : un poète, une militaire, un adolescent, une militante, un amoureux éconduit, un clown au chômage, une dresseuse d’ours, un cruciverbiste, et une religieuse défroquée…
Revenons aux faits : depuis quelques temps deux mots, et non des moindres, posent un problème. Deux mots qui, si on n’y prête garde, pourraient se ressembler. Il suffit d’ailleurs de les entendre. Deux mots, aussi, qui lorsqu’on écrit sur une feuille de papier un peu verglacée peuvent déraper…
Le président du tribunal résume en quelques mots la décision qui vient d’être rendue.
« Mesdames et Messieurs les jurés, chères et chers collègues, nous nous sommes réunis ce matin pour examiner, vous le savez : Haine et Aime… Les débats ont été animés mais sans haine et c’est cela que j’aime. »
« Aime et Haine vous le savez, vous le constatez, sont proches à l’oreille, ils le sont aussi à l’écrit et nous ne devons plus courir le risque qu’ils soient confondus… »
« A l’oreille, donc, les deux mots sont si proches qu’on les croirait, tout droit, sortis de l’alphabet. M est devant N, c’est un fait. Mais pouvons-nous, acceptons-nous d’en dire autant de Aime et de Haine. Cette promiscuité est nauséabonde, préjudiciable et disons le « inacceptable ». En conséquence nous exigeons, que N soit isolé et relégué à la place qu’il mérite et qui lui revient, en dernière position après le Z. Décision exécutable immédiatement. »
« L’autre problème est le risque de dérapage à l’écrit. Certes nous conviendrons que ce n’est pas courant, mais le collège des jurés souhaite ne prendre aucun risque. Qu’un distrait oublie le H de haine et que la main tremble et ajoute une jambe au n et le mal est fait. Les deux mots doivent, c’est impératif être séparés, distingués. En conséquence, le tribunal décide que quiconque décide d’utiliser ou d’écrire le mot haine doit, au préalable, adresser une demande écrite au collège des jurés qui à compter de ce jour devient un jury permanent. Cette demande devra indiquer les raisons pour lesquels le demandant envisage d’utiliser ce mot. Les jurés ont précisé que cette demande devrait être adressé sur une feuille de papier fleuri, et que la police utilisée serait le colibri… Le demandant sera ensuite convoqué et devra sous contrôle et avec le sourire écrire 100 fois le mot AIME..

Héléna ne peut être belle que pour moi seul. Je ne peux pas concevoir qu’elle puisse traverser les regards de tous ces quelconques qui pénètrent dans sa bulle brune. Ma jalousie est sans faille, elle est un modèle, une perfection. Depuis quelques jours, elle a atteint sa plénitude, elle règne sans partage et ne me permet aucun écart. Je ne puis supporter l’idée que d’autres l’utilisent, profitent des plaisirs qu’elle procure à être regardée et entendue. Je ne puis supporter l’idée qu’elle puisse rire, de peur que ses éclats de joie puissent éclabousser d’espoir les fantasmes pornographiques de certains témoins de son spectacle dont je veux rester l’abonné permanent.
Je la vois, dansante, comme lors de nos premières rencontres, si loin de moi, si charnelle, si courbe. Je la sens prête à m’abandonner, à franchir la dernière marche de cette folie qui nous réunissait, qui nous réussissait. Je la sens prête à oublier l’éclat des multitudes de couleurs qui nous accompagnaient à chaque baiser. Je la sens prête à oublier tout ce que nous nous sommes dit et à éliminer tout ce que nous avions encore à nous avouer. Le trajet n’est pas très long, mais j’ai tout le temps d’imprimer plusieurs pages de ce journal d’angoisse dont les titres sont composés à partir de gros caractères de haine et de désespoir. L’arrêt est comme un entracte, comme la lumière que l’on relâche après une longue projection.
J’ai continué à supporter cette semaine sans comprendre si j’avais envie qu’elle se termine ou s’éternise. Le vendredi suivant est enfin arrivé. Héléna doit être là à vingt et une heures trente- sept, comme d’habitude. Je l’attends, comme jamais je n’ai attendu : parfaitement, scientifiquement même. A moi tout seul, je suis le condensé de tout ce qu’il faudrait savoir à propos de l’attente. Et je conjugue ce verbe à tous les temps de l’impatience. Dans ce combat contre les minutes, tout mon corps et tout ce qui me reste de forces physiques est concentré au centre de mes pupilles. Je sais où je vais la voir apparaître. Je sais de quelle façon elle descendra. J’ai déjà rempli l’espace grisâtre du quai, de l’espoir de sa présence à venir. Lorsque le train est annoncé et entre en gare, j’ai peur de me tromper. J’ai peur.
Je la vois enfin. Ses longs cheveux noirs pendent comme une certitude. Son corps tout entier semble être surligné de soleil. Elle rayonne, comme une promesse, comme un soulagement. Son sourire est violent, il me frappe en plein doute, il me secoue, me relève. Toute ma semaine de noir s’effiloche, s’autodétruit, s’extermine à la vue de ce printemps importé par la S.N.C.F. Elle s’approche de moi depuis une éternité, et déjà je sais que nous allons vivre un week‑end extraordinaire. Elle me parle, je la regarde. Elle me serre, elle m’étouffe et moi je la reconstitue, pièces après pièces. Elle s’excuse. Elle n’a pas écrit parce qu’elle n’avait pas le moral. Son travail, la fatigue… Et elle ne voulait pas m’inquiéter. Je lui dis que ce n’est pas grave, que maintenant elle est là et que nous avons du retard à rattraper.

C’est un soir ordinaire
Vide de beau.
Et toi, homme d’en haut
Tu rêves, tu espères,
Une belle ombre à ton tableau
Sur le quai, tu as posée.
Un peintre de nuit est passé.
Quelques instants il a contemplé.
Un sourire il a taillé,
Pointes de plume il a trempées.
Deux touches de vague
Il a posées.
Sur une lourde tâche de gris,
Deux gouttes qui brillent,
En chantant, il a mélangées.
» Ouvre les yeux, l’ami,
Tout est fini, tu seras heureux ! »
28 janvier

J’avais l’impression que tout était de plus en plus impossible, qu’il y avait un autre moi-même, là-bas. J’étais persuadé qu’il y avait un morceau de mon être pour qui Héléna resterait toujours celle de ce mois de mai où Rémi était parti pour toujours.
Héléna était plus qu’Héléna, elle était en train de devenir un cancer intérieur qui me rongeait. Plus elle était loin, plus elle était floue dans la mémoire de mon miroir et plus je la sentais se rapprocher au fond de moi-même. Elle ne m’habitait plus, elle me minait. Sa présence était si soutenue, si épaisse que les frontières entre mes territoires de douleurs et de bonheurs devenaient de plus en plus imprécises.
Le soir de ce coup de téléphone, je suis sorti. Je voulais savoir si la solitude pouvait continuer à être l’alibi fourni à l’extermination de tous les sourires de mon visage noyé au milieu d’un regard perdu. Une fois de plus je me suis infiltré dans l’un de ces tramways jaunes et une fois de plus, j’ai ressenti les mêmes sensations.
Elles ne sont d’abord que des réactions physiques à l’enfermement et aux vibrations. Puis elles se transforment, deviennent une véritable présence intérieure. Elles sont une partie intégrante de moi-même, elles prennent possession de mes pensées et je me synthétise alors en une espèce de regard vide. Je commence toujours par ressentir une douleur aux tempes qui m’enserre progressivement. Puis mes mâchoires se crispent, les muscles maxillaires s’agitent frénétiquement et la souffrance se fait plus vive. Peu à peu, le reste de mon corps disparaît pour ne plus devenir que l’empaquetage discret et civilisé de cette sensation plurielle dont j’entends de plus en plus distinctement la voix.
Puis il y a le silence, le vide, ou plutôt il y a ce subtil décalage progressif où les voix écoutées finissent par n’être plus qu’entendues. Et, à l’instant même où la sensation parvient au terminus de son parcours, autour de moi, ne subsistent plus que quelques présences orales qui forment, en alternance avec les vibrations du véhicule, une douce mélodie à laquelle je m’habitue de plus en plus.
Il y a quelques heures, Héléna me parlait au creux d’un écouteur gris. A présent je me fabrique une douleur immense, qui m’envoie régulièrement quelques secousses électriques tant les artifices que je déploie pour la rendre vraie me reviennent en pleine mémoire ou en plein espoir.
Déjà publié sur les mots d’Eric, le 10 juin, j’avais envie, ou besoin de vous proposer à nouveau ce texte ce matin….

Ecoute petit homme,
Ecoute.
Il est si beau ce monde qui ne dit rien.
Il est si beau ce monde,
Il te parle, c’est le tien.
Regarde petit homme heureux,
Regarde ces furieux,
Fanatiques, frénétiques,
Ils ont le cœur électrique.
Ils préparent la prière,
Hymne cathodique
Aux rimes numériques,
C’est le matin du malin.
Nuques raides, regards vides,
Les impatients sont livides,
Epuisés, lessivés,
Un long sommeil les a lavés.
Ô Nuit blanche et câline,
Ne t’épuise plus à blanchir
Ces haines rances à mourir.
Semées sur l’écran creux
De leurs rêves sans bleu.
La nuit les a libérés.
Il est l’heure,
Affamés, ils attendent
La victime par eux condamnée.
Leurs mots sont prêts
Ils vibrent, affutés, aiguisés,
Ils vont frapper !
Pas un regard pour ton monde qui sourit.
Ils attendent leurs matins numériques.
Rien ne brille, rien ne bouge.
Hystériques ils cliquent, ils cliquent,
Ils cliquent.
Et ce matin, petit homme,
C’est une claque,
Une claque pour les creux.
Les écrans sont lisses et vides.
Les nouvelles du jour ?
Parties, envolées, manipulées, falsifiées ?
Que va-t-on devenir, on est seul, isolés…
Le monde les voit
Il pleure de cette embolie
Il rit de cette folie
Mais cette nuit, petit homme,
Le monde a agi.
Le monde ne regrette rien
Il le fallait, il l’a fait.
C’est si simple,
Petit homme
La poubelle était pleine,
Le monde l’a vidée,
Et dehors l’a laissée
26 janvier 2020

Cette antichambre du tombeau
Où froissent comme des drapeaux
Les draps glacés par la tempête
Ce tabernacle du plaisir
Avec la porte du désir
Battant sur l´ennui de la fête
Cette horizontale façon
De mettre le cœur à raison
Et le reste dans l´habitude
Et cette pâleur qu´on lui doit
Dès que l´on emmêle nos doigts
Pour la dernière solitude
Le lit
Fait de toile ou de plume
Le lit
Quand le rêve s´allume
Cette maison du rêve clos
Sur le grabat, dans le berceau
Au point du jour ou de Venise
Cette fraternité de nuit
Qui peut assembler dans un lit
L´intelligence et la bêtise
Qu´il soit de paille ou bien de soie
Pour le soldat ou pour le roi
Pour la putain ou la misère
Qu´il soit carré, qu´il soit défait
Qu´importe lorsque l´on y fait
Autre chose que la prière
Le lit
Enfer pavé de roses
Le lit
Quand la mort se repose
Qu´il soit de marbre ou de sapin
Quant au lit qui sera le mien
Dans le néant ou la lumière
Je veux qu´on ne le fasse point
Et qu´on y laisse un petit coin
Pour un ami que j´ai sur Terre
Cet ami que je laisserai
Quand il me faudra dételer
Pour l´aventure ou la poussière
Ce frère de mes longues nuits
Et que l´on appelle l´ennui
Au fond du lit des solitaires
Le lit
Quand s´endort le mystère
Sans bruit
Dans la vie passagère

La boîte aux lettres est vide. Je la regarde sans surprise. Pas même quelques mots, pour me faire croire que la parenthèse du week‑end n’est faite que de pointillés. Goutte à goutte, l’angoisse continue à se déverser. Peu à peu elle devient soupçon. De plus en plus elle ressemble à de la jalousie et ainsi peut revenir à son point de départ.
Derrière mes yeux, Héléna est là. Elle me montre du regard, elle me nargue. Je regarde toujours cette boîte et elle est là à sourire de me voir abattu devant ce vide qu’elle m’a fait parvenir… Je l’entends rire dans l’en dedans de ma chair. Je suis en train, en quelques secondes, de lui fabriquer le week‑end sucré auquel je n’ai pas participé. Je ne contrôle plus les images que je fabrique, je les laisse s’installer, je les laisse soutenir un siège qui risque d’être très long.
Je suis sorti. Héléna est partout. Elle est dans toutes les silhouettes de brunes. Je la vois toujours de dos, avec quelques-uns autres, toujours prêtes à se retourner pour ne pas me sourire. Je décide de l’appeler, de vérifier son existence. Je ne suis même plus tout à fait sûr d’être retourné la voir après la mort de Rémi. En quelques minutes je suis revenu en arrière.
Je suis retourné sur la place du marché. Je suis allé voir si la fenêtre était toujours fermée. Elle m’a donné son numéro au magasin, il y a trois semaines à peine, mais en me recommandant bien de ne l’appeler qu’en cas d’extrême urgence. Je me sens dans un cas d’extrême urgence. Il me faut patienter un long moment avant que le standard ne me la passe. Au creux de mon écouteur je n’entends plus que mon souffle court et j’essaie de discerner quelques indices de vie là où elle se trouve. Elle arrive enfin.
‑ Que se passe-t-il ?
Je la devine un peu affolée. Je lui dis que j’ai seulement envie de lui parler, qu’elle me manque, que sans elle le week‑end a été trop long. Je lui dis que j’attendais une lettre. J’aligne toutes ces banalités, une à une, sans même m’en apercevoir. Elle répond par demi- mots qu’elle empile sur des silences qui me pèsent. Je lui parle de son dernier week‑end et elle me parle du prochain. Je lui demande si elle pense à moi et elle, elle veut savoir quel temps il fait ici… Je lui dis que je l’aime, comme la première fois, elle me répond qu’elle le sait, que je lui manque aussi, que l’inventaire a été long et pénible. Elle me fait clairement comprendre qu’il faut qu’elle retourne travailler. Je l’embrasse et raccroche avec hésitation.
Je regrette déjà de l’avoir appelée. Je ne suis pas rassuré, je suis dans la situation de celui qui ne comprend rien, de celui qui ne peut se résoudre à comprendre que rien ne se passe, que tout est comme avant. Je sens seulement un mur de béton qui se construit lentement autour de moi. On aurait dit que sa voix était fabriquée, qu’Héléna n’était née que pour être au bout du fil de n’importe quel téléphone. On aurait dit que la distance qui nous séparait était un mensonge en face de nos regards qui se devinaient. C’est ce soir-là que j’essayais d’envisager Héléna autrement que brune, autrement que ma brune. J’essayais de la voir dans une autre ville, de l’entendre parler, rêver. Un jour j’irai la voir là‑bas, j’irai voir si elle est la même sous ce fameux soleil provençal. J’irai la voir sans le lui annoncer, pour qu’elle ne soit pas prête, pour qu’elle soit comme elle est toujours, quand elle est sans moi.

Bien sûr, il y a les guerres d’Irlande
Et les peuplades sans musique
Bien sûr, tout ce manque de tendre
Et il n’y a plus d’Amérique
Bien sûr, l’argent n’a pas d’odeur
Mais pas d’odeur vous monte au nez
Bien sûr, on marche sur les fleurs
Mais, mais voir un ami pleurer!Bien sûr, il y a nos défaites
Et puis la mort qui est tout au bout
Nos corps inclinent déjà la tête
Étonnés d’être encore debout
Bien sûr, les femmes infidèles
Et les oiseaux assassinés
Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes
Mais, mais voir un ami pleurer!Bien sûr, ces villes épuisées
Par ces enfants de cinquante ans
Notre impuissance à les aider
Et nos amours qui ont mal aux dents
Bien sûr, le temps qui va trop vite
Ces métro remplis de noyés
La vérité qui nous évite
Mais, mais voir un ami pleurer!Bien sûr, nos miroirs sont intègres
Ni le courage d’être juif
Ni l’élégance d’être nègre
On se croit mèche, on n’est que suif
Et tous ces hommes qui sont nos frères
Tellement qu’on n’est plus étonné
Que, par amour, ils nous lacèrent
Mais, mais voir un ami pleurer!
Je vais publier quelques extraits supplémentaires de ce premier roman écrit il y a quarante ans et retravaillé il y a 25 ans. Nous retrouverons dans ces passages qui se suivent, le narrateur, qui souffre de l’absence de Héléna : elle est partie, assez loin, ils se voient de moins en moins souvent »

C’était la dernière semaine de novembre, un mardi. Ce soir-là, Héléna m’a téléphoné. Simplement pour me dire qu’elle ne pourrait pas venir le prochain week‑end. Il y avait un inventaire à effectuer obligatoirement avant les fêtes de fin d’année. C’est curieux, mais je m’y attendais. Je ne lui ai presque rien dit, je ne l’ai même pas interrogé. J’avais la sensation d’être à nouveau entré dans une des courbes de la spirale qui ne me quittait pas depuis presque deux ans. Je me suis même entendu lui dire que ce n’était pas grave, qu’on en serait d’autant plus heureux de se retrouver la semaine d’après. Elle m’a dit que c’était pas marrant un inventaire, qu’il leur faudrait rester enfermés dans le magasin pendant deux jours. Je ne l’écoutais même plus, j’étais déjà tombé entre les griffes de cette angoisse monstrueuse que je connaissais trop bien. Elle m’a dit quelques mots d’amour auxquels j’ai répondu par quelques soupirs qu’elle ne pouvait entendre.
Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi il faudrait attendre quinze jours de plus. Je m’étais habitué à ce rythme hebdomadaire. Les trois premiers jours de la semaine se vivaient dans l’écho du week‑end, et les deux suivants étaient comme un souffle que l’on retient avant de prendre une nouvelle bouffée d’air frais. Je ne lui en veux pas. Je m’oblige à ne pas voir la situation en noir. Je me dis que je recevrai une lettre, certainement plus longue que d’habitude. Elle remplacera un peu ce week‑end qui nous a été volé.
Je vis cette fin de semaine un peu bizarrement, avec cette boule d’angoisse que j’entends rouler au creux de mon estomac à chacun de mes déplacements. Je n’ai rien fait, je n’ai même pas attendu. J’ai, une fois de plus, eu la sensation de ne vivre qu’une histoire toute simple dont je n’étais que le témoin. Je me sens plus que jamais inscrit dans le provisoire.
Tout n’était finalement que provisoire, son absence, ce silence qui étouffe, ce dimanche si creux, si terriblement « dimanche ». Tout n’est que provisoire, je me sens de passage au milieu de cette histoire dont je distingue de plus en plus les contours de la fin dans l’agonie de ce week‑end.

Souviens-toi passager,
Souviens-toi,
C’est un mardi,
Un petit mardi
Aux bords affaissés.
Tout va si vite,
Tant de terres traversées
Tant de terres séparées…
Souviens-toi,
Derrière la vitre,
C’est un homme qui pleure,
Personne ne le voit.
Chacun est à son clic,
Les larmes ne s’affichent pas.
L’homme regarde le monde,
Les autres ne le voient pas,
Rides sur le front,
Ils habitent le monde numérique.
L’homme pleure le monde perdu,
Son monde frissonne et boite bas.
21 janvier

C’est un lundi frileux
Tu le sens, tu l’entends,
Ton souffle sonne creux.
Tu pousses la porte
Le froid est là, vif et bleu.
Il est prêt et attend.
C’est long une nuit de feu
A se prendre au sérieux.
Il est là, nu et noir brillant,
Il te tend deux bras noueux
Prends un peu de temps et regarde le…

Quand le monde est si bruyant,
Qu’il couvre même le vent,
Quand les regards sont de travers,
Que les yeux se noient dans le triste amer,
N’entre pas dans l’arène !
N’aiguise pas tes lames numériques !
Fais comme tes pères,
Rêve d’Amérique !
Il faut que tu marches jusqu’au bout.
Là-bas, si loin,
Tu verras :
L’île se blottit
Entre les bras bleus de l’océan.
Là-bas, en bord de pluie
Tu verras :
Le doux demain clair
Il t’attend et sourit.
Si tu ne peux pas partir,
Reste tête haute,
Marche jusqu’aux souvenirs.
Prends le chemin le plus malin.
Cours, vole, rêve, espère,
Souris de cet air qui te fouette !
Mais ne laisse pas gagner
La fanfare des maudits.
Laisse-les agiter, vociférer.
Demain tu verras,
Ils seront oubliés.
Toujours dans cette série de portraits, extraits de mon roman « voyage contre la vitre », celui de Marc, le père de Armand…

Marc craignait le passage d’une saison à l’autre. Septembre était de ces mois qui le faisaient hésiter entre mélancolie et espoir. Il n’avait pas de préférences parmi ces quatre périodes météorologiques. A chacune il trouvait du charme.
Ce qu’il redoutait le plus, c’était le passage. Ce moment un peu confus, à la durée inégale, où tout s’emmêle, le hier et le demain, la nostalgie et l’impatience. Il déteste tous ces instants de la vie où l’on ne peut qu’hésiter sur une conduite à tenir. Il appréhende ces séjours en salle d’attente d’aéroport où l’on hésite entre deux dehors : celui d’où on vient et celui où l’on va.
Cette année, il vit la fin de l’été comme une agonie. Il saisit les premiers signes du recroquevillement. Il entend les premières lamentations de toutes les gammes de vert qui sentent monter en eux des effluves de brouillard. L’automne se devine, dès la fin du mois d’août. Il n’est encore qu’une vague silhouette à l’horizon, un « homme qui vient à hauteur des roseaux »… L’automne s’entend, il est dans le vent, plus frais, plus messager de la pluie, qui traverse là‑haut entre les collines fatiguées. Il aperçoit l’été qui recule, qui subit, qui ne combat plus, qui s’économise pour un prochain retour. Les gens sont revenus, ils sont rentrés. Ils sont dans leurs maisons, ils se préparent à attendre ce qu’ils viennent juste de laisser. Tout le monde entre dans sa coquille. Toutes les portes, hier ouvertes aux regards, aux cris, aux chants d’oiseaux, toutes les portes aujourd’hui s’imperméabilisent.
Toujours dans la relecture de mes manuscrits, j’ai déjà publié de nombreux extraits de celui-ci « un voyage contre la vitre », un roman avec de nombreux jeunes personnages, l’un d’eux Armand que nous avons déjà rencontré, est un jeune garçon un peu particulier…

Armand n’aime pas le sport. Armand n’aime pas les émissions pour la jeunesse à la télé. Armand n’invite jamais de copains de son âge à la maison, pas plus qu’il ne se rend chez les autres. Armand ne prend jamais de fous rires. Armand ne se sert jamais une deuxième part de frites. Armand n’aime pas les récréations trop longues et souffre quand il faut aller à la piscine. Armand n’est ni matheux, ni littéraire, il ne préfère et ne déteste ni l’un, ni l’autre. Armand aime apprendre mais il n’aime pas l’école parce qu’on passe trop de temps à répéter les mêmes choses et surtout à apprendre ce qu’il ne faut pas savoir. Armand aime parler avec son père, rire avec sa mère. Armand n’aime pas poser des questions inutiles et répugne encore plus qu’on lui en pose des stupides : »qu’est ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand ? » Armand aime quand il pleut, et préfère contempler un vieux remorqueur rouillé plutôt qu’un hors‑bord flambant neuf. Armand, c’est un peu tout cela, c’est aussi tout ce que Marc ne sait pas et ne veut pas savoir.
Je range, je fouille, j’ouvre de vieux cahiers et tombe parfois sur des bouts, sur des essais, parfois maladroits, un peu emphatiques, mais je suis indulgent avec celui qui écrivait il y a quarante ans. Je cherche les traces, dans les mémoires du papier…

C’était une journée d’automne qui se terminait par petites flaques, sur le pavé gluant. Plus rien n’avait l’odeur du neuf. Dans chaque grain de poussière, dans chaque molécule de vie, un parfum de moisissure tirait des larmes aux passants du soir. Dans les yeux de ceux qui se croisaient, il y avait cette lueur de désespoir, si vraie, si dure, si fatidique, si irréversible. Comme si…
Comme si la destinée de chacun était contenue dans ce bruit, sourd et continu, bruit qui m’arrache encore des larmes tant il est dur de se sentir glisser sur des pentes où l’amour n’existe plus que par pointillés jaunâtres. Le ronflement de l’alentour produisait comme un halo de brouillard, mais il m’étouffait plus que n’importe quel autre, il m’étouffait en dedans, il me bouffait mon printemps qui à cette heure-ci n’était pourtant encore qu’inscrit en marge, en attente de frénésie, en attente d’irréel…

Dans la mémoire des arbres couchés,
J’entends des rêves de papier.
J’aime le bois
Ma main se pose,
Rêche et sèche,
Craque l’écorce.
Une à une,
Bûches blondes sont empilées
Elles sonnent,
Elles claquent,
Trouvent une place
Je ferme les yeux.
J’aime le bois
Aux belles odeurs de pain frais .

Des visages creux qui jouent la ressemblance
Sur un air de chaîne à la peur accrochée
Quand je suis ici je voudrais être ailleurs
Parce que je ne vis plus
J’imagine
Si je tombe dans un trou je veux qu’il soit profond
Parce que je ne veux pas vivre au sol
Cloué pour la vie
Février 1981
De temps je replonge dans la lecture, d’un de mes romans que je retravaillerai peut-être, pour le proposer à la publication. Je vous propose ce nouvel extrait, où nous retrouvons Jules qui s’interroge sur le temps…

Le temps : chaque fois qu’il dit ce mot Jules hésite, c’est si complexe un mot comme celui-ci, un mot qui va avec les nuages, le soleil, les pendules, un mot qui accompagne la pluie et les rides, un mot qui ne va jamais seul, toujours à s’adjoindre des adjectifs météorologiques, toujours à accompagner des verbes pour vieillir, des verbes pour mourir. Jules est persuadé que ce n’est pas un hasard que le mot soit le même pour désigner la vie qui fait mal quand elle passe et le ciel qui s’agite chaque matin. Lui, il sait que le temps, quand il est à l’orage, quand il est mauvais ça lui trouble son temps à vieillir, son temps machine à fabriquer des secondes pour ajouter à sa série. Il sait, mais il ne peut pas expliquer et encore moins comprendre.
Alors il ne dit rien Jules. Et il fait des choses que personne ne pourrait comprendre parce qu’elles semblent inutiles, les autres ils aiment quand c’est rentable, quand on peut raconter aux autres ce qu’on a vu, entendu et compris.
Parfois Jules il regarde les autres qui dorment. Et il aime ça Jules les autres qui dorment, surtout quand il s’agit d’une fille. Quand il trouve une fille, quand elle accepte parfois d’aller dans un lit avec lui, il attend le moment où il la verra dormir. Il est persuadé qu’alors il se passera quelque chose, qu’il n’en sera pas exclu. Il en a passé des mi- nuits à observer, à attendre le sommeil de quelques belles, jusqu’à espérer qu’il se passe quelque chose, un malaise, un questionnement. Parfois ça marche, mais souvent rien, comme une bête à contempler, étendue de chair, inerte, à peine soulevée d’une inspiration.
Une nuit, c’était en Juillet, il a vu. Elle n’était pas belle comme les autres, elle n’était pas celle dont les chasseurs de femme aiment à se vanter, elle n’était pas celle qu’on couche sur papier glacé pour montrer aux légionnaires de passage. Elle n’était pas belle, elle était autre, il n’y avait rien à dire de son corps, de cette enveloppe à laquelle on passe tant d’énergie, c’était un corps en attente d’amour. Elle était de celle qu’on ne drague pas parce que ce mot est mécanique, qu’il ressemble trop à racler, elle était de celle avec qui on vit dès qu’on la rencontre. Une histoire, une force, une beauté qui ne perd pas de temps à utiliser de mots.
Il l’avait rencontrée sortant d’une pharmacie, les larmes aux yeux. Leurs regards s’étaient arrêtés, avaient abandonné les nuisances environnantes. Elle pleurait, il le voyait, il savait déjà et elle l’écoutait lui dire qu’elle était triste et qu’elle ne s’en cacherait pas. Il faisait lourd, elle était triste.
Elle était triste, il ne saurait jamais pourquoi, c’était une histoire de l’ailleurs, en dehors d’eux et il l’aimait déjà avec sa douleur. Il lui avait effleuré la joue du revers de la main, comme pour sécher ses larmes, elle avait penché la tête dans un geste de merci. Il lui avait proposé un verre, une menthe fraîche, bleue pour que ça frissonne dans le corps. Il lui avait parlé de cette journée qui s’étouffait dans une fin d’après-midi ridicule, lui avait dit qu’aujourd’hui était effaçable jusqu’à cet instant où il l’avait vue, comme une tâche de vrai sur le convenu de l’été.


La musique souvent me prend comme une mer !
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,
Je mets à la voile ;
La poitrine en avant et les poumons gonflés
Comme de la toile,
J’escalade le dos des flots amoncelés
Que la nuit me voile ;
Je sens vibrer en moi toutes les passions
D’un vaisseau qui souffre ;
Le bon vent, la tempête et ses convulsions
Sur l’immense gouffre
Me bercent. D’autres fois, calme plat, grand miroir
De mon désespoir !
Je continue de fouiller mes archives et là, j’ai trouvé ce petit texte sur une feuille volante, écrit à la plume, je pense qu’il date de 1979…

C’est le soir comme tous les jours
Un homme se meurt
Ou il périt noyé dans l’océan
De tortures
Un homme aime
Ou il pleure sur sa compagne
Finale
Point à la ligne
Un homme naît
Ou il crie parce qu’il ne connait
Personne
Pas même en rêve
Un homme tue
Ou triche contre ses règles
Très propre
Bien baptisé
Un homme hurle
Il a peur
Alors il écrit
Tout droit
Au cœur
Peut-être

Figé sur le quai,
Raide,bougon,
Je conjugue l’attente
A tous mes temps d’impatience.
Pressé, fripon,
Le présent me tente,
Dodu, rond
Il est presque parfait,
Las, long,
Mon temps est passé.
Sans câlins, ni chansons
J’ai vendu le futur
A un trousseur de wagons
16 janvier 19 h 49

Dans mon placard à rêves heureux,
Sous une pile de linge bleu,
J’ai trouvé deux vieilles feuilles blanches.
Tendres et belles,
A l’automne, endormies,
Sur leurs peaux pas un pli.
Doucement je les ai libérées.
Dans l’armoire au parfum ciré,
Elles se sont étirées.
Chantent les mots ronds,
Dansent les points pour les i,
Sur feuilles qui pétillent,
C’est une symphonie.
Petit nuage de poussière,
Deux moineaux étonnés
Sur une branche se sont posées
16 janvier

Petit homme a pris ses crayons,
Dans sa boîte à couleurs
Il choisit du blanc, le bleu, du gris…
Feuille blanche pâlit d’ennui.
Froissée, elle en gémit,
Il manque un ami.
Feuille le dit :
Le rouge est là !
Petit homme n’oublie pas…
Petit homme entend,
Les belles plumes a taillées,
Au creux du vent les a trempées.
Ses voiles de papier il a hissées.
La fenêtre il a ouvert…
Oh petit homme,
Le peintre est passé…
15 janvier

C’est dit, c’est décidé, il le faut, vous le voulez, vous devez parler ! Oui c’est cela, pas de doute, il faut que vous vous exprimiez, vous le ressentez. C’est très fort, presque un réflexe. Il faut que cela sorte ! C’est bien, c’est normal… Mais attention au mauvais réflexe ! Il peut conduire à une fausse route…
Voici donc quelques conseils.
Avant tout, il faut que vous respiriez, que vous ressentiez, que vous réfléchissiez. Ceci fait, vous descendrez tranquillement dans votre réserve à mots. Vous seul connaissez le chemin qui y conduit. Et là, attention, vous entrez sans frapper ! Pas de cris, pas de brusque lumière. Un mot qu’on surprend est un mot qui bondit, qui rugit. Un réveil brutal et il vous saute à la gorge.
Finies les courbes qui ondulent, oubliées les rondes voyelles. Le mot mal choisi est aigre, et coupant.
Entrez, éveillez chacun avec le ton qui lui convient. Et surtout, surtout, pensez à ce que vous vouliez dire, à ce que vous souhaiteriez partager. Attention, il ne faut pas vous précipiter. Comparez, et si vous le pouvez : goûtez ! Il faut que l’accord soit parfait.
Votre casier à mots ainsi garni de bons et beaux mots, refermez (toujours sans claquer la porte ), remontez, et bien sûr dégustez.
En hommage à la brume, un de mes thèmes favoris, un poème d’un de mes maîtres, pas le plus connu, mais tellement beau

Quand la lune apparaît dans la brume des plaines,
Quand l’ombre émue a l’air de retrouver la voix,
Lorsque le soir emplit de frissons et d’haleines
Les pâles ténèbres des bois,
Quand le boeuf rentre avec sa clochette sonore,
Pareil au vieux poëte, accablé, triste et beau,
Dont la pensée au fond de l’ombre tinte encore
Devant la porte du tombeau ;
Si tu veux, nous irons errer dans les vallées,
Nous marcherons dans l’herbe à pas silencieux,
Et nous regarderons les voûtes étoilées.
C’est dans les champs qu’on voit les cieux.
Nous nous promènerons dans les campagnes vertes ;
Nous pencherons, pleurant ce qui s’évanouit,
Nos âmes ici-bas par le malheur ouvertes
Sur les fleurs qui s’ouvrent la nuit !
Nous parlerons tout bas des choses infinies.
Tout est grand, tout est doux, quoique tout soit obscur.
Nous ouvrirons nos coeurs aux sombres harmonies
Qui tombent du profond azur.
C’est l’heure où l’astre brille, où rayonnent les femmes.
Ta beauté vague et pâle éblouira mes yeux.
Rêveurs, nous mêlerons le trouble de nos âmes
A la sérénité des cieux.
La calme et sombre nuit ne fait qu’une prière
De toutes les rumeurs de la nuit et du jour ;
Nous, de tous les tourments de cette vie amère
Nous ne ferons que de l’amour !

Au bord du soir grisant,
J’ai l’amer qui me remonte.
Vite,
Il est encore temps.
Ne pas finir pendu au clou
D’un jour lourd aux angles coupants.
Soudain, un besoin d’océan
Envie de souffles,
Soif de vents,
Je ferme les yeux…
Derrière la vitre de mes mémoires salées
J’entends la longue plainte de l’océan…
14 janvier

Au matin qui s’ennuie,
Fleuve ne frissonne plus,
Sans un flot, lisse et nu
Fleuve entre dans la ville.
Si loin le chant de la source,
Si loin la caresse blanche
De l’eau claire qui jaillit.
Tout est oublié,
Fleuve se laisse aller,
Entre deux rives rêches
Sa mémoire de brume mauve,
Il a abandonné.

C’est un soir ordinaire,
Longue pluie du jour
A laissé quelques flaques qui luisent
Pâle et timide
Une nuit d’ailleurs
Ecarte large ses maigres bras
Elle vient de si loin.
Intimidée
Elle hésite à entrer.
On l’oublie, elle le sait
Et ne veut pas déranger,
De son pas noir et léger
Nuit avance sur la pointe des pieds.
Il est tard,
Ville qui brille
Avale ma nuit .
13 janvier 22 h 16
Un peu en panne sèche, je reviens avec ce court texte, inspiré par la douleur que je ressens quand je commets l’erreur de passer un peu trop de temps sur les réseaux sociaux, fossoyeurs des mots, de mes mots….

Monde bleu s’est effacé
Au soir tombant
Tremblant, il a reculé.
Tête basse,
Dans un long bout de vide
Seul et triste
Il s’est retiré
Entends la plainte de monde bleu,
Quelques larmes
Sur ses rides ont coulé
Entends-le qui appelle :
Oh mots, oh mes mots
Vous m’avez abandonné…
Oh mots, oh mes mots,
Que vous a-t-on fait,
Qui vous a sali,
Que vous a-t-on promis ?
Homme sans haine,
Tu es seul aussi,
Réponds à monde bleu,
Dis-lui que tu viens,
Dis-lui que tu résistes,
Dis lui…
13 janvier
En hommage à un autre Léo, qui vient d’entrer dans le monde, ce magnifique texte d’un autre Léo…

Je vois le monde un peu comme on voit l’incroyable
L’incroyable c’est ça c’est ce qu’on ne voit pas
Des fleurs dans des crayons Debussy sur le sable
A Saint-Aubin-sur-Mer que je ne connais pas
Les filles dans du fer au fond de l’habitude
Et des mineurs creusant dans leur ventre tout chaud
Des soutiens-gorge aux chats des patrons dans le Sud
A marner pour les ouvriers de chez Renault
Moi je vis donc ailleurs dans la dimension quatre
Avec la Bande dessinée chez mc 2
Je suis Demain je suis le chêne et je suis l’âtre
Viens chez moi mon amour viens chez moi y a du feu
Je vole pour la peau sur l’aire des misères
Je suis un vieux Bœing de l’an quatre-vingt-neuf
Je pars la fleur aux dents pour la dernière guerre
Ma machine à écrire a un complet tout neuf
Je vois la stéréo dans l’œil d’une petite
Des pianos sur des ventres de fille à Paris
Un chimpanzé glacé qui chante ma musique
Avec moi doucement et toi tu n’as rien dit
Tu ne dis jamais rien tu ne dis jamais rien
Tu pleures quelquefois comme pleurent les bêtes
Sans savoir le pourquoi et qui ne disent rien
Comme toi, l’œil ailleurs, à me faire la fête
Dans ton ventre désert je vois des multitudes
Je suis Demain C’est Toi mon demain de ma vie
Je vois des fiancés perdus qui se dénudent
Au velours de ta voix qui passe sur la nuit
Je vois des odeurs tièdes sur des pavés de songe
A Paris quand je suis allongé dans son lit
A voir passer sur moi des filles et des éponges
Qui sanglotent du suc de l’âge de folie
Moi je vis donc ailleurs dans la dimension ixe
Avec la bande dessinée chez un ami
Je suis Jamais je suis Toujours et je suis l’Ixe
De la formule de l’amour et de l’ennui
Je vois des tramways bleus sur des rails d’enfants tristes
Des paravents chinois devant le vent du nord
Des objets sans objet des fenêtres d’artistes
D’où sortent le soleil le génie et la mort
Attends, je vois tout près une étoile orpheline
Qui vient dans ta maison pour te parler de moi
Je la connais depuis longtemps c’est ma voisine
Mais sa lumière est illusoire comme moi
Et tu ne me dis rien tu ne dis jamais rien
Mais tu luis dans mon cœur comme luit cette étoile
Avec ses feux perdus dans des lointains chemins
Tu ne dis jamais rien comme font les étoiles
Ce soir je suis grand-père pour la troisième fois…Je ne pouvais pas, ne pas lui offrir quelques mots…

Bienvenue petit homme,
Bienvenue !
On est là,
On attend !
Le coffre à sourires est plein à craquer…
Elle est belle la vie,
Si belle, tu sais.
Tu verras elle brille déjà pour toi.
Ecoute petit homme
Écoute ces rires d’enfants,
Ils chantent ton arrivée.
Écoute…
Tes sœurs seront bientôt là
Roule, roule, bonheur
Petit homme est là…
10 janvier 2020

Dans le bout de nuit
Qu’il te reste à inventer,
Tu te cognes aux angles secs
D’ombres épaisses.
Elles avalent le son de feutre
De ton pas glissant.
Pas un chant, pas un souffle,
C’est le matin qui siffle.
Le silence est lourd
Des mots doux qu’il retient ;
Il traîne avec lui
Des restes de rêves,
Images brèves d’un monde enfoui
Au fond du ciel sombre
D’une mémoire endormie.
Tu avances, à tâtons,
Ta main se pose,
Longue caresse,
Sur la peau de papier.
Ton cahier est là,
Il est seul,
Sourires
Il attend.
10 janvier
5 janvier 2015, 5 janvier 2020 : en hommage aux victimes de la barbarie

Dans l’hiver bleu
De ta mémoire encombrée
N’oublie pas
Les lourdes traces
Que la haine a laissées.
Dans les flammes ocres
De tes souvenirs douloureux
N’oublie pas
Les douces braises
Que l’humanité a attisées.
Sur la route mauve
De ta liberté écartelée
N’oublie pas
Les regards effarés
Des plumes qui se sont envolées…
7 janvier 2020
Cela fait bien longtemps que nous n’avons retrouvé Jules, Jules qui retrouve Lisa quand il s’endort… Un nouvel extrait de ce roman que j’ai tant aimé écrire…

Jules se souvient de tous ces lendemains qu’il attendait, avec l’espoir qu’ils signifient autre chose qu’un jour qui commence. Il se souvient de toutes ces femmes qui l’ont quitté sans l’avoir accepté, sans avoir compris ce qui pourrait les retenir. Toutes ces femmes qui ne comprennent pas l’orage, qui se ferment aux premiers grondements et lui qui s’ouvre, qui attend que le premier éclair frappe.
Aujourd’hui il n’a pas de mémoire, il a bien plus, il a Lisa. Elle est là quelque part, il ne se souvient pas mais sait qu’elle existe. Elle est derrière un de ces murs auxquels il se heurte toutes les nuits quand il cherche le passage.
Lisa, elle n’existe pas, elle est une ombre qui attend que son soleil la rappelle. Lisa comme une ombre de midi, quand il fait si chaud qu’on économise le moindre geste, pour faire des réserves quand le soleil nous laisse enfin en paix.
C’est avec elle que tout a commencé. C’est avec elle qu’il a connu son premier orage. Il a un fragment d’elle au fond de lui. Il le lui a pris il y a longtemps. Il se souvient, quand il s’endort, quand le temps est lourd, quand les corps sont moites, elle est là, il l’entend, elle s’approche. Ça fait comme une pluie légère, une pluie timide qui hésite à fabriquer de la flaque. Il ferme les yeux et le noir de derrière est adouci par les couleurs qui entrent, des couleurs qui le caressent, qui lui disent de s’endormir. Quand il s’assoupit, quand il a enfin trouvé le passage, qu’il sait être arrivé au pied du dernier mur, il entend le bruit de cette mécanique, une machine qui rugit, une voix d’homme qui s’éloigne.
Et puis quand il s’enfonce encore plus profond, dans le sommeil, c’est une voix frêle, douce comme une litanie qui lui caresse les tempes. C’est une voix qui tremble, qui pleure, qui appelle.
Jules en a marre de ces épuisants voyages nocturnes. Ils se terminent toujours au même endroit, c’est un lieu gris, il le sait, il le sent, mais le matin c’est fini, il n’y a plus rien, il est seul. Il faudrait qu’il en parle, il faudrait qu’il raconte, qu’on lui tienne la main un soir d’orage. Il faudrait que tout cela cesse, il faudrait qu’il puisse vivre comme les autres.
Jules est comme dans un rêve. Il y a tout à l’heure, ce qui s’est passé, il se souvient. Et Jules doute. Et là, il est seul à se poser les mêmes questions, celles de l’existence, celles du vrai auquel on croit si fort parce que les autres en font partie. Mais Jules il doute de plus en plus. Depuis qu’il est né il y a ces moments où rien ne fonctionne. Il doute, il ne sait pas si c’est lui qui est déréglé ou si c’est les autres. Il a cette sensation très pénible de vivre une autre histoire de la regarder de l’extérieur avec les yeux d’un témoin.
Il est un zappé, il est un écran sur lequel les autres, font défiler une suite d’histoires qui ne le concernent pas. Il passe de l’un à l’autre et quand on le rejette lorsqu’il comprend qu’il est un inconnu il ne se met plus en colère et n’est même plus surpris. Il a fini par s’habituer, par se dire que la vie c’est ça, ce zapping, ce passage d’un monde à l’autre. Il est comme un acteur qui passe d’un personnage à l’autre. A chaque fois il se sent bien, c’est nouveau, le regard des autres lui permet d’exister au moins pour un court instant. Et puis il faut passer à autre chose, un autre rôle.
Il se dit aussi que l’existence c’est peut-être mieux ainsi, une addition, une accumulation hétéroclite de petits bouts, de tranches de vie. Sa seule erreur est de s’attacher de trop vouloir en profiter, jusqu’au bout même quand le rideau est baissé.

Homme marche en riant,
Deux trois miettes de nuit
Attendent au silence montant.
Sur le chemin, Homme est arrêté.
En plein vol, un mot a attrapé.
Sur les lignes de sa main,
Doucement l’a posé.
Toute la journée,
Homme a poli,
Homme a aimé
Mot rond aux lettres repliées.
Quand le soir est arrivé,
Souriant, Homme l’a libéré.
Mot doux s’est envolé.
Il chantait, il dansait, il planait.
Si gai, dans l’air léger,
Sur un fil d’encre bleue,
En sifflant il s’est posé.
Homme est reparti
Et dans le soir fredonnant,
J’ai trempé ma plume
Dans la lumière de ses yeux.
4 janvier 2020

Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ?
0 bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un cœur qui s’ennuie
0 le chant de la pluie !
Il pleure sans raison
Dans ce cœur qui écœure.
Quoi ! nulle trahison ? …
Ce deuil est sans raison.
C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon cœur a tant de peine!

La foule l’avait condamné à mourir
Parce qu’il avait tué
Une des brebis
De leur troupeau d’indifférence
Ils aimaient la vie…
Le dimanche en voiture
Dans un cortège funèbre
Qu’ils vénéraient
Parce qu’ils avaient pour jumeau
Ce pays FRANCE
Ils poussaient dans ce jardin
Où les mauvaises herbes
Meurent au napalm
A la balle perdue
Où à la torture cachée
Ils ignoraient que le lendemain
Peut être celui du je t’aime
Pour eux
Il était celui du rêve électrisé
Qu’ils croyaient avoir eu
Ils faisaient l’amour
Comme on achète le journal
Bonjour
Merci
Il fait beau
C’est tout
Ils disent aimer un enfant
Parce qu’à Noël
Ils le font légionnaire
Ou infirmière
Parce qu’il le brûle
Sur une plage quand vient l’été
Institutionnelle
Ils le grille
Côté face, côté pile
Côté cœur
Ils ont peur
Ils ont du fric
Ils ont peur
Ils ont le flic
Et toi t’es mort
Pour eux…
Mai 1979



Comme vous le savez, certains de mes écrits participent aux différents concours organisés par le site Short Edition, parmi eux, la micro nouvelle « il manquait un voyageur » rencontre un succès auquel je ne m’attendais pas… Je suis désormais classé à la 12 ème place et je peux encore monter dans le classement. Si le cœur vous en dit et si vous avez envie de soutenir ce texte je vous invite à vous rendre sur le site et à voter : https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/il-manquait-un-voyageur-1

J’ai cherché un souffle d’inspiration
Au fond de mes poches de brume
Trois mots ronds y dormaient.
Entre mes doigts plumes,
Je les ais éveillés.
Dans la lumière bleue d’un souvenir d’été
Ils se sont envolés.
Doucement sur le chemin
Ont posé une, puis deux,
Belles lettres
Timbrées de belle rosée.
Ecoute la poésie du matin,
Petite musique qui revient.
2 janvier 2020

Que notre année soit belle,
Douce, inspirante…

En cette fin de semaine très chargée, le tribunal académique doit juger un cas très particulier. Il s’agit d’une affaire dont on peut dire qu’elle est un peu trouble. C’est, en effet, sur la base de délations, par le biais de lettres anonymes, que la cour, après une rapide instruction, rend son jugement.
Nous sommes en fin de journée, la lumière a baissé. On distingue à peine le ou la prévenue dans le box des accusés.
Le président du tribunal est gêné : il sait que la salle peut réagir et faire de lui, pour quelques instants, le bouffon qu’il n’est pas. Tant pis, il n’a pas le choix. Il s’éclaircit la gorge et lance le tant attendu : « brume levez-vous ! »
Dans l’assistance, monte un léger murmure et quelques toussotements…
« Brume redressez-vous je vous prie, que les jurés puissent vous distinguer… »
Brume souffre. La lumière blafarde des néons est lourde. Brume a du mal à rester droite et debout et- convenons-en- se tient à la barre, un peu affalée.
« Brume cessez de vous répandre et restez concentrée sur ce que j’ai à vous dire ! »
« Brume, vous comparaissez aujourd’hui devant ce tribunal académique car vous êtes accusée du crime de haute trahison, et pire, d’intelligence avec l’ennemi. En effet, si je m’en tiens aux déclarations faites sous serment, vous avez été vue, ou plutôt aperçue, ces derniers mois, en présence de l’ennemi, et pire, en compagnie des forces de l’étrange.
Le président tient l’acte d’accusation entre ses mains tremblantes. La brume est toujours levée, le regard un peu dans le vide. Elle attend, les yeux dans le vague, d’apprendre ce qui lui est reproché.
« Le 8 mars, vous avez été surprise, au lever du jour, en compagnie de l’armée des mauves. Les témoins parlent, je les cite, d’une belle lumière apaisante… »
« Le 13 juin, vous avez déserté le fleuve auquel l’académie vous a attachée et ce pour vous rendre sans autorisation au sommet d’une verte colline. Les témoins parlent d’une, je cite : magnifique couronne cotonneuse… »
« Le 15 juillet, vous avez été aperçue, en fin de journée, à l’heure où tous les chats sont gris, à proximité d’une fête champêtre. Je cite les témoins : « avec la musique et les lumières, cette douce brume d’été nous a remplis de joie, et même d’allégresse »
« A plusieurs reprises, à l’automne finissant, vous avez choisi de vous adjoindre comme compagnons de phrases, sans leurs consentements il va sans dire, les mots légère, douce, bleutée et avez délibérément abandonné épaisse, grise et obscure. C’est grâce au courage civique d’un gardien de la langue que vous avez été confondue et stoppée dans votre entreprise de déstabilisation d’une longue série de mots qui sont en dehors de vos frontières.
En conséquence et après délibération avec le jury et en application de l’article R 233-12 du code de procédure matinale, vous êtes condamnée à une éternité de travaux foncés.
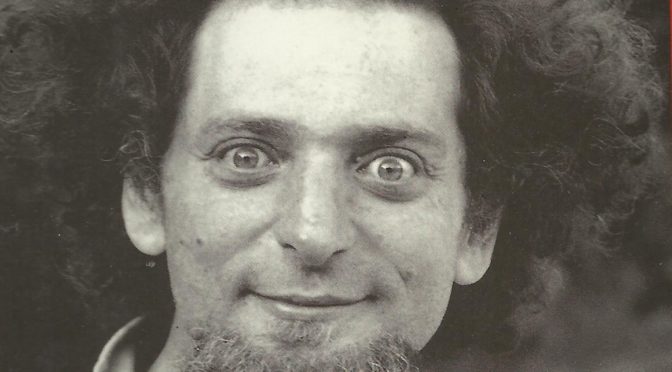
« J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés ; des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources.
[…] De tels lieux n’existent pas, et c’est parce qu’ils n’existent pas que l’espace devient question, cesse d’être une évidence, cesse d’être incorporé, cesse d’être approprié. L’espace est un doute : il faut sans cesse le marquer, le désigner ; il n’est jamais à moi, il ne m’est jamais donné, il faut que j’en fasse la conquête.
Mes espaces sont fragiles : le temps va les user, va les détruire : rien ne ressemblera plus à ce qui était, mes souvenirs me trahiront, l’oubli s’infiltrera dans ma mémoire, je regarderai sans les reconnaître quelques photos jaunies aux bords tout cassés. Il n’y aura plus écrit en lettres de porcelaine blanche collées en arc de cercle sur la glace du petit café de la rue Coquillière : « Ici, on consulte le Bottin » et « Casse-croûte à toute heure ».
L’espace fond comme le sable coule entre les doigts. Le temps l’emporte et ne m’en laisse que des lambeaux informes :
Écrire : essayer méticuleusement de retenir quelque chose : arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser, quelque part, un sillon, une trace, une marque ou quelques signes. »
J’ai longtemps hésité avant de publier ce texte, retrouvé dans mes poèmes de jeunesse, c’est l’un des plus vieux encore en vie. Et puis finalement depuis que j’assiste aux séances du tribunal académique, je me dis qu’il peut passer….

Qu’un jour l’automne
Saison des romantiques de musée
Se déclare aussi puant que le printemps
Qu’un jour les violons
Qui hurlent de chagrin
Se foutent de notre gueule
Qu’un jour au moins
La rose dise qu’elle en marre
D’être cueillie pour la fille qu’on espère,
Qu’un jour la nuit
Rote à la gueule des esprits crotteux
Qu’un jour la colombe
Pisse contre les barreaux du prisonnier
Qu’un jour les mots arrêtent de s’épouser
Sans leurs consentements
Q’un jour on cesse de tricher
Qu’un jour on oublie la morale des vers
Qu’un jour on oublie Victor, Charles, Paul
Et les autres
Q’un jour on se regarde
Q’un jour on se le dise
Ou qu’on l’écrive
Alors on sera poète
Février 1979

L’homme est heureux,
Il le dit, il le rit.
Autour de lui,
Pas un œil qui ne luit.
L’homme est heureux
Son cœur bat pour deux
« Je vais marcher,
Il le faut, c’est si beau. »
« Je vais marcher,
Et lèverais les yeux. »
L’homme inspire,
L’air est si frais,
L’homme s’emplit de vrai…
Il faut attendre lui dit-on
L’heure n’est pas aux rêves creux ;
Il faut entendre le souffle fatigué
D’un bleu délavé, lessivé
Par la basse marée.
L’homme n’écoute pas,
L’homme est heureux.
27 décembre

Rêver un impossible rêve
Porter le chagrin des départs
Brûler d’une possible fièvre
Partir où personne ne part
Aimer jusqu’à la déchirure
Aimer, même trop, même mal,
Tenter, sans force et sans armure,
D’atteindre l’inaccessible étoile
Telle est ma quête,
Suivre l’étoile
Peu m’importent mes chances
Peu m’importe le temps
Ou ma désespérance
Et puis lutter toujours
Sans questions ni repos
Se damner
Pour l’or d’un mot d’amour
Je ne sais si je serai ce héros
Mais mon cœur serait tranquille
Et les villes s’éclabousseraient de bleu
Parce qu’un malheureux
Brûle encore, bien qu’ayant tout brûlé
Brûle encore, même trop, même mal
Pour atteindre à s’en écarteler
Pour atteindre l’inaccessible étoile.

Ce matin le tribunal académique est bondé. On y juge le gris. Enfin, quand je dis on juge le gris, il conviendrait peut-être plus de dire on juge gris…
Le juge de permanence est d’une humeur massacrante. La veille il a dû participer à une reconstitution un peu pénible, il s’agissait de la scène du crime commis par l’automne au printemps dernier.
Il doit lire l’acte d’accusation mais comme à l’accoutumée il lui faut d’abord rappeler à la cour l’identité du prévenu.
« Gris levez-vous ! »
« On dit de vous dans le compte rendu de l’instruction que vous affirmez être un adjectif mais qu’il vous arrive régulièrement de prétendre être un nom commun. C’est évidemment votre droit et je ne reviendrai pas là-dessus, mais qu’il me soit permis, eu égard à ce qui vous est reproché, de regretter cette autorisation que la loi grammaticale vous octroie… »
Gris, dans le box des accusés accuse le coup, mais ne dit rien, il semblerait même qu’il ait pâli.
Le juge poursuit.
« Gris, vous comparaissez devant ce tribunal car vous êtes accusé d’escroquerie et de tromperie. En effet, à plusieurs reprises vous avez été vu, plusieurs témoignages le confirment, en compagnie de rouge, de jaune, de vert et même de bleu et vous vous êtes étalé au point d’occuper toute la place. Je lis dans l’acte d’accusation qu’à plusieurs reprises ceux qui regardaient se seraient exclamés je cite : « oh que c’est beau ! ».
Gris baisse les yeux. Le juge continue sa lecture.
« Deuxième délit, et non des moindres, vous vous êtes introduit par effraction, et ce à plusieurs reprises, dans de nombreuses poésies et avez pris une place qui ne vous revenait pas, au point même d’obliger l’auteur à chercher des rimes en ris, et la cour doit le savoir mais lorsqu’on cherche à rimer avec le gris, on finit toujours par dire que c’est un mot qui sourit. »
« En conséquence et après en avoir délibéré, la cour vous condamne à rester définitivement entre le blanc et le noir et vous interdit à compter de ce jour de vous produire dans quelque tenue que ce soit lors des couchers de soleil »
« Garde veuillez accompagner le prévenu ! »
Finalement, ce ne sera qu’en trois parties… Je me suis levé très tôt ce matin et j’en ai profité pour terminer de mettre au propre le manuscrit

Les réponses viennent, faciles. A chacun d’entre elles le puzzle se reconstitue…Dans la voiture, ça s’est passé comment, elle vous a parlé ?
Camille regarde toujours son frère quand elle répond, comme pour vérifier, se rassurer.
Les inspecteurs en avaient assez entendu et ils s’apprêtaient à les libérer pour qu’ils puissent aller jouer lorsque Camile s’est souvenu d’un détail.
C’est Denis qui n’a rien dit jusque là qui ajoute cette information, essentielle. Les inspecteurs se regardent avec le sourire.
Les enfant sortis, les inspecteurs ont rappelé Mr Malouin.
Monsieur Malouin a les larmes aux yeux et la voix complétement nouée.
En début de soirée Melle Lemoine fut arrêtée. Elle était sur le point de se jeter dans le vide, elle était sur le parapet d’un pont à quelques centaines de mètres de chez elle. Cela faisait plus de trente ans qu’elle vivait avec sa sœur, elles ne s’étaient jamais quittées. Tous les soirs, elle l’attendait. Sa grande joie était de lui préparer de succulents repas. Puis elles parlaient, se racontaient leurs journées dans les menus détails. Ce soir-là, quand Danielle en rentrant de l’école lui apprit qu’elle allait partir, qu’elle avait rencontré quelqu’un, le directeur de l’école, Hélène ne répondit pas. Le repas s’était terminé dans un silence trouble. Puis chacune d’elle s’était couchée sans embrasser l’autre, et sans se dire le moindre mot. Ce n’était pas dans les habitudes de la maison Lemoine…
Aux alentours d’une heure du matin, Hélène s’était levée et avait étouffée Danielle dans son sommeil avec l’oreiller. C’est au petit matin qu’elle avait décidé de devenir Melle Lemoine l’institutrice. Elle s’occuperait du corps le soir après la classe. Le crime sera parfait. Le crime sera parfait. Personne ne la connaissait, elle ne sortait presque jamais, ni seule, ni même avec sa sœur adorée. Et la ressemblance était si frappante. Si frappante. Et puis comme Danielle lui raconte tout avec plein de détails elle a l’impression de connaître tous les enfants.
Elle n’avait commis qu’une seule erreur, celle de croire que sa sœur lui vouait un amour infini et indestructible. En fait elle n’en pouvait plus de ce double qui lui pesait de plus en plus. Juste avant de rentrer chez elle, la veille au soir, Danielle Lemoine était passée par la poste, elle avait envoyée une lettre en recommandée, « très urgente » avait-elle dit au guichet, « il faut absolument qu’elle parvienne au commissariat demain dans la journée ».
Dans cette lettre, elle avouait le crime de sa propre sœur Hélène, elle n’en pouvait plus et préférait la prison qui ne durerait qu’un temps à l’enfer de cette vie qu’Hélène lui imposait. Et en sortant elle pourrait retrouver Mr Malouin. S’il l’aimait tant, il l’attendrait.
Ce soir-là après avoir été appréhendée par la police juste avant de se jeter du haut du pont, Hélène Lemoine passa sa première nuit en prison, mais sur la porte de la cellule, on pouvait lire : « Danielle Lemoine ».
Demain dans la journée le tribunal académique prononcera un nouveau jugement… Le prévenu, est le mot « brume « , il attend la sentence… avec un peu d’angoisse… A demain

Vous êtes plusieurs à m’avoir demandé la suite. Il me faut un peu de temps, car le texte que j’ai découvert est manuscrit, il faut me relire, et tout retaper…. La suite demain…

Camille qui semble la moins timide répond par la négative, elle explique que, comme souvent, elle les a regardés du haut des escaliers, par-dessus la rampe.
– Et vous ne savez pas où elle est allée après ?
C’est Denis cette fois, le frère de Camille qui a répondu. Il a expliqué qu’elle avait son manteau, que cela lui avait paru bizarre, puisque la photocopieuse est au premier.
Les policiers se sont regardés. On aurait dit qu’ils souriaient. Monsieur Malouin paraissait de plus en plus nerveux. Les inspecteurs sont sortis et le directeur est resté pour répartir les élèves dans les autres classes. Quelque chose, un détail, interrogeait les enfants. Ils n’étaient pas très âgés mais ils savaient parfaitement raisonner. « Comment la police a-t-elle pu faire pour être aussi vite sur place ? » Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire de disparition.
Monsieur Malouin semble embarrassé, il hésite, et finalement se dit que ce sont les CM2, les plus grands. De toute façon ils ne tarderont pas à découvrir la vérité. Il n’a pas besoin de réclamer le silence : tous les enfants sont suspendus à ses lèvres.
– Les enfants, ce qui s’est passé est vraiment bizarre, moi-même je n’y comprends rien, les inspecteurs sont venus ce matin parce qu’ils ont découvert le corps de Melle Lemoine ce matin à son domicile. Elle a été assassinée. Je suis comme vous, je n’y comprends rien, elle était bien là ce matin, c’est ce que je leur ai dit d’ailleurs et c’est quand ils sont arrivés que je me suis aperçu de sa disparition.
Cette histoire devient vraiment compliquée : une maîtresse assassinée, une fausse maîtresse qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la vraie.
Les élèves ont été répartis dans chacune des classes. Certains d’entre eux pleurent, d’autres sont déjà passés à autre chose.
L’après-midi, la plupart des élèves sont revenus à l’école. Ce sont les inspecteurs qui l’ont demandé. Ils peuvent encore avoir besoin d’informations.
En début d’après-midi, juste avant la sonnerie du début de classe Mr Malouin est resté très longtemps dans son bureau avec les inspecteurs. Lorsqu’il est sorti, il était pâle et avait l’air complètement absent.
Les policiers ont souhaité interroger Camille et son frère. Ces deux enfants ont, en effet, l’air d’en savoir un peu plus que les autres.
Hier soir, Camille et son frère sont retournés à l’école. Elle avait oublié ses lunettes et sans elles, elle aurait eu beaucoup de difficultés à faire ses devoirs. Les enfants savent que leur maîtresse reste assez longtemps, le soir, dans sa classe. Elle leur dit régulièrement que s’ils ont le moindre problème ils peuvent venir la voir, elle est là pour les aider. Elle est tellement gentille Danielle Lemoine.
Arrivés devant l’école, ils ont été rassurés en voyant de la lumière dans la classe. Dans les escaliers, ils ont croisé Mr Malouin. Il descend en se tenant à la rampe, comme s’il était épuisé. Il les a un peu grondés, tout surpris de les trouver dans l’école à cette heure-ci. Puis il les a laissés monter en leur recommandant de ne pas courir dans les couloirs.
Quand ils sont arrivés dans la classe, Melle Lemoine était en train de pleurer. Sans se cacher. Elle est surprise de voir Camille et son frère devant la porte, pétrifiés. Ils sont très impressionnés, n’osent rien dire, une maîtresse ça ne pleure pas. Ils se dépêchent de récupérer les lunettes et s’apprêtent à repartir en courant (tant pis pour ce qu’a dit Mr Malouin) quand elle leur propose de les raccompagner…
Camille et son frère ne sont pas impressionnés par les inspecteurs. Peut-être par habitude. Ils regardent beaucoup de films où les policiers sont souvent sympas et habillés en jeans.
Les réponses viennent, faciles. A chacun d’entre elles le puzzle se reconstitue…
En faisant du rangement dans mes cahiers, carnets j’ai découvert cette nouvelle que j’avais écrite il y a une vingtaine d’années. Je n’ai pas trouvé la date précise. Je viens de la relire, et comment dire, elle est un peu surprenante, un peu hors norme par rapport à mon style habituel…. Je la publierai en quatre parties

Quand la fin de la récréation a sonné la classe de Mademoiselle Lemoine s’est regroupée à peu près convenablement à l’endroit habituel. Comme toujours, il faut laisser passer les élèves de Madame Antoine et ensuite il faut monter en classe.
Arrivés dans leur salle, les élèves n’ont pas l’air surpris de n’y pas trouver leur maîtresse. Elle passe souvent la récréation à la salle de photocopie. Ils s’installent et se mettent au travail. Au bout d’un quart d’heure, ils sont un peu étonnés d’être toujours seuls. Ils ont d’abord pris ce retard pour une prolongation de récréation, puis une espèce d’angoisse a pris le dessus sur la satisfaction. Ils sont seuls à cet étage. Aucun bruit extérieur ne leur parvient.
C’est au moment où l’un d’entre eux s’est auto-désigné pour aller voir ce qui se passait que le directeur est entré, entouré de deux hommes aux regards nerveux. Le directeur, Monsieur Malouin semble inquiet. Les enfants n’ont plus envie de chahuter. Quelque chose n’est pas normal. Certains se souviennent que ce matin, Mademoiselle Lemoine est arrivée en retard. Camille a même cru voir qu’elle avait pleuré. Jusqu’à la récré de dix heures, tout s’était déroulé normalement. Enfin à peu près, parce qu’elle leur avait faire exactement la même dictée qu’hier et ils n’avaient évidemment rien dit, bien trop heureux de pouvoir faire zéro faute. Mais maintenant elle n’est pas là, ou pour être plus exact, elle n’est plus là. Et il y a ces trois hommes aux visages gris.
Monsieur Malouin leur explique que Mademoiselle Lemoine a eu un petit problème, qu’elle a dû s’absenter en urgence. Il leur dit aussi que ces messieurs sont de la police et qu’ils vont leur poser quelques questions. Les inspecteurs se sont assis sur le bureau et le directeur est resté au milieu de l’estrade, à se tordre les mains.
Tout à l’heure Monsieur Malouin leur a menti : Mademoiselle Lemoine n’est pas partie, elle a disparu et on ne sait pas pourquoi. Les inspecteurs sont là pour essayer de comprendre. Le plus âgé d’entre eux a commencé à poser des questions :

Ce soir c’est Noël,
Ciel bleu s’est fait une beauté
Vite fait, il a préparé
Un ragoût mou,
A la crème de nuages
Blancs comme neige.
A table !
Il est arrivé,
Le temps du beau, du bon, du blond, du sucré…
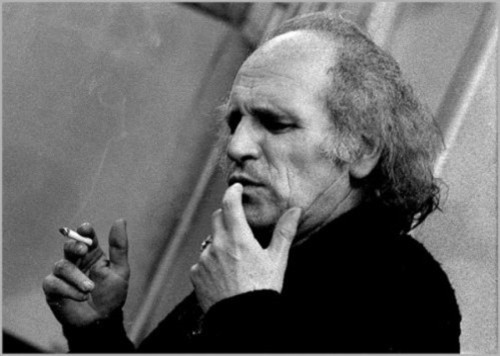
La mer en vous comme un cadeau
Et dans vos vagues enveloppée
Tandis que de vos doigts glacés
Vous m’inventez sur un seul mot
O ma frégate des hauts-fonds
Petite frangine du mal
Remettez-vous de la passion
Venez que je vous fasse mal
Je vous dirai des mots d’amour
Des mots de rien de tous les jours
Les mots du pire et du meilleur
Et puis des mots venus d’ailleurs
Je vous dirai que je t’aimais
Tu me diras que vous m’aimez
Vous me ferez ce que tu peux
Je vous dirai ce que tu veux
Je vous dirai ce que tu veuxJe vous aime d’amour

Ce matin il y a procès au tribunal académique. Quelques mots sont là, coupables de coalition. Le président du tribunal, vient d’appeler automne à la barre.
Il lit l’acte d’accusation :
« Automne, nom commun, vous comparaissez devant cette cour pour le délit de haute trahison. A plusieurs reprises, vous avez été vu, entendu en compagnie des mots suivants : joyeux, bleu, heureux, doux, roux, bucolique et « cerise » sur le gâteau, mou.
Eu égard à la loi du 13 novembre 1912, stipulant qu’automne ne peut être vu qu’en compagnie de gris, morne, triste, venteux, mélancolique, et violon, vous êtes donc en infraction grammaticale, syntaxique et surtout lexicale.
En conséquence et en vertu des pouvoirs alphabétiques qui me sont donnés, je vous condamne à trois ans de travaux forcés. Messieurs les gardiens de la rime, je vous en prie, veuillez accompagner le prévenu… »
« Affaire suivante ! »

Ce soir
Une odeur
De fête
Dans ma tête
La sensation
De naître encore
Une fois
Pour combien de temps
Encore
Pour la beauté de quelques mots
Qui pourissent
Comme d’autres
Au fond d’une lueur
De déshumanité
Tout ça
Inventé
Janvier 1981

C’était un soir de trop,
Vidé de son plein de beau.
Triste soir si laid,
Laisse un long goût de craie.
Seul, il veut poursuivre le chemin
Partir, finir,
Entrevoir le bout du presque rien.
Seul, s’en aller,
Se poser, regard blessé.
Et,
Juste au bord,
Au bord gris du vide de demain,
Laisser pendre les jambes,
Tout doucement souffler,
Laisser les yeux se fermer,
Prendre un dernier souffle d’été,
Laisser un peu de temps passer,
Et dans l’ombre
Te voir arriver.
Vous avez aimé cette micro-nouvelle ? Je vous invite à voter pour le concours hiver 2020 du site Short Edition : voici le lien
https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/il-manquait-un-voyageur-1?all-comments=1&update_notif=1577114443#fos_comment_3949695

J’ai posé mon oreille endormie
Sur la blanche feuille
Aux bords arrondis.
J’écoute le chant des mots retrouvés,
La douce mélodie glisse sur le papier
Du bout des doigts,
Mes si belles lettres j’ai caressées.
Affamées par une longue traversée,
Autour de ma table sans marges elles se sont installées…
21 décembre

Ici,
Ici tu viens pour apprendre
Que tu n’es rien
Pour comprendre
Que les hommes dehors
Sont passés par là
Alors, alors
Le sens du message
Te gicle à la face
Équation française :
Moyen, moyenne
Nation
Mais ici ils n’ont que ta silhouette déguisée
Jamais ils ne pénétreront dans ce qui est fait de toi
Jamais ils n’auront la part du rêve qui t’appartient
Parce qu’il est fait des autres, que tu aimes
Et qui les fait rien
Jamais ils ne découperont tes souvenirs en pointillé
Parce qu’eux sont nés avec la préhistoire
Ils ont oublié d’avancer
Alors ils se sont améliorés
Organisés
Et ils affranchissent tous leurs mots
De cinq lettres
A-R-M-E-E
Mais alors toi il faut que tu te battes
Bats toi !
Pas contre eux
Ils seraient trop heureux d’exister
Bats toi, contre toi
Fais que ta silhouette ne soit qu’ombre
Fais que ta parole ne soit là bas , que branche morte
Pour que vivent les racines
Les seules
Celles de ta vie
Celles qu’ils n’auront jamais
Alors ils pourriront
Peut-être

Quand vient le soir,
Quand tombent les premières gouttes de nuit.
Quand les fenêtres se ferment,
Quand les regards se taisent,
Quand les mots se font rares et lents,
Alors,
Alors, la ville fronce ses sourcils de béton fatigué,
Et sur les façades à la blancheur inventée
On aperçoit quelques trous de lumière.
Entends les, ils scintillent,
Entends les, ils t’invitent à rentrer..
16 décembre

C’est un tout petit matin de rien,
Matin qui ne tente rien.
Ah, pour ça, on le lui dit !
Matin reste dans ton coin,
Et surtout ne fais pas le malin…
Ne viens pas déranger notre beauté.
Tu est si simple,
Et tellement laid.
On s’occupe de tout,
Du bleu, du mauve, du rougeoyant,
Et bien sûr,
Du flamboyant
Petit matin est résigné.
Petit matin est blasé.
Mais aujourd’hui,
Petit matin est rebelle.
Il a pris dans grande poche bleue
Une belle craie blanche.
Et d’un trait, d’un seul,
Il a envoyé un signe blanc et poudreux.
Merci petit matin bleu,
Tu as mis des étoiles dans mes yeux.
15 décembre
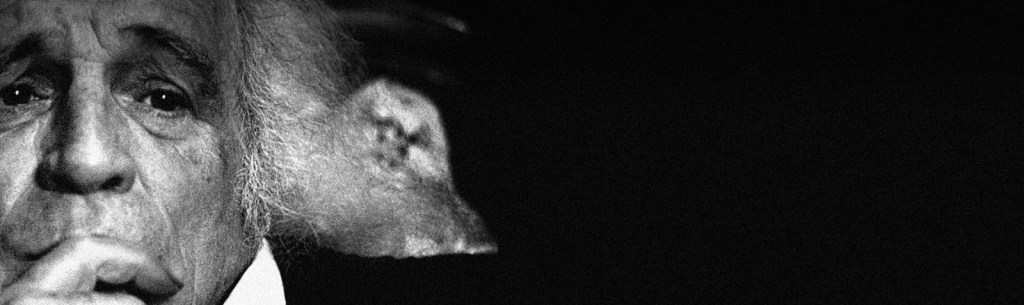
… Les départs sont des répétitions de la mort : Quand, au bout du quai le train roulant déjà vite, on perd de vue l’être qui agite son fanion mouchoir, il se passe quelque chose, comme un bris de l’âme, et l’on entre dans le coma de l’absence qui est une mort figurée. A l’enterrement de l’exilé, l’exilé marche devant. C’est un mort debout, alimenté en instance. Je n’aime pas les ports, ni les gares, ces antichambres du néant. Le partir n’implique pas la distance. Le partir c’est de l’imagination…
Je publie en deux parties, un texte écrit le 11 novembre 1982, j’étais alors soldat du contingent, le temps était gris, l’ennui était grand… Ce n’est pas un texte antimilitariste, car je ne l’ai jamais été fondamentalement, c’est encore un texte profondément mélancolique.

Ici,
Ici tout pue
Même le désespoir est carré
Toujours cette odeur angoissante
Où la ressemblance kaki
Se marie si bien
Avec un automne
Sans fin, ni feuille
Ici,
Ici le vide
Perpétuel engrais
D’une varice
Sur un monde
Qui attend le grand cri
Pour enfin dire non
Ici,
Ici j’étouffe
Je ne comprends plus
Ou trop
Je ne peux risquer un
Pourquoi ?
Ici les réponses n’existent pas
Elles pourrissent dans l’antiquité des ordres
Ici le masculin est toujours sujet
Le féminin neutre s’ajoute
Comme trois points de suspension
Ici,
Ici tu viens pour servir
Un bout de chiffon
Lange trouée
D’une république à répétition
Mitraillette de la honte
Ici,
Ici tu ne dois pas pleurer
Ça fait désordre
Ici tu dois sourire béatement
L’extase est dans l’alignement
On te déplace
Et toi tu bouges
Tu t’aperçois que marcher
C’est soustraire tes pas
A ton propre chemin
Cadence infernale
Et toi tu retiens ton souffle
Et tu le rajoutes à ta haine
A l’ailleurs de derrière tes yeux
T’as peur
Et tu pourrais craquer
C’est inhabituel mais j’ai supprimé la première version de cette micro-nouvelle, que j’ai publiée ce matin, car sur des conseils éclairés, je l’ai très légèrement modifiée, et je le crois beaucoup améliorée.

Comme tous les matins, Il prend le train. Comme tous les matins, il sort son livre, prend son casque et invite Léo Ferré, à l’accompagner dans sa lecture ferroviaire. Camus sous les yeux, Ferré dans les oreilles : le trajet devient voyage. Quelques minutes passent, et les compagnons de « route », tout doucement s’effacent.
Ce matin-là, il lui semble pourtant, dès le début que quelques détails ont changé. Il ne pourrait dire lesquels mais quand il a posé le pied dans le compartiment, cherchant sa place habituelle (il aime les rites, il en a besoin pour s’envoler), il lui a semblé qu’aucun des visages ne lui étaient familiers. Curieux, cela fait quinze ans qu’il fait ce trajet, sensiblement aux mêmes heures, et tout le monde se connaît, ou plutôt tout le monde se reconnait, prenant évidemment grand soin à ne rien se dire pour ne pas prendre le risque de percer toutes ces petites bulles dans lesquelles chacun s’est enfermé.
Il s’assied, sort son casque, s’énervant au passage sur les nœuds qui comme toujours ont profité de la nuit pour se former. Il sort un livre de poche. De poche parce qu’il ne faut pas trop se charger. Il commence sa lecture.
Évidemment il s’agit de Camus. C’est l’étranger qu’il a choisi ce matin dans le rayon dédié à son maître absolu. Il l’ouvre, au hasard, et de toute façon sait qu’en quelques secondes il sera transporté. Il commence sa lecture : c’est le passage où Meursault est sur la plage et le drame va se produire ….
« C’est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent… » Il lève les yeux, pour reprendre son souffle : chaque mot est une vibration intérieure qui le secoue. Autour de lui les visages sont pâles, on devine l’angoisse… Il n’y prête pas attention. Il continue.
« Il m’a semblé que le ciel s’ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s’est tendu et j’ai crispé ma main sur le revolver… » Il s’arrête, le souffle court. Il comprend que ce sont des gouttes de sueur qui tombent sur la page. « La gâchette a cédé, j’ai touché le ventre poli de la crosse et c’est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. »
Le train s’est arrêté, brusquement, il ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. C’est la police ferroviaire, elle a surgi dans le compartiment. Ils se sont approchés de lui, et ont fait signe d’enlever le casque.
Cela trouble le voyage des autres passagers. Il ne comprend pas, enfin pas tout de suite. Le policier est toujours devant lui, le regard un peu menaçant :
Il pointe une petite affichette sur laquelle est écrit :
« Compartiment non-lecteur, no reading »
Il est discipliné et demande seulement une petite faveur : celle de terminer les quelques lignes qui lui restent sur cette page.
« J’ai secoué la sueur et le soleil. J’ai compris que j’avais détruit l’équilibre du jour, le silence exceptionnel d’une plage où j’avais été heureux. Alors j’ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s’enfonçaient sans qu’il y parût. Et c’était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur… »
Magnifique poème en prose de Baudelaire qui exprime parfaitement l’alliance entre l’inspiration et l’imagination…

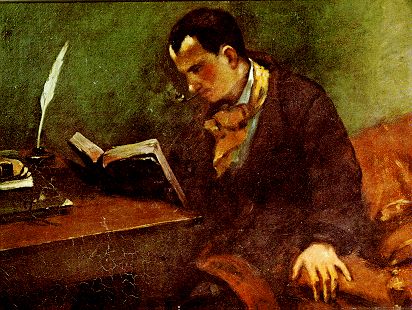
Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.
Par-delà des vagues de toits, j’aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j’ai refait l’histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant.
Si c’eût été un pauvre vieux homme, j’aurais refait la sienne tout aussi aisément.
Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert dans d’autres que moi-même.
Peut-être me direz-vous : « Es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? » Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ?
J’ai retrouvé ce très court texte, écrit fin 1980, qui exprime comme souvent après une période de disette, cette peur d’écrire, de reprendre la plume

J’ai peur d »écrire,
Comme si l’autre poésie,
Celle qui dort,
Là ,
Fière sur le papier
Allait porter un jugement
Sur la nouveauté.
J’ai peur et mes mots
En transpirent
A quand le passé décomposé ?
Décembre 1980

J’étais assis dans le tram, celui qui remonte la grande rue. Le revolver que je me suis procuré quelques heures avant de rencontrer cette peut-être Brigitte me frotte le pli de l’aine. Il faut dire que le canon est plus long que je ne l’aurais imaginé, et puis je l’ai bien enfoncé dans mon jean, sous mon blouson. Je n’imaginais pas aller quelque part. J’étais assis dans le tram.
Et puis tout avait commencé un même jour, au même endroit. Je revenais vers cette après-midi moite d’un automne d’il y a deux ans. Mais aujourd’hui, le tram n’est pas le même, la grande rue est différente. Aujourd’hui, je suis dans ses entrailles, je l’accompagne dans son entreprise de destruction.
Les passagers sont nombreux, mais ils ne forment pas ce bloc compact qui empêche de les distinguer chacun. Lorsque je me suis levé, personne n’a réagi. Bien sûr, je ne suis encore qu’un autre. Puis j’ai sorti mon arme, calmement, et j’ai tiré, plusieurs fois.
Il y a eu des cris, des pleurs, et puis ils se sont jetés sur moi. Ils ne veulent pas que je m’échappe.
Mais moi, de toute façon, je ne veux pas partir…

Le monde est à terre.
Pâle d’ennui,
Il chante à mots bas.
Entends ce long murmure,
Dans le souffle de mes bras.
Il s’étire jusqu’à demain.
Enroulés dans un lourd drap de brume,
Nos enfants chagrins
Pleurent au large.
Leurs cris se glissent.
Entre les plis de ton visage…
13 décembre

Des semaines se sont empilées tout autour de moi. A chacune d’elles passée, c’est une pierre qui se rajoute au mur qui m’entoure. Je ne suis plus qu’un symptôme de vie. Je me contente de subir les enchaînements biologiques d’une existence en sursis permanent.
J’attends. J’attends qu’il se produise quelque chose. Ce soir j’ai réussi à parler, ou tout au moins à laisser échapper quelques sons en direction d’une fille qui aurait peut‑être pu s’appeler Brigitte. Après un parcours de circonstances anecdotiques, nous nous sommes retrouvés dans l’intimité d’une pièce rendant son office de chambre du mieux qu’elle pouvait. La conversation devient de plus en plus une entreprise de destruction du mur mitoyen qui nous séparait encore. A chaque mot qui sortait s’en rajoutait un autre qui le poussait vers une espèce de silothèque ou nous engrangions faux souvenirs et avenirs prémédités.
Le temps filait, tout doucement, et le moment venait où les mots ne suffiraient plus à remplir les creux de nos silences. Puis tout naturellement, elle est venue s’inscrire sur le tableau noir de mon attente et j’ai refermé les bras sur cette bouée qu’elle essayait de me lancer. Son corps était magnifique, et ses imperfections lui donnaient une coloration particulière que nuls artifices industriels ne seraient parvenus à lui offrir. J’éprouvais au cours de cette nuit des plaisirs intenses, des plaisirs violents. Ils étaient comme l’aboutissement, comme la conclusion, le point final d’une histoire un peu difficile, qu’on a pris plaisir à lire, mais qu’on est satisfait de laisser.
C’est le lendemain, au jour, quand tout le monde s’est éveillé, quand nous nous sommes nettoyés de tous les fantômes de la nuit que j’ai vu que ce jour serait le dernier. La personne que j’avais admise entre les parenthèses de mon angoisse, avait dans sa silhouette générale, dans le demi-sourire béat qui l’habitait le reflet involontaire d’une sensation qui m’obsédait. La chambre était maintenant lumineuse et tout ce qui n’était dans la nuit que soupçons devenait désormais emblème de façade. Chaque décoration était le résultat d’une longue et mûre réflexion à propos de l’inutilité de l’œil dans le choix du beau. Tout respirait la répétition d’une histoire qu’on croit merveilleuse parce qu’elle entraîne au- delà du lexique habituel. Et surtout il y avait cette odeur, cette odeur humaine. Un par un, j’enfilais mes vêtements et aucun son ne sortait de ma bouche. Le corps que j’étreignais cette nuit avait entamé une série de mouvements sous les draps. Les formes qui se devinaient étaient toujours aussi agréables, mais elles appartenaient déjà à une autre histoire. Quand elle m’a demandé si on se reverrait, je me suis contenté de lui sourire, gentiment, mais toujours sans rien pouvoir lui dire.
Quand je suis sorti, j’étais presque apaisé. Non pas satisfait, je ne savais depuis longtemps ce que cela voulait dire, mais apaisé. Simplement. J’étais arrivé à ce point où la douleur, la lassitude et la haine en conjuguant leurs efforts s’étaient transformés en une espèce de béatitude moyenne.
Plus rien ne pouvait m’arriver. Je sentais bien que le jour était venu, le seul jour, le dernier jour.

Le jour se lève me dites-vous ?
Etait-il donc endormi ?
Comment ?
Assoupi, simplement…
Tiens donc…
Étrange, n’est-ce pas ?
Je n’ai rien vu.
J’ai cherché, vous dis-je.
J’ai cherché sans un bruit,
Me perdant
Jusqu’aux bords mauves
De votre trop longue nuit
Et ne l’ai point rencontré.
Vous doutez ?
C’est tant pis :
Je n’irai plus déranger
Les belles couleurs de votre ennui…
13 décembre